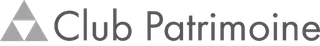Publié le et rédigé par Cyril Jarnias
Publié le et rédigé par Cyril Jarnias
L’histoire du pays en Jamaïque ne commence ni avec Christophe Colomb ni avec les plantations de sucre. Elle naît bien avant, dans une île que ses premiers habitants appelaient Xaymaca, la « terre du bois et de l’eau ». Aujourd’hui, cette histoire se lit autant dans les archives que dans les grottes ornées de pétroglyphes, les villages marrons, les musées archéologiques, la musique reggae ou les revendications identitaires des descendants taïnos et maroons. Retracer ce parcours, c’est comprendre comment une petite île des Caraïbes est devenue un symbole mondial de résistance, de métissage et de création culturelle.
Aux origines : Xaymaca, terre taïno
Bien avant les empires européens, la Jamaïque est au cœur des routes de migrations amérindiennes. Les archéologues identifient plusieurs vagues successives de peuplement, visibles à travers la céramique, les outils et les sites funéraires.
Les premiers peuples et l’arrivée des Taïnos
Les premiers habitants connus sont les Redware ou Ostionoïdes, présents autour de 600–650 apr. J.-C., reconnaissables à leur poterie rouge caractéristique. Vers 800, arrivent des populations de langue arawak, les Taïnos, dernières grandes vagues de migration depuis l’Amérique du Sud.
Au fil des siècles, une culture arawak–taïno pleinement jamaïcaine se développe. Les Taïnos nomment l’île Xaymaca, « terre du bois et de l’eau » ou « terre des sources », en référence à l’abondance forestière et aux rivières. Leur société est agricole, structurée et hiérarchisée.
On y trouve :
– des villages, les yucayeques, dirigés par des chefs, les caciques ;
– une élite de nobles, les nitaínos, et une population de producteurs, les naborias ;
– des prêtres–guérisseurs, les bohiques, garants des rites et des savoirs médicinaux ;
– une filiation matrilinéaire, où les droits de succession passent par la lignée des femmes.
Les Taïnos cultivaient principalement le manioc (yuca) en utilisant la technique du conuco, qui implique le brûlis et la création de buttes fertilisées. Leurs cultures incluaient aussi la patate douce, le maïs, le coton, le tabac, les calebasses, l’ananas, les ignames et d’autres tubercules. Leurs villages étaient structurés autour d’une place centrale, avec des maisons circulaires (bohíos) pour la population et des maisons rectangulaires (caney) pour la famille du chef (cacique).
Spiritualité et culture matérielle taïno
La cosmologie taïno repose sur le culte des zemis, entités divines ou ancêtres matérialisés dans des objets en pierre, bois ou argile. Des divinités majeures comme Atabey et son fils Yúcahu structurent l’imaginaire religieux. Les cérémonies incluent l’usage d’une poudre hallucinogène, le cohoba, inhalée à travers des tubes, et consommée sur des palettes parfois tachées d’ocre rouge, retrouvées par les archéologues.
Les Taïnos jouent au batey, jeu de balle cérémoniel sur un terrain rectangulaire – même si, fait remarquable pour la Jamaïque, les grands terrains de jeu et places cérémonielles laissent peu de traces dans l’archéologie locale. Leur culture matérielle est riche : bols, plats, jarres, griddles en argile (les burén pour cuire le pain de manioc), parures zoomorphes, outils de pierre et de coquille.
L’héritage linguistique est immense. Des mots aujourd’hui universels viennent du taïno :
| Mot taïno | Forme moderne | Sens approximatif |
|---|---|---|
| barbacoa | barbecue | grillage surélevé pour fumer la viande |
| hamaca | hamac | lit suspendu |
| kanoa | canoë | embarcation creusée dans un tronc |
| tabaco | tabac | plante/fumée sacrée |
| sabana | savane | plaine herbeuse |
| juracán | ouragan | tempête destructrice |
À la veille de la conquête européenne, on estime la population taïno en Jamaïque à environ 60 000 personnes, réparties en plus de 200 villages. L’île est alors un espace densément habité, structuré, loin de l’image d’un « monde vierge » parfois colportée.
Les sites archéologiques, archives du monde taïno
L’histoire du pays en Jamaïque s’écrit de plus en plus à partir des fouilles. Plusieurs sites majeurs éclairent la vie précolombienne et le premier contact avec l’Europe.
White Marl, situé entre Kingston et Spanish Town, est considéré comme l’un des sites taïnos les plus emblématiques de Jamaïque. Occupé depuis au moins le IXᵉ siècle, ce grand village bénéficiait d’une position stratégique, établi entre les cours d’eau de la Fresh River et du Rio Cobre. Les fouilles archéologiques y ont mis au jour de nombreux artefacts témoignant de la vie de ses habitants.
– un énorme midden (amas de déchets) riche en coquillages marins, os d’animaux, tessons de céramique ;
– des restes humains en excellent état, parfois associés à des chiens, révélant des pratiques funéraires complexes ;
– une influence céramique venue d’Haïti et de Cuba, signe d’échanges interinsulaires ;
– puis, plus tard, les vestiges d’habitations de plantations sucrières britanniques des XVIIIᵉ–XIXᵉ siècles.
L’État jamaïcain rachète en 1971 la plantation de 300 acres contenant White Marl pour en faire l’un des premiers parcs de patrimoine du pays. Un musée taïno, construit sur le modèle d’une hutte, y est ensuite établi, avant d’être fermé en 2007 puis 2008 en raison de l’insécurité. Une partie des collections est transférée à l’Institute of Jamaica à Kingston.
Plus au nord, à Maima (Saint Ann’s Bay), adossé au site historique de Sevilla la Nueva, des fouilles récentes (2014–2015) bouleversent la connaissance de l’architecture taïno. Pour la première fois, on identifie clairement des terrasses artificielles en gravier de marne et calcaire, servant de plateformes pour des maisons circulaires à poteau central. Une habitation excavée, de 4 m de diamètre pour 12,5 m², livre plus de 11 500 fragments de céramique et près de 450 autres artefacts dans une autre maison (House 10). Quelques objets espagnols en place montrent un contact direct Taïno–Espagnols, suivi d’un abandon rapide du village.
Datation de la première occupation du village taïno de Maima, avant l’arrivée de Christophe Colomb.
D’autres sites complètent ce puzzle :
– les grottes de Mountain River (Saint Catherine), avec au moins 148 pictogrammes et pétroglyphes taïnos, datés entre 500 et 1300 ans, classées monument national en 2003 ;
– les Two Sisters Caves à Hellshire, qui ont livré un duho (siège cérémoniel) aujourd’hui exposé à la National Gallery of Jamaica ;
– un abri sous roche funéraire aux Hellshire Hills, mis au jour par des carriers, où les archéologues découvrent un zemi en argile, un bol et des restes humains ;
– le site côtier de Green Castle, avec squelettes et céramiques autour de l’an 900, fermé au public depuis 2022 ;
– les Green Grotto Caves, Little River, Canoe Valley ou encore une grotte ornée près de Woodside (St. Mary), tous liés à la présence taïno.
Cette archéologie reste pourtant fragile et souvent sous-financée, surtout lorsqu’il s’agit de sites amérindiens, nettement moins dotés que des sites plus médiatisés comme Port Royal ou Spanish Town. Le pillage est un problème constant : le Chancery Hall, Port Royal (y compris la « cité engloutie »), Canoe Valley, Pimento Hill ou White Marl ont connu des fouilles illégales, parfois avec des engins lourds, avant même l’arrivée des archéologues de la Jamaica National Heritage Trust (JNHT).
Conquête européenne et effondrement taïno
L’arrivée des Européens bouleverse radicalement cette société insulaire.
Les voyages de Colomb et les premiers contacts
Christophe Colomb aborde pour la première fois la côte nord de la Jamaïque en 1494, lors de son deuxième voyage. Il mouille d’abord à St. Ann’s Bay, puis dans une baie en forme de fer à cheval – l’actuelle Discovery Bay, qu’il baptise Santa Gloria. L’île est revendiquée au nom de la Castille et rebaptisée Santiago, même si le nom autochtone Xaymaca finira par s’imposer, devenu « Jamaiqua », puis Jamaica sur les cartes.
Colomb revient en 1503, lors de son quatrième voyage, dans des circonstances dramatiques. Ses navires Santiago et La Capitana, rongés par les tarets, sont tirés à sec sur la plage de St. Ann’s Bay, à quelques centaines de mètres du village taïno de Maima. L’explorateur et son équipage restent bloqués sur l’île pendant un an, du 25 juin 1503 au 29 juin 1504, vivant largement grâce aux vivres fournis par la communauté taïno locale. C’est ce même épisode où Colomb, selon les chroniqueurs, utilise les tables astronomiques de Regiomontanus pour « prédire » une éclipse de Lune et impressionner ses hôtes, menaçant de priver les Indiens de la faveur divine.
L’importance de Maima dans cet épisode est cruciale : ses ressources et sa localisation géographique influenceront directement le choix de l’emplacement de la première capitale espagnole plus tard.
Domination espagnole et disparition des Taïnos
En 1509, le fils de Colomb, Diego, charge le conquistador Juan de Esquivel d’occuper officiellement l’île. Une première colonie, Sevilla la Nueva (New Seville), est fondée près de St. Ann’s Bay, puis déplacée en 1534 vers l’intérieur, à Villa de la Vega, future Spanish Town. La Jamaïque est intégrée à la vice–royauté de Nouvelle–Espagne et devient colonie royale la même année.
Les Espagnols importent avec eux le système de l’encomienda et du repartimiento de Indias : les Taïnos sont contraints au travail forcé, leurs terres sont confisquées, les violences se multiplient. Les maladies européennes – grippe, variole, rougeole, varicelle –, le surmenage dans les champs et les mines, les mauvais traitements provoquent une hécatombe démographique. Les chroniqueurs et le dominicain Bartolomé de las Casas décrivent ce qu’on qualifierait aujourd’hui de catastrophe génocidaire.
Seulement 74 Taïnos étaient recensés en 1611 sur une population totale de 1 510 habitants à Saint-Domingue.
La faiblesse numérique de la colonie espagnole est frappante. Un siècle et demi après la conquête, la population totale ne dépasse guère 3 000 à 4 000 personnes. La Jamaïque n’offre pas l’or espéré et n’est vue que comme un dépôt militaire et logistique pour les entreprises espagnoles plus lucratives de Cuba et d’Hispaniola. Les colons mènent une vie décrite comme « oisive », les terres du nord sont abandonnées et recolonisées par la forêt.
C’est à cette époque que commence l’importation d’esclaves africains pour remplacer la main-d’œuvre taïno décimée. Les Espagnols introduisent également nouveaux animaux (porcs, bovins, chevaux, chèvres, poulets) et cultures (canne à sucre, agrumes, bananes, patates douces, tabac), ainsi que les institutions de l’Église catholique.
Piraterie et convoitises
Sous administration espagnole, l’île reste vulnérable. À partir de la fin du XVIᵉ siècle, corsaires anglais, français et néerlandais multiplient les attaques : Anthony Shirley pille Spanish Town en 1597 avec l’aide d’un guide taïno ; Christopher Newport, William Jackson ou des flibustiers français ravagent régulièrement les côtes.
Cette fragilité prépare le terrain pour une prise de contrôle anglaise. Lorsque Cromwell lance sa « Western Design », expédition contre les possessions espagnoles des Caraïbes, la Jamaïque apparaît comme une cible accessible.
Conquête anglaise, esclavage et naissance des Marrons
En 1655, une flotte anglaise en échec devant Saint-Domingue se rabat sur la Jamaïque. En quelques jours, l’île change de main.
Prise de la Jamaïque par l’Angleterre
En mai 1655, environ 7 000 soldats anglais, commandés par l’amiral William Penn et le général Robert Venables, débarquent près de Spanish Town. La garnison espagnole, très réduite, est rapidement submergée. En quelques années, après les batailles d’Ocho Rios (1657) et de Rio Nuevo (1658), la résistance espagnole est définitivement brisée. L’Espagne renonce officiellement à l’île en 1670 par le traité de Madrid, qui cède aussi les îles Caïmans à l’Angleterre.
Avant de fuir vers Cuba, de nombreux colons espagnols libèrent leurs esclaves. Ces Africains affranchis, rejoints par des Taïnos survivants et, plus tard, par les esclaves en fuite des nouvelles plantations anglaises, vont se regrouper dans les montagnes. Ils deviennent les Marrons.
Les Marrons, une autre continuité taïno–africaine
Les communautés marronnes s’installent dans des zones difficiles d’accès : Cockpit Country, Blue Mountains, vallées isolées comme Lluidas Vale. On distingue progressivement :
– les Marrons au vent (Windward), à l’est, autour de Nanny Town et des Blue Mountains ;
– les Marrons sous le vent (Leeward), à l’ouest, autour de Cudjoe’s Town (Trelawny Town) et d’Accompong.
Leur origine est mixte : Africains de diverses ethnies (Akan, Ashanti, Yoruba, Igbo, Ibibio, etc.) mêlés à des Taïnos fuyant l’encomienda espagnole puis la colonisation anglaise. Queen Nanny, héroïne d’origine ashanti, est intégrée à l’imaginaire national jamaïcain comme figure de résistance absolue.
Chefs historiques des Marrons jamaïcains (Juan de Serras, Juan de Bolas, Cudjoe, Quao, Queen Nanny)
Les Marrons développent des sociétés autonomes, avec leurs propres conseils (Asofo, terme issu de l’akan), leurs systèmes juridiques, leurs religions, leurs plantes médicinales, leurs langues crypto-créoles. Ils pratiquent la guerre de guérilla et infligent aux Britanniques des pertes considérables pendant plusieurs décennies.
La plantation sucrière, moteur économique et machine de mort
Parallèlement, les nouveaux maîtres anglais transforment la Jamaïque en colonie de plantation. La canne à sucre, déjà expérimentée, est développée à grande échelle, surtout à partir de la fin du XVIIᵉ siècle. Importée du Brésil par les Hollandais, elle remplace rapidement la piraterie comme principale source de revenus.
Les chiffres donnent la mesure du basculement :
| Indicateur (ordre de grandeur) | Vers 1673 | Vers 1739 | Vers 1800 |
|---|---|---|---|
| Nombre de plantations sucrières | ~57 | ~430 | >700 (avec autres cultures) |
| Population esclavisée | ~9 000 | >100 000 | >300 000 |
| Population blanche | <10 000 (avant 1740) | ~30 000 | ~80 000 (pic 1780s) |
| Rapport Noir·e·s / Blanc·he·s | 3:1 | 5:1 | jusqu’à 20:1 |
La Jamaïque devient, selon l’expression des historiens, le « dépôt d’esclaves des Caraïbes », plaque tournante du commerce transatlantique. On estime à près d’un million le nombre d’Africains débarqués sur l’île au cours de la période britannique, même si tous n’y restent pas. Le commerce est représenté par des figures comme le négociant Alexandre Lindo, qui vend plus de 25 700 esclaves entre 1785 et 1796.
Nombre d’esclaves morts de famine entre 1780 et 1787, illustrant l’extrême brutalité du système.
Guerres marronnes et résistances esclaves
Face à cette violence, la résistance est continue. Les esclaves fuient, forment des communautés cachées (comme le célèbre Me-no-Sen-You-no-Come), fomentent des révoltes, s’allient parfois aux Marrons. Le XVIIIᵉ siècle est ponctué de grands soulèvements.
Entre la fin des années 1720 et la fin des années 1730, les guerres entre Marrons et Britanniques atteignent leur apogée. La Première guerre marronne se termine en 1739–1740 par des traités inédits dans le monde atlantique : une puissance coloniale est contrainte de négocier avec des esclaves en fuite. Les accords, signés sous le gouverneur Edward Trelawny, reconnaissent à environ 600 Marrons :
– la propriété collective de leurs terres (1 500 acres, par exemple, pour le groupe de Cudjoe) ;
– une autonomie politique interne ;
– la liberté de commerce.
En échange, les Marrons acceptent deux concessions lourdes de conséquences : aider à réprimer les invasions étrangères et les révoltes d’esclaves, et ramener les nouveaux fugitifs moyennant récompense. C’est ce rôle ambigu de chasseurs de fugitifs qui nourrira plus tard des tensions avec le reste de la population noire, même s’il ne résume pas l’histoire marronne.
En 1760, lors de la révolte de Tacky, les autorités firent appel aux Marrons. Le lieutenant Davy de Scott’s Hall abattit le chef Tacky, contribuant à écraser la rébellion. Lors de la Baptist War (1831-1832) menée par Samuel Sharpe, puis lors de la rébellion de Morant Bay (1865) initiée par Paul Bogle, les Marrons, encadrés par des surintendants blancs, participèrent de nouveau à la répression des soulèvements.
Une Seconde guerre marronne éclate en 1795, autour de Trelawny Town. Sur fond de peur des planteurs, traumatisés par la Révolution haïtienne et la Révolution française, le gouverneur Balcarres choisit la ligne dure. Malgré les mises en garde de notables, il privilégie la confrontation. L’officier William Fitch est tué dans une embuscade, et c’est finalement le général George Walpole qui met en place un siège massif des zones marronnes. Le recours à des chiens de chasse importés de Cuba finit de briser la résistance. Les Marrons capitulent, croyant à la parole de Walpole qui promet qu’ils ne seront pas déportés. Le gouverneur rompt cet engagement : près de 600 habitants de Trelawny Town sont exilés en Nouvelle–Écosse, puis, en 1800, à Freetown en Sierra Leone, où ils participent à la formation de l’ethnie créole. Certains reviendront à partir des années 1830, s’installant notamment à Flagstaff.
Malgré cette déportation, quatre grands villages marrons – Accompong, Moore Town (Nouvelle Nanny Town), Charles Town, Scott’s Hall – subsistent jusqu’à aujourd’hui et revendiquent toujours la validité des traités de 1739–1740.
Abolition, révoltes paysannes et naissance d’une nation
La fin de l’esclavage ne met pas un terme à la violence coloniale. Elle ouvre un long XIXᵉ siècle de révoltes, de recompositions sociales et de réformes politiques.
Révoltes d’esclaves et abolition
La révolte de Tacky en 1760, puis celles menées par d’autres chefs africains, annoncent les insurrections de plus grande ampleur. La plus décisive est la Baptist War, encore appelée révolte de Noël ou Christmas Rebellion, en 1831–1832. Elle est organisée par Samuel « Sam » Sharpe, esclave domestique lettré, diacre de l’Église baptiste de Burchell à Montego Bay. Ce dernier construit un réseau clandestin, prêche la liberté en s’appuyant sur la Bible, et planifie une grève générale qui dégénère en soulèvement après la répression coloniale.
Jusqu’à 60 000 esclaves participent au mouvement. La répression, menée par le général Sir Willoughby Cotton, fait environ 500 morts parmi les esclaves, exécutions comprises. Mais l’impact politique est immense : en Grande-Bretagne, l’émotion accélère la campagne abolitionniste. Le Parlement adopte en 1833 le Slavery Abolition Act, qui met fin légalement à l’esclavage dans l’Empire britannique à partir du 1ᵉʳ août 1834.
Montant en livres sterling versé en compensation aux propriétaires d’esclaves lors de l’abolition, sans réparation pour les anciens esclaves.
Beaucoup quittent alors les plantations et fondent des petites exploitations dans l’intérieur, la fameuse « yam belt », ceinture de l’igname. Mais la terre reste largement contrôlée par les planteurs et les nouvelles compagnies bananières. Les inégalités économiques et raciales demeurent massives.
Morant Bay et la rupture avec le système colonial
En octobre 1865, la tension explose dans l’est de l’île, à Morant Bay (St. Thomas). Le prédicateur baptiste Paul Bogle, influencé par le député métis George William Gordon, mobilise des paysans noirs exaspérés par la misère, l’injustice judiciaire et l’absence de droits politiques réels. Une manifestation tourne à l’affrontement : le palais de justice est incendié, le custos Baron von Ketelhodt et quinze membres du conseil paroissial sont tués.
La réaction du gouverneur Edward John Eyre est d’une brutalité extrême. La loi martiale est proclamée. L’armée, appuyée par des Marrons de Moore Town, tue 439 personnes et en exécute 354 après des procès expéditifs, dont Bogle et Gordon – ce dernier ayant été transféré illégalement de Kingston à Morant Bay pour être jugé et pendu.
À la suite du scandale de Morant Bay en 1866, l’Assemblée de Jamaïque, dominée par les planteurs, décide de s’auto-dissoudre. L’île passe alors sous administration directe de Londres, devenant une colonie de la Couronne. Le gouverneur John Peter Grant est nommé pour diriger l’île et met en œuvre d’importantes réformes administratives et judiciaires. Une conséquence majeure de cette transition est le déplacement définitif de la capitale de Spanish Town à Kingston en 1872.
Sur le plan économique, le sucre entre en crise, concurrencé par d’autres producteurs et fragilisé par la fin du travail servile. Les planteurs importent des travailleurs sous contrat d’Inde (dès 1845) et de Chine (dès 1854), aux côtés de migrants juifs, libanais, palestiniens et syriens. La culture de la banane prend le relais, sous l’impulsion de compagnies comme la United Fruit Company ou l’entreprise jamaïcaine Lanasa & Goffe. En 1890, la banane dépasse le sucre comme principal produit d’exportation.
Maroons, Taïnos et mémoire autochtone
Dans ce XIXᵉ siècle de recomposition, les Marrons continuent d’exister comme entités semi-autonomes, même si leur rôle militaire auprès des autorités diminue après l’abolition. L’Acte sur les attributions marronnes de 1842 tente de briser la propriété collective des terres, sans vraiment y parvenir à Accompong et Moore Town, où le foncier communautaire subsiste.
La mémoire taïno, loin d’être éteinte, persiste sous forme d’héritage diffus. Des communautés marronnes, notamment à Moore Town, revendiquent cette ascendance. Des études génétiques, comme celle de 2017, confirment que 0,5 % des Jamaïcains portent encore un ADN mitochondrial d’origine taïno. Depuis les années 2000, des groupes tels que les Yamaye Taíno et le Yamaye Council of Indigenous Leaders (YCOIL) œuvrent à rassembler les personnes se réclamant de cet héritage, souvent en lien avec les communautés marronnes.
L’élection, en 2019, de Robert Pairman comme cacique YukayekeYamayeGuani dans le village marron de Charles Town marque une étape symbolique. Lors de la cérémonie, il reçoit un miniature duho de l’Institute of Jamaica, une hache cérémonielle (mayana) d’un aîné taïno de Porto Rico, et une coiffe de plumes. C’est le premier chef taïno formellement intronisé en Jamaïque depuis plus de cinq siècles, signe que l’histoire autochtone n’est pas qu’un chapitre clos des manuels scolaires.
Depuis 2007, la Taino Day, célébrée chaque 5 mai, donne une visibilité nouvelle à cette mémoire. L’Institute of Jamaica et la JNHT organisent conférences, expositions d’artefacts à Seville Heritage Park (installé sur l’ancien village de Maima) et visites de sites historiques. Le Seville Heritage Park figure par ailleurs sur la liste indicative de l’UNESCO pour une éventuelle inscription au patrimoine mondial, avec ses reconstitutions de bohíos et ses collections taïnos.
Du colonialisme à l’indépendance : luttes, héros et mouvements
L’histoire du pays en Jamaïque au XXᵉ siècle est marquée par une montée en puissance des revendications ouvrières, anticoloniales et noires, qui aboutissent à l’indépendance en 1962.
Crises, syndicats et partis politiques
La Grande Dépression des années 1930 provoque cherté de la vie, chômage massif et grèves à répétition. En 1938, des émeutes éclatent, notamment à l’usine sucrière de Frome. Ces mouvements obligent Londres à mandater la Commission Moyne et à adopter le Colonial Development and Welfare Act, qui finance des projets sociaux dans les Caraïbes.
À la même époque émergent deux grandes figures politiques, toutes deux destinées à devenir héros nationaux :
– Alexander Bustamante, né William Alexander Clarke, qui fonde en 1938 le Bustamante Industrial Trade Union (BITU), puis, en 1943, le Jamaica Labour Party (JLP) ;
– Norman Manley, brillant avocat, qui crée en 1938 le People’s National Party (PNP) et en sera président pendant 31 ans.
Leur duel politique structura la vie publique jamaïcaine pendant plusieurs décennies. Bustamante, charismatique et populiste, incarne le syndicalisme de masse. Manley, plus intellectuel et social-démocrate, porte le projet d’autonomie progressive et de fédération caribéenne.
Étapes clés du processus d’émancipation politique de la Jamaïque après l’adoption de la nouvelle constitution de 1944.
La constitution de 1944 instaure le suffrage universel adulte. Le JLP (Parti travailliste de Jamaïque) d’Alexander Bustamante remporte les premières élections générales.
Le pays entre dans une période d’auto-gouvernement progressif, préparant son indépendance complète.
La Jamaïque participe à la Fédération des Indes occidentales à partir de 1958.
Un référendum en 1961 conduit la Jamaïque à se retirer de la Fédération des Indes occidentales.
Parallèlement, d’autres figures de la lutte noire prennent place dans le panthéon national. Marcus Garvey, fondateur en 1914 de l’Universal Negro Improvement Association (UNIA), a longtemps inspiré le panafricanisme et les mouvements noirs internationaux. Son projet de Black Star Line, compagnie maritime destinée à favoriser la « retour en Afrique », ses journaux comme Negro World et ses millions de partisans en ont fait un des plus grands leaders noirs du XXᵉ siècle. Exilé aux États-Unis, emprisonné, puis déporté en Jamaïque, il meurt à Londres en 1940. En 1964, sa dépouille est rapatriée au National Heroes Park. Il est proclamé premier héros national de Jamaïque.
Les autres héros officiels incarnent les différentes strates de cette histoire :
| Héros / héroïne | Période d’action principale | Rôle historique |
|---|---|---|
| Nanny of the Maroons | XVIIIᵉ siècle | Cheffe marronne, résistante aux Britanniques, symbole de liberté |
| Cudjoe, Quao (non héros officiels mais associés) | XVIIIᵉ | Négociateurs des traités marrons |
| Sam Sharpe | 1831–1832 | Instigateur de la Baptist War, accélérateur de l’abolition |
| Paul Bogle | 1865 | Leader de la rébellion de Morant Bay |
| George William Gordon | 1840–1865 | Député métis, défenseur des paysans noirs, martyr de Morant Bay |
| Marcus Garvey | 1914–1940 | Leader panafricain, fondateur de l’UNIA |
| Alexander Bustamante | 1938–1962 | Syndicaliste, fondateur du JLP, premier Premier ministre |
| Norman Manley | 1938–1962 | Fondateur du PNP, artisan de l’indépendance |
Un projet récent, « Jamaica National Heroes Modernized », vise depuis 2021 à revisiter ces figures à travers des films, de la musique, des portraits et une plateforme numérique, pour parler aux jeunes générations.
Indépendance et paradoxes économiques
Le 6 août 1962, la Jamaïque arrache son indépendance au Royaume–Uni, après la dissolution de la Fédération des Indes occidentales. Le drapeau noir, vert et or remplace l’Union Jack, la devise « Out of Many, One People » devient le mantra d’une nation qui se veut fière de son métissage. Alexander Bustamante est le premier Premier ministre d’un État qui reste, cependant, un royaume du Commonwealth, reconnaissant le monarque britannique comme chef d’État.
La décennie connaît une croissance réelle moyenne de 5,4 % par an (1962-1972), portée par l’industrialisation par invitation (bauxite, tourisme, zones franches). Cependant, ce boom économique repose sur des structures héritées de la plantation : concentration des terres, inégalités raciales et dépendance aux capitaux étrangers, ce qui complique rapidement la trajectoire de développement.
Dans les années 1970, le gouvernement de Michael Manley (PNP), arrivé au pouvoir en 1972, tente une expérience de démocratie socialiste : réforme agraire, gratuité de l’enseignement secondaire, politiques sociales ambitieuses, taxation accrue des multinationales de la bauxite. Mais le choc pétrolier de 1973, la chute des cours, la fuite des capitaux, la guerre froide (avec les pressions du gouvernement américain et des agences comme la CIA) et l’explosion des déficits plongent l’économie dans une crise grave.
Taux de croissance annuel moyen négatif de l’économie entre 1973 et 1980.
Dans les années 1980–1990, sous les gouvernements d’Edward Seaga puis de nouveau du PNP, la Jamaïque s’engage dans une libéralisation rapide : dérégulation du système financier, réduction des droits de douane, privatisations, ouverture totale des comptes de capitaux. Une bulle de crédit se forme, alimentée par des taux d’intérêt élevés. Son éclatement, à partir de 1996, provoque une crise bancaire majeure. L’État crée la FINSAC pour recapitaliser les banques, ce qui fait exploser la dette publique jusqu’à plus de 140 % du PIB au début des années 2000. Entre 1993 et 2007, la croissance réelle moyenne plafonne en dessous de 1 % : un quart de siècle de stagnation malgré un taux d’investissement voisin de 30 % du PIB, signe d’une profonde inefficacité structurelle.
La Jamaïque se retrouve piégée dans une économie très ouverte, dominée par les services – surtout le tourisme – et un énorme secteur informel, estimé à environ 40 % de l’activité, qui échappe largement à la fiscalité et aux politiques publiques. Les chocs externes, ouragans, crises financières, variations des prix des matières premières continuent de fragiliser l’archipel.
Rastafari, reggae et réinvention de l’identité jamaïcaine
Au milieu de ces convulsions économiques et politiques, la Jamaïque devient paradoxalement une superpuissance culturelle mondiale, portée par un mouvement religieux né dans les marges et une musique inventée dans les quartiers populaires de Kingston.
Le mouvement rastafari : une relecture noire de l’histoire
Le rastafarisme apparaît dans les années 1930, au moment même où surgissent syndicats et partis politiques. Il naît des quartiers pauvres d’Afro–Jamaïcains, nourri de panafricanisme, d’éthiopianisme chrétien, de la pensée de Marcus Garvey et de la fascination pour l’Abyssinie, seule grande puissance africaine à avoir résisté à la colonisation. Le couronnement, en 1930, de Ras Tafari Makonnen sous le nom de Haïlé Sélassié Ier, empereur d’Éthiopie, est interprété par certains prêcheurs comme l’accomplissement d’une prophétie biblique : le « Lion conquérant de la tribu de Juda » est revenu.
Des figures comme Leonard Howell, Archibald Dunkley, Robert Hinds ou Joseph Hibbert proclament la divinité de Sélassié, la condamnation de « Babylone » (le système colonial, capitaliste et raciste) et l’appel à un retour – physique ou spirituel – en Afrique, « Sion ». Howell crée, à la fin des années 1930, la communauté de Pinnacle à St. Catherine, régulièrement harcelée puis détruite par la police en 1954.
Le rastafarisme invente une « livity », un art de vivre qui rompt avec la culture coloniale :
– port de locks (dreadlocks) ;
– alimentation ital, frugale, proche du végétarisme ;
– usage sacramentel du ganja (cannabis) ;
– cérémonies nyabinghi avec tambours, chants et veillées ;
– langage réinventé, l’Iyaric, où l’on dit « I and I » pour insister sur l’unité du moi et du divin, « Babylon » pour le système oppressif et « Zion » pour l’Afrique libérée.
Ce mouvement, longtemps marginalisé, persécuté et sujet de raillerie, va trouver un vecteur inattendu de diffusion planétaire : la musique.
De mento au reggae : la bande-son de l’histoire
La musique jamaïcaine moderne résulte de plusieurs strates :
– le mento, musique rurale née à l’époque de l’esclavage, qui mélange rythmes africains, instruments européens et influences du calypso trinidien ;
– le ska, apparu à la fin des années 1950, inspiré du rhythm and blues américain et du jazz, porté par des groupes comme The Skatalites ;
– le rocksteady, né autour de 1966, plus lent, mettant en avant la basse et les paroles sociales ;
– puis le reggae, qui émerge vers 1968, nommé par le morceau « Do the Reggay » de Toots and the Maytals.
Les sound systems, ensembles d’enceintes mobiles, ont créé un espace musical unificateur à Kingston. Des batteurs comme Carlton Barrett ont popularisé le rythme « one drop », où le temps fort est marqué par la caisse claire et la grosse caisse. Sly Dunbar et Robbie Shakespeare ont ensuite développé des variantes rythmiques telles que le « rockers » et le « steppers ».
À partir du début des années 1960, les thèmes rastas infusent la musique. Des percussionnistes comme Count Ossie intègrent les rythmes nyabinghi au ska sur des titres comme « O’Carolina ». Des instrumentaux tels que « Tribute to Marcus Garvey » ou « Reincarnation » par The Skatalites annoncent déjà la fusion future entre message politique noir et sonorité jamaïcaine.
Dans les années 1970, le reggae roots devient la voix principale du rastafarisme. Bob Marley et les Wailers (avec Peter Tosh et Bunny Wailer) imposent mondialement le son jamaïcain. Leurs chansons racontent l’esclavage, la pauvreté, la violence politique, mais aussi l’espoir, la résistance, la foi. Des titres comme « Small Axe » sont suffisamment subversifs pour être interdits de diffusion radio durant les élections de 1972.
Lors du One Love Peace Concert de 1978, Bob Marley a réuni sur scène les leaders politiques rivaux Michael Manley et Edward Seaga, joignant leurs mains dans un geste symbolique pour apaiser les violences qui déchiraient la Jamaïque.
L’événement fondateur pour les rastas reste cependant la visite d’Haïlé Sélassié Ier en Jamaïque, le 21 avril 1966. Plus de 100 000 personnes l’accueillent, l’aéroport est envahi. L’empereur remet des médailles d’or à treize leaders rastas, conférant une légitimité inédite à un mouvement jusque-là diabolisé. Cette date devient le Grounation Day, célébrée chaque année. De nombreuses chansons, de Peter Tosh à Capleton, commémorent cet épisode.
Aujourd’hui, le reggae a essaimé partout :
– en Afrique, avec des artistes comme Lucky Dube, Alpha Blondy, Tiken Jah Fakoly, qui prolongent les luttes anti–apartheid et anticoloniales ;
– en Europe, où il influence punk et musiques urbaines (The Clash, Steel Pulse, Aswad) ;
– au Brésil, particulièrement dans l’État du Maranhão ;
– jusqu’au Japon avec des sound systems comme Mighty Crown.
En 1985, les Grammy Awards créent une catégorie « Reggae », consacrant l’inscription de cette musique, née dans les ghettos de Kingston, au panthéon de la culture mondiale.
L’histoire en profondeur : archéologie, institutions et batailles pour le patrimoine
L’histoire du pays en Jamaïque ne se lit pas seulement dans les livres, mais aussi dans les sols, les musées et les batailles juridiques autour des artefacts.
Institutions de la mémoire et archéologie moderne
L’Institute of Jamaica (IOJ), créé en 1879, est au cœur du dispositif patrimonial. Il abrite collections, laboratoires, musées, et a joué un rôle central dans la reconnaissance des recherches de pionniers comme Robert Randolph Howard, Charles Cotter ou Richard Hill, qui fut le premier à décrire le site de White Marl au XIXᵉ siècle, évoquant céramiques, restes humains et abondance de mollusques marins.
La Jamaica National Heritage Trust (JNHT), créée en 1985, est l’organisme légalement chargé de protéger les monuments et sites. Elle intervient en urgence sur des chantiers menaçant le patrimoine, comme en 1997 lors de la destruction partielle du site précolombien de Chancery Hall (St. Andrew) pour un projet immobilier. À cette occasion, ses équipes ont constaté le pillage d’une grande partie des artefacts et ont dû mener des fouilles de sauvetage pour récupérer les vestiges encore présents.
Les archéologues jamaïcains, soutenus parfois par des équipes étrangères (par exemple espagnoles en 1982 pour Sevilla la Nueva et White Marl, ou canadiennes comme David V. Burley), fouillent plus systématiquement les sites amérindiens depuis les années 1960. Mais les ressources restent limitées et les pillages fréquents, y compris sur des sites emblématiques comme le White Marl Taino Midden and Museum, considéré comme le plus précieux site taïno de Jamaïque et l’un des plus importants de la Caraïbe.
Une part importante des artefacts jamaïquains se trouve aujourd’hui dans des musées étrangers. Le British Museum possède, par exemple, des pièces majeures comme le « Bird Man », « Boinayel » ou le « Man with the Canopy » provenant de Carpenter’s Mountain. Le National Museum of the American Indian du Smithsonian et l’American Museum of Natural History conservent eux aussi des collections issues des fouilles du début du XXᵉ siècle, notamment celles de Theodoor de Booy.
Patrimoine menacé et trafic d’artefacts
Le pillage des sites archéologiques et historiques reste une menace constante. Outre Chancery Hall ou White Marl, la JNHT recense des cas dans des lieux aussi divers que :
Des sites archéologiques terrestres et sous-marins, comme la cité engloutie de Port Royal et des zones de Canoe Valley à Point, sont victimes de fouilles clandestines et de démolition pour la revente de matériaux, menaçant des artefacts historiques (monnaies, céramiques, métaux) et des bâtiments en brique.
En 2021, un bateau suspect, suspecté de pillage, est repéré stationné au-dessus d’un site sous-marin de Port Royal du XVIIᵉ siècle. Il est finalement retiré par les garde-côtes de la Jamaica Defence Force. La Jamaica Customs Agency saisit aussi périodiquement des artefacts culturels au moment de leur exportation illégale.
Pour les autorités, l’enjeu n’est pas seulement de sauver des objets, mais de préserver des contextes archéologiques qui racontent, par leurs couches de sédiments, une histoire longue, des Taïnos aux planteurs, des Marrons aux ouvriers modernes.
Continuités et réappropriations : Taïnos, Marrons, Rastafari et Nation
L’histoire du pays en Jamaïque est souvent présentée en blocs : Taïnos, colonisation, esclavage, émancipation, indépendance, reggae. Mais sur le terrain, les frontières sont plus floues. Des fils souterrains relient ces périodes et donnent à la Jamaïque contemporaine une identité complexe.
Survivances taïnos et créolisation
Les études génétiques, toponymiques et culturelles montrent que les Taïnos n’ont jamais tout à fait disparu. Outre le vocabulaire resté dans l’anglais et l’espagnol, les pratiques agricoles (comme les buttes de conucos), l’usage des plantes médicinales, certaines recettes ou motifs artistiques témoignent d’une créolisation profonde.
La découverte, en 1992, des Aboukir cemís – objets rituels récupérés par la JNHT et désormais exposés à la National Gallery of Jamaica – illustre ce regain d’intérêt. De même, la mise au jour, en 2023, d’un abri funéraire taïno à Hellshire ouvre de nouvelles pistes sur l’occupation de l’intérieur de l’île par ces populations.
Les communautés Yamaye Taíno structurent leur discours autour de la mémoire et du politique, participant à un mouvement de réaffirmation autochtone dans les Caraïbes. Leur présence est officialisée par une Journée Taïno, des projets muséographiques et des recherches universitaires récentes, visant à ancrer cette histoire dans le patrimoine national.
Les Marrons, entre autonomie et intégration
Les Marrons, de leur côté, continuent de revendiquer un statut semi-souverain fondé sur les traités de 1739–1740. Leurs terres communales restent en grande partie exemptes de taxes ; l’État jamaïcain a toujours évité l’affrontement frontal sur cette question. Néanmoins, des tensions persistent autour de la culture du ganja, ciblée par des opérations policières perçues comme des violations de leur autodétermination.
Le festival du 6 janvier à Accompong commémore la signature du traité de paix avec les colons britanniques. Cet événement majeur, mêlant tradition et tourisme, présente des chants, danses, tambours, plats rituels et récits oraux qui perpétuent une mémoire vivante de la résistance. Les travaux de chercheurs comme Beverley Carey et Mavis Campbell ont démontré l’influence de cette culture marronne sur les mouvements anticoloniaux dans la région, et son rôle jusqu’à la révolution de Saint-Domingue.
Aujourd’hui, des organisations comme le Yamaye Council of Indigenous Leaders, qui rassemble des représentants marrons et taïnos, tentent de penser ensemble ces héritages, sans les opposer.
Reggae, Rastafari et réécriture populaire de l’histoire
Enfin, le rastafarisme et le reggae ont joué un rôle clé dans la relecture populaire de l’histoire jamaïcaine. Là où les manuels scolaires insistaient surtout sur les grandes dates coloniales et l’Empire britannique, la musique a remis au centre les esclaves anonymes, les combattants marrons, les plantations, les prisons, les bidonvilles, les violences politiques, mais aussi l’orgueil noir et le rêve panafricain.
Des artistes de reggae, de Burning Spear et ses albums sur Marcus Garvey aux générations plus récentes comme Chronixx et Damian Marley, utilisent leur musique pour présenter la Jamaïque non comme une périphérie de l’Empire, mais comme un laboratoire central de la liberté et de la pensée noire.
Le fait que le reggae soit aujourd’hui étudié dans les universités, de la University of the West Indies à des campus nord-américains ou européens, au croisement de la musicologie, des études postcoloniales et de l’histoire des religions, montre combien cette production culturelle a déplacé les lignes de la narration historique.
—
L’histoire du pays en Jamaïque, loin d’être figée, continue donc de s’écrire. Dans les grottes ornées des Taïnos, les villages marrons retranchés, les registres d’esclaves, les champs de canne, les rues de Kingston, les studios de Trenchtown et les musées de Kingston ou de Londres, les Jamaïcains trouvent autant de fragments d’un passé parfois douloureux, souvent héroïque, toujours en débat. Entre Xaymaca et la Jamaïque contemporaine, la continuité n’est pas linéaire, mais elle est là : dans la langue, la musique, les luttes sociales, les revendications identitaires et le travail têtu de celles et ceux qui fouillent le sol, les archives et la mémoire pour mieux comprendre d’où vient cette île, et où elle veut aller.
Un retraité de 62 ans, disposant d’un patrimoine financier supérieur à un million d’euros bien structuré en Europe, souhaite transférer sa résidence fiscale en Jamaïque afin d’optimiser sa fiscalité, diversifier ses investissements et conserver un lien fort avec la France. Budget alloué : 10 000 euros pour un accompagnement complet (conseil fiscal, formalités administratives, délocalisation et structuration patrimoniale), sans vente forcée d’actifs.
Après analyse de plusieurs destinations attractives (Portugal, Maurice, Grèce, Chypre), la stratégie retenue consiste à cibler la Jamaïque pour son régime favorable aux revenus étrangers, l’absence d’impôt sur la fortune, la fiscalité avantageuse sur certains investissements internationaux et le coût de vie inférieur à la France. La mission inclut : audit fiscal pré‑expatriation (exit tax, reports d’imposition), obtention d’un permis de résidence via investissement ou achat de résidence principale, coordination avec CNAS/CPAM, transfert de résidence bancaire, plan de rupture des liens fiscaux français (séjour >183 jours en Jamaïque, centre d’intérêts économiques), mise en relation avec un réseau local (avocat, immigration, partenaires francophones/anglophones) et intégration patrimoniale globale.
Vous souhaitez vous expatrier à l'étranger : contactez-nous pour des offres sur mesure.
Décharge de responsabilité : Les informations fournies sur ce site web sont présentées à titre informatif uniquement et ne constituent en aucun cas des conseils financiers, juridiques ou professionnels. Nous vous encourageons à consulter des experts qualifiés avant de prendre des décisions d'investissement, immobilières ou d'expatriation. Bien que nous nous efforcions de maintenir des informations à jour et précises, nous ne garantissons pas l'exhaustivité, l'exactitude ou l'actualité des contenus proposés. L'investissement et l'expatriation comportant des risques, nous déclinons toute responsabilité pour les pertes ou dommages éventuels découlant de l'utilisation de ce site. Votre utilisation de ce site confirme votre acceptation de ces conditions et votre compréhension des risques associés.
Découvrez mes dernières interventions dans la presse écrite, où j'aborde divers sujets.