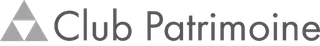Publié le et rédigé par Cyril Jarnias
Publié le et rédigé par Cyril Jarnias
Au cœur du Pacifique sud, le pays aux îles Salomon affiche une histoire beaucoup plus ancienne et plus tourmentée qu’on ne l’imagine en contemplant ses lagons turquoise. Sous les cocotiers et les récifs coralliens, cet archipel de plus de 900 îles porte la trace de 30 000 ans d’occupations humaines, de migrations successives, de chocs coloniaux, de guerres mondiales et de crises politiques récentes. Retracer cette trajectoire, c’est raconter comment de petites sociétés insulaires sont passées des forteresses de pierre de Nusa Roviana aux débats d’un Parlement indépendant, en passant par les canons de Guadalcanal et les expéditions espagnoles à la recherche de l’or du roi Salomon.
Aux origines : un laboratoire de migrations dans le Pacifique
Bien avant l’arrivée des Européens, le pays aux îles Salomon est déjà un carrefour de peuples et de langues. Les recherches archéologiques de ces dernières décennies ont profondément renouvelé l’image d’îles longtemps perçues comme périphériques.
Les premiers habitants : un ancrage de plus de 30 000 ans
Les plus anciennes traces humaines remontent à la fin du Pléistocène. Les premières populations arrivent depuis la Nouvelle-Guinée et l’archipel de Bismarck, probablement par sauts d’île en île à une époque où le niveau marin est plus bas. Buka et Bougainville ne sont alors pas des îles séparées, mais les extrémités d’un même bloc continental relié au sud de l’archipel, souvent désigné par les chercheurs sous le nom de « Greater Bougainville » ou « Greater Solomons ».
Les fouilles de Kilu Cave, sur l’île de Buka, ont livré des vestiges datant d’environ 30 000 à 28 000 ans avant notre ère. Sur d’autres îles proches, comme la Nouvelle-Irlande ou Buka, l’occupation humaine ancienne se situe dans le même ordre de grandeur (plus de 30 000 ans), ce qui confirme l’ancienneté de ce front de colonisation du Pacifique occidental.
Durant les premiers millénaires de peuplement, les populations étaient des chasseurs-cueilleurs mobiles, sans traces de domestication animale ou végétale. Elles étaient capables de traverser des bras de mer sur des embarcations simples, mais ne semblent pas avoir atteint les îles les plus éloignées avant l’arrivée de nouvelles vagues migratoires.
Montée des eaux, fragmentation des terres et nouveaux sites
À partir de 4000–3500 avant notre ère, la remontée des mers met fin à cette époque des « grandes îles » continues. Le vaste bloc qui reliait Buka, Bougainville et le sud de l’archipel se morcelle en dizaines d’îles. C’est dans ce paysage insulaire plus proche de celui que l’on connaît aujourd’hui qu’apparaissent de nouveaux sites d’occupation sur Guadalcanal, notamment les grottes de Poha et de Vatuluma Posovi, datées entre 4500 et 2500 avant notre ère.
Les recherches archéologiques menées en 2010 par le Musée national des îles Salomon et l’Institut archéologique allemand montrent que, vers 6000 ans avant le présent, le niveau marin s’est stabilisé et que les récifs coralliens ont commencé à se développer rapidement, permettant, dans les 2500 dernières années, la formation d’atolls et d’îlots sableux comme Leli au large de Malaita. La géographie actuelle de l’archipel est donc relativement récente à l’échelle de son histoire humaine.
Dans l’archipel du Vanuatu, des sites comme l’abri sous roche de Daighavora, le site de Nu’usi ou encore les îlots de Marapa n’ont pas encore été entièrement explorés par les archéologues. Ces découvertes potentielles indiquent que l’histoire des premiers peuplements de cette région du Pacifique reste ouverte et susceptible d’être réécrite à mesure que de nouvelles recherches sont menées.
Héritages linguistiques et génétiques d’un peuplement très ancien
L’identité de ces premiers habitants n’est pas connue avec précision, mais la linguistique offre un indice puissant : les locuteurs des langues dites « centre-salomoniques » semblent en être les descendants les plus directs. Ce petit groupe linguistique forme une famille à part, sans lien direct avec les autres langues de la région, ce qui laisse penser à un substrat très ancien, antérieur à l’arrivée des langues austronésiennes.
Les études génétiques vont dans le même sens. Dans les îles du nord, les populations forment un ensemble biologique distinct, tout en parlant à la fois des langues austronésiennes et des langues dites papoues. Le fait qu’on ne trouve pas de différence génétique nette entre ces deux groupes linguistiques montre l’intensité des contacts et des mélanges au fil des millénaires. L’haplogroupe du chromosome Y M2-M353, très fréquent dans l’archipel, semble d’ailleurs y avoir émergé il y a environ 9200 ans.
Les généticiens ont également mis en évidence une fracture entre l’ouest et l’est de l’archipel, qui recoupe une limite linguistique bien connue, la ligne de Tryon–Hackman. Cette frontière invisible, perceptible dans la carte des langues, reflète des histoires de migrations et de contacts différentes de part et d’autre des îles.
Un tournant majeur survient vers 1200–800 avant notre ère avec l’arrivée des groupes lapita, issus des Austronésiens. Ces navigateurs au long cours, partis il y a environ 6000 ans du sud de la Chine et de Taïwan avant de passer par les Philippines puis l’Indonésie, atteignent la Nouvelle-Guinée, la Mélanésie et finalement les îles du Sud-Pacifique.
Une expansion « en saut de puce » et un retour vers les grandes îles
Contrairement à une image linéaire d’un peuplement progressif d’île en île, les données linguistiques, génétiques et même… les rats témoignent d’un scénario plus complexe. Les Lapita semblent avoir d’abord « sauté » par-dessus la chaîne principale du pays aux îles Salomon pour gagner directement les îles plus éloignées de Santa Cruz et des Reef Islands, encore plus à l’est. Ce n’est que dans un second temps que des mouvements de « retour » amènent des populations austronésiennes vers les îles plus grandes comme New Georgia, Malaita ou Isabel.
Les céramiques Lapita ont été retrouvées sur cinq archipels distincts du Pacifique.
Les migrations humaines sont d’ailleurs suivies à la trace par un passager inattendu : le rat du Pacifique (Rattus exulans), introduit intentionnellement comme ressource alimentaire. Ses lignées d’ADN mitochondrial dessinent trois grands groupes dans l’ensemble océanien, confirmant un modèle de colonisation complexe, plutôt qu’une expansion simple « en train express » depuis l’Asie.
Un nouveau mode de vie : jardins, porcs et réseaux d’échanges
Avec les Lapita s’installent de nouveaux paysages agraires. Ces groupes, experts en horticulture, introduisent depuis l’Asie du Sud-Est et la Nouvelle-Guinée des plantes comme l’igname, l’aracée, l’arbre à pain ou la canne à sucre, ainsi que des animaux domestiques – porcs, chiens, poulets. Dès environ 3200 ans, les preuves de jardins et d’animaux domestiques se multiplient dans l’archipel.
Les communautés vivent alors dans de petits villages, combinant agriculture de subsistance, exploitation des ressources marines et réseaux d’échanges à longue distance. La plupart des 60 à 70 langues parlées aujourd’hui dans le pays aux îles Salomon appartiennent à la branche océanienne des langues austronésiennes, montrant à quel point cette vague migratoire a durablement marqué le paysage linguistique, tout en se mélangeant avec les populations plus anciennes.
Des forteresses de pierre aux sanctuaires de crânes
À partir de l’an 1000 de notre ère, les vestiges archéologiques témoignent d’une intensification de l’occupation humaine et de la construction de monuments imposants. Dans la province occidentale, autour de New Georgia, se développe la culture de Roviana. On y érige, dès le XIIIᵉ siècle, des complexes mégalithiques comme les sanctuaires de Bao, puis, entre le XIVᵉ et le XIXᵉ siècle, la forteresse de Nusa Roviana et ses autels de pierre.
Les sites de Nusa Roviana et de Vonavona illustrent le rôle politique, religieux et économique de ces centres. Entre le XVIIᵉ et le XIXᵉ siècle, Nusa Roviana devient un carrefour commercial majeur, tandis que la renommée de ses guerriers, connus pour les raids de chasse aux têtes, s’étend dans la région. À Vonavona, l’« île aux crânes » conserve la trace matérielle de ces pratiques où le prestige des chefs se mesurait au nombre de têtes ennemies rapportées.
Les récits européens du XIXᵉ siècle, fascinés et horrifiés, décrivent un archipel où la chasse aux têtes et, dans certains cas, le cannibalisme jouent un rôle social et rituel central. Ces pratiques, souvent caricaturées, sont néanmoins au cœur des dynamiques de pouvoir de l’époque.
Les Espagnols et le mirage de l’or de Salomon
L’histoire écrite du pays aux îles Salomon commence réellement, pour le monde européen, en 1568. Cette année-là, un navigateur espagnol, Álvaro de Mendaña de Neira, appareille depuis le Pérou avec une idée en tête : trouver les terres riches en or d’où, croit-on, le roi biblique Salomon tirait sa fortune.
1568 : Santa Isabel, Guadalcanal et la naissance d’un nom
Le 7 février 1568, Mendaña aperçoit une île qu’il baptise Santa Isabel. Durant la même expédition, il longe et explore d’autres îles majeures de l’archipel : Makira, Guadalcanal, Malaita. Sur Guadalcanal, à l’embouchure de la rivière Mataniko, il trouve quelques paillettes d’or, maigre découverte qui suffira pourtant à nourrir l’imagination. Persuadé d’être sur la trace des mines du roi biblique, il rebaptise l’ensemble « Isles du roi Salomon ». Ce nom, chargé de fantasmes, collera durablement à l’archipel.
Les premiers contacts avec les habitants oscillent entre échanges cordiaux et affrontements meurtriers. Les incompréhensions culturelles, les maladies introduites et la violence mutuelle minent rapidement les relations.
Mendaña rentre au Pérou en août 1568, sans s’implanter durablement dans l’archipel. Mais il ne renonce pas.
Álvaro de Mendaña
1595 : tentative de colonisation et échec sanglant
En 1595, il repart avec une expédition plus importante, cette fois avec un objectif clair de colonisation. L’escadre atteint Nendö, dans les îles Santa Cruz, et fonde un petit établissement à la baie de Gracioso, le 21 septembre. Les débuts sont difficiles : maladies, tensions internes, heurts avec les populations locales. En l’espace de quelques mois, l’entreprise s’effondre. Mendaña lui-même meurt le 18 octobre 1595. Son second, Pedro Fernandes de Queirós, prend le commandement et, devant la situation catastrophique, décide d’abandonner la colonie le 18 novembre pour gagner les Philippines.
Des indices laissent penser que des rescapés ont malgré tout touché la côte nord de Makira, vers Pamua, mais le rêve espagnol d’une Nouvelle Castille du Pacifique s’évanouit.
Queirós reviendra en 1606 dans la région, apercevant Tikopia et Taumako, mais son expédition vise surtout les îles plus au sud (actuel Vanuatu) dans la quête insensée d’un continent austral mythique.
Deux siècles d’oubli relatif
Après ces aventures avortées, l’archipel retombe pour plus d’un siècle dans un relatif oubli européen. Seule exception, le passage lointain du Hollandais Abel Tasman, qui aperçoit l’atoll d’Ontong Java en 1648. Il faut attendre la seconde moitié du XVIIIᵉ siècle pour que les « îles de Salomon » resurfacent sur les cartes.
Entre 1767 et 1769, plusieurs expéditions européennes explorent les îles Salomon. Le Britannique Philip Carteret longe Santa Cruz et Malaita en 1767. L’année suivante, le Français Louis-Antoine de Bougainville atteint et nomme les îles Choiseul et Bougainville. En 1769, un autre Français, Jean-François-Marie de Surville, redécouvre les îles Isabel, Ulawa, Makira et Santa Ana. Par la suite, le naufrage de l’expédition de La Pérouse à Vanikoro, plus au sud, est élucidé en 1826 par le marchand Peter Dillon, qui identifie des objets de l’expédition à Tikopia, découverte ensuite confirmée par Jules Dumont d’Urville.
Au tournant du XIXᵉ siècle, géographes et cartographes réalisent que ces navigations successives redécouvrent, en réalité, les anciennes îles de Mendaña.
Baleiniers, trafiquants de sandale et premiers missionnaires
À partir de la fin du XVIIIᵉ siècle, le pays aux îles Salomon s’inscrit peu à peu dans les circuits économiques globaux. Les premiers visiteurs réguliers ne sont pas des administrateurs coloniaux, mais des baleiniers britanniques, américains ou australiens venus chercher eau, vivres, bois… et parfois des marins locaux pour leurs équipages.
Les échanges avec les populations insulaires sont ambivalents, mêlant commerce (nourriture, objets, travail) et violences réciproques. L’introduction de maladies européennes cause des ravages. L’acquisition d’armes à feu par les groupes côtiers leur donne un ascendant sur les peuples de l’intérieur, modifiant durablement les équilibres de pouvoir locaux.
Au XIXᵉ siècle, les marchands de santal et de bêche-de-mer (holothuries) se multiplient. Ils installent parfois des comptoirs semi-permanents, notamment à partir des années 1840 depuis les actuelles Vanuatu. Benjamin Boyd tente même, en 1851, de fonder une colonie européenne sur Guadalcanal, sans succès.
C’est également à cette époque que des habitants du pays aux îles Salomon commencent à voyager bien au-delà de leur archipel, embarquant comme marins ou domestiques sur les navires baleiniers ou marchands. On retrouve ainsi un homme originaire de Makira travaillant comme batelier dans le port de Sydney à la fin du XIXᵉ siècle.
« Blackbirding » : la traite des corps dans le Pacifique
Entre les années 1840 et le début du XXᵉ siècle, une autre forme de contact, beaucoup plus brutale, marque profondément la mémoire des îles : la traite de main-d’œuvre dite de « blackbirding ». Des recruteurs – parfois officiels, souvent pirates – embarquent des milliers d’hommes, et parfois de femmes et d’enfants, pour les plantations de canne à sucre du Queensland, celles de Fiji ou de Samoa.
Entre 1870 et 1910, environ 30 000 habitants des îles Salomon ont été déportés vers d’autres îles du Pacifique ou vers l’Australie.
Cette histoire sombre, racontée plus tard par des auteurs comme Joe Melvin ou Jack London, contribue à la volonté britannique d’installer un cadre juridique dans la région. Les missionnaires, qui commencent à s’implanter durablement à partir des années 1840–1850, jouent également un rôle clé dans la dénonciation des abus.
Missions chrétiennes : échecs sanglants et patient enracinement
L’entreprise missionnaire vers le pays aux îles Salomon est l’une des plus longues et des plus mouvementées du Pacifique.
Les premiers catholiques, un fiasco dramatique
En 1845, un premier groupe de missionnaires catholiques maristes, commandé par l’évêque Jean‑Baptiste Epalle, débarque sur Makira puis Santa Isabel. L’entreprise tourne rapidement au drame. Epalle est tué peu après son arrivée à Astrolabe Harbour. Les survivants tentent de se réimplanter sur Makira, mais les maladies – notamment le paludisme –, les conflits avec des marins européens et les tensions locales ont raison de leurs forces. En quelques années, neuf missionnaires meurent. Les tentatives ultérieures à Makira, Woodlark ou Tikopia échouent aussi, certains religieux disparaissant même en mer. Au début des années 1850, Rome renonce à toute nouvelle tentative dans la région pour plusieurs décennies.
Les Anglicans et les « écoles de Nouvelle-Zélande »
Pendant ce temps, la mission anglicane adopte une autre stratégie. À partir des années 1850, elle emmène de jeunes insulaires dans des écoles de formation en Nouvelle-Zélande, avant de les renvoyer comme catéchistes ou auxiliaires religieux. À partir des années 1870, les Anglicans commencent à s’installer de façon plus durable dans l’archipel. D’autres Églises protestantes, comme les Méthodistes et les Adventistes, suivent, chacune ouvrant ses propres écoles, dispensaires et postes missionnaires.
Les relations entre missions catholiques, méthodistes et adventistes ne sont pas toujours pacifiques. Dans certaines îles, elles entrent en rivalité, se disputant les terres et les convertis, ce qui peut nuire aux communautés locales prises dans cette compétition.
Le retour des catholiques et la montée en puissance des missions
À la fin du XIXᵉ siècle, les circonstances politiques et ecclésiastiques changent. De nouvelles congrégations, notamment les Missionnaires du Sacré-Cœur et la Société du Verbe Divin, se partagent la Mélanésie et la Micronésie. À partir de 1898, les maristes catholiques reviennent dans le sud de l’archipel, installant des postes sur Guadalcanal (à Rua Sura, Avuavu, Tangarare, puis Visale), Makira, Malaita ou encore dans les Shortlands.
Les missionnaires catholiques ont développé une infrastructure importante sur l’archipel, marquant le paysage par des constructions durables et un engagement humain significatif.
Création d’écoles, de couvents, de dispensaires et parfois de véritables villages missionnaires, structurant le territoire.
Achevée en 1910, cette église en pierre était alors le seul bâtiment en dur de tout l’archipel, symbole de pérennité.
En 1914, la mission comptait déjà plusieurs dizaines de prêtres et de religieuses œuvrant sur l’île de Guadalcanal.
Les protestants suivent une dynamique comparable. Les Adventistes, par exemple, développent à Batuna un centre combinant école, imprimerie et clinique, et s’appuient sur des bateaux de mission comme la Melanesia ou l’Advent Herald pour rayonner dans les lagons de Marovo et au-delà. La musique et le chant sont des outils d’évangélisation puissants, souvent mentionnés par les habitants comme ce qui les a d’abord attirés.
Au fil du XXᵉ siècle, les missions prennent en charge l’essentiel de l’éducation, de la santé et des services sociaux dans le pays aux îles Salomon, jouant un rôle beaucoup plus concret que l’administration coloniale elle-même.
Protectorat britannique : entre pacification, plantations et révoltes
Alors que les missionnaires quadrillent le terrain, les grandes puissances européennes se partagent la carte. En 1884, l’Allemagne annexe la Nouvelle‑Guinée nord et l’archipel de Bismarck, puis étend en 1886 son contrôle sur les îles du nord de l’archipel salomonien (Bougainville, Buka, Choiseul, Santa Isabel, Shortlands, Ontong Java). Un accord avec la Grande‑Bretagne formalise des « sphères d’influence », au nord pour Berlin, au sud pour Londres.
1893 : naissance du protectorat britannique
Face aux abus de la traite de main-d’œuvre, à la pression missionnaire et à la crainte de voir la France s’intéresser à l’archipel, Londres décide de passer à l’action. En mars 1893, le capitaine Herbert Gibson, commandant le HMS Curacoa, proclame le protectorat britannique sur les îles du sud – New Georgia, Malaita, Guadalcanal, Makira, Mono et les Nggela. C’est la naissance officielle du « British Solomon Islands Protectorate ».
Au tournant du siècle, l’ensemble des îles, à l’exception de Bougainville et Buka restées allemandes, passent sous contrôle britannique. Le siège de l’administration est installé à Tulagi, sur une petite île du centre de l’archipel. Charles Morris Woodford, ancien naturaliste et explorateur, devient le premier résident-commissaire en 1897. Il reçoit pour mission de réprimer la traite de main-d’œuvre, de contrôler le commerce des armes et d’instaurer un semblant d’ordre.
Pacification armée et exploitation des terres
L’administration coloniale est minuscule et mal financée. Les débuts sont marqués par des tensions permanentes. Les attaques contre des colons ou des missionnaires provoquent des expéditions punitives menées par la Royal Navy : villages incendiés, pirogues brûlées, chefs exécutés. Arthur Mahaffy, nommé commissaire adjoint à Gizo en 1898, se voit confier la tâche explicite de réprimer la chasse aux têtes dans la région de New Georgia.
Dans le même temps, Londres veut que le protectorat s’autofinance. Des règlements fonciers cherchent à déclarer certaines terres « vacantes » pour les attribuer à des compagnies de plantation, en contradiction totale avec la coutume mélanésienne où la notion de « terre vide » n’existe pas. De grandes firmes comme Levers Pacific Plantations (filiale de Lever Brothers) ou la Malayta Company acquièrent ainsi de vastes concessions pour y développer des plantations de cocotiers destinés à la production de coprah.
Les exportations de coprah sont passées à plus de 4000 tonnes en 1912-1913, marquant une forte croissance par rapport à 1903-1904.
Pour limiter l’aliénation des terres, un règlement de 1914 met théoriquement fin à la vente libre de terres indigènes et généralise le bail pour les plantations. Malgré cela, les tensions foncières persistent.
Une colonisation à bas régime, un pouvoir éclaté
Pendant toute la période coloniale, la présence européenne reste numériquement faible. En 1902, on ne compte qu’environ 80 Européens permanents. La plupart sont planteurs, commerçants ou missionnaires. L’administration proprement dite reste légère, s’appuyant sur un réseau de policiers indigènes, de chefs reconnus ou nommés et sur l’autorité, parfois arbitraire, des commissaires de district.
Comme le montre le drame de Malaita en 1927 – l’assassinat du commissaire William R. Bell par le chef Kwaio Basiana lors de la collecte d’un impôt capitaire – les incompréhensions et ressentiments sont profonds. La répression qui suit, parfois qualifiée de « massacre de Malaita », fait au moins 60 morts kwaio, détruit des sanctuaires sacrés et envoie près de 200 personnes dans les geôles de Tulagi. Basiana est pendu publiquement l’année suivante. Pour beaucoup d’habitants, cet épisode restera le symbole d’un pouvoir colonial violent et lointain.
Tableau : quelques jalons de la période coloniale
| Période / année | Événement clé |
|---|---|
| 1884–1886 | Annexion allemande au nord, accord de sphères d’influence avec la Grande‑Bretagne |
| 1893 | Proclamation du protectorat britannique sur les îles du sud |
| 1897 | Charles Morris Woodford nommé résident‑commissaire, capitale à Tulagi |
| 1898–1900 | Extension du protectorat à de nouvelles îles ; cession allemande des îles nord (sauf Bougainville, Buka) |
| 1900–1913 | Expansion rapide des plantations de coprah et arrivée de grandes compagnies |
| 1914 | Règlement foncier instaurant le bail, fin des ventes libres de terres |
| 1927–1928 | Assassinat de William R. Bell, répression violente à Malaita |
La Seconde Guerre mondiale : Guadalcanal, pivot du Pacifique
L’archipel, jusque-là périphérique pour les grandes puissances, se retrouve soudain en première ligne durant la Seconde Guerre mondiale. Après l’attaque de Pearl Harbor par le Japon en décembre 1941, la progression nippone dans le Pacifique sud est fulgurante. En mai 1942, les Japonais occupent Tulagi et une partie de l’ouest de l’archipel, dont Guadalcanal, où ils commencent à construire une grande piste d’aviation.
Guadalcanal : l’affrontement décisif
Les États‑Unis et leurs alliés réagissent rapidement. Le 7 août 1942, les Marines débarquent à la fois à Tulagi, sur les îles Florida voisines, et sur la côte nord de Guadalcanal. L’objectif est clair : s’emparer de l’aérodrome en construction, futur Henderson Field, qui menace les lignes de communication entre les États‑Unis, l’Australie et la Nouvelle‑Zélande.
Pendant la bataille de Guadalcanal, la zone maritime au nord de l’île, où se sont déroulés des combats acharnés pendant des mois, a été surnommée « Iron Bottom Sound » (le Détroit du Fond de Fer) en raison du nombre très élevé de navires de guerre coulés, laissant le fond parsemé d’épaves. Ce surnom illustre la férocité et l’intensité des engagements navals durant cette campagne majeure de la guerre du Pacifique.
Les Japonais tentent à plusieurs reprises de reprendre la piste, appuyés par des convois nocturnes de ravitaillement – le fameux « Tokyo Express ». En octobre 1942, une grande offensive terrestre contre le périmètre de Henderson échoue au prix de pertes humaines considérables. En mer, la bataille navale de Guadalcanal, en novembre, scelle le sort de la campagne. En février 1943, le commandement nippon ordonne l’évacuation discrète de ses dernières troupes de l’île.
Les chiffres des pertes, variables selon les sources, restent vertigineux. On évoque plus de 7000 morts, 29 navires et plus de 600 avions perdus côté allié pour l’ensemble de la campagne des îles Salomon ; et plus de 30 000 morts, 38 à 50 navires et jusqu’à 1500 avions côté japonais si l’on inclut l’ensemble des opérations jusqu’à Bougainville.
Rôle des habitants : éclaireurs, porteurs, sauveteurs
Les habitants du pays aux îles Salomon ne sont pas de simples spectateurs. Environ 3200 hommes servent dans le Solomon Islands Labour Corps, effectuant des travaux pour l’effort de guerre allié, tandis que quelque 6000 autres rejoignent la British Solomon Islands Protectorate Defence Force.
Surtout, de nombreux insulaires participent au réseau des « coastwatchers », un système d’observation monté par les Alliés qui s’appuie sur des missionnaires, des planteurs, des fonctionnaires et des villageois pour repérer les mouvements ennemis, signaler les naufragés ou guider les patrouilles. L’amiral américain William « Bull » Halsey saluera plus tard le rôle décisif de ces informateurs.
L’amiral américain William « Bull » Halsey
L’épisode le plus célèbre est sans doute le sauvetage de l’équipage du PT‑109, le bateau rapide commandé par le jeune officier John F. Kennedy, futur président des États‑Unis. Lorsque leur navire est percuté et coulé par un destroyer japonais en août 1943, Kennedy et ses hommes parviennent à gagner un îlot. Ce sont deux hommes de l’archipel, Biuku Gasa et Eroni Kumana, qui les trouvent, acheminent un message gravé sur une noix de coco et permettent leur récupération par les forces alliées. Des décennies plus tard, la noix de coco gravée trônera sur le bureau de Kennedy à la Maison-Blanche.
Tulagi détruite, Honiara naît
Au terme de la campagne, Tulagi, l’ancienne capitale coloniale, est ravagée. La ville n’est pas reconstruite. À l’inverse, sur Guadalcanal, autour d’Henderson Field et des installations logistiques américaines, une nouvelle agglomération s’est développée : Honiara. Sa position sur une plaine côtière, dotée d’une piste aérienne et de bâtiments déjà existants, en fait un choix naturel pour devenir, en 1952, la nouvelle capitale du territoire.
La Seconde Guerre mondiale a profondément transformé la société des Îles Salomon. Les insulaires ont été exposés à de nouvelles formes d’organisation sociale, à une économie monétaire élargie, ainsi qu’à des niveaux de rémunération et une logistique jusqu’alors inconnus. Pour de nombreux vétérans, cette expérience a rendu impossible un retour à la soumission silencieuse envers les autorités coloniales d’avant-guerre.
Enfin, la guerre laisse un héritage matériel lourd : des milliers de munitions, bombes et obus non explosés parsèment encore aujourd’hui les forêts et les lagons, créant un risque permanent pour les populations et compliquant les projets de développement.
De la « Marche » à l’indépendance : mouvements autochtones et décolonisation
L’immédiat après‑guerre voit émerger des mouvements politiques indigènes inédits, nourris par l’expérience militaire, les idées circulant dans le Pacifique et les frustrations accumulées depuis des décennies.
Maasina Rule : l’aspiration à l’auto‑gouvernement
Entre 1943 et 1944, sur Malaita, les chefs Aliki Nono’ohimae et Hoasihau lancent un mouvement connu sous le nom de « Maasina Ruru » ou « Maasina Rule » (souvent traduit par « Marche » ou « Règle fraternelle »). Ils veulent améliorer la situation économique des autochtones, renforcer leur autonomie face à l’administration coloniale et structurer un pouvoir indigène capable de négocier d’égal à égal.
Le mouvement trouve un écho particulier auprès des anciens du Labour Corps, revenus des bases alliées avec une vision différente du monde. Il s’étend à d’autres îles, se dote de comités locaux, collecte son propre impôt, organise des refus de travail et de participation aux projets coloniaux.
Alarmée, l’administration lance en 1947–1948 l’« Opération De‑Louse ». Les leaders sont arrêtés, emprisonnés, jugés. Loin de s’éteindre, le mouvement se transforme en campagne de désobéissance civile. Les prisons se remplissent de militants.
Année du transfert officiel de la capitale des îles Salomon à Honiara, marquant un nouveau départ symbolique.
Vers des institutions représentatives
Dans les années 1950, Londres encourage la mise en place de conseils locaux et d’organes consultatifs. En 1960, des Conseils exécutif et législatif sont créés, d’abord entièrement nommés, puis progressivement ouverts à des représentants élus. En 1964, Honiara élit son premier représentant ; en 1967, la plupart des quinze sièges du Conseil législatif deviennent soumis au suffrage.
Une nouvelle constitution en 1970 regroupe Conseils législatif et exécutif en un seul « Governing Council ». Mais le gouverneur britannique conserve des pouvoirs très étendus, jugés excessifs par de nombreux Solomon Islanders. Une réforme en 1974 introduit un modèle proche du système de Westminster, avec un Conseil des ministres et un poste de « Chief Minister ». Solomon Mamaloni devient le premier titulaire de cette fonction en juillet 1974.
Lentement mais sûrement, l’archipel passe d’une administration coloniale dirigée depuis Suva, à Fidji, à un système de gouvernement où les responsables locaux sont aux commandes.
Le difficile chemin vers l’indépendance
Plusieurs facteurs accélèrent la perspective d’indépendance. La vague de décolonisation dans le Pacifique – notamment l’accession de la Papouasie‑Nouvelle‑Guinée à l’indépendance en 1975 – joue un rôle d’exemple. La crise pétrolière de 1973 change aussi la donne : la Grande‑Bretagne, en difficulté économique, se montre de plus en plus réticente à financer des territoires éloignés.
En 1975, le territoire abandonne officiellement la mention « British » pour devenir « The Solomon Islands », puis simplifie son nom en « Solomon Islands » lors de l’indépendance. Cette même année, des discussions constitutionnelles approfondies sont engagées entre Londres et Honiara.
En janvier 1976, une large autonomie interne est accordée. Peter Kenilorea, figure clé du mouvement indépendantiste, devient Chief Minister. Une conférence décisive se tient à Londres en 1977, où il est décidé que l’indépendance formelle interviendrait l’année suivante.
Le 7 juillet 1978, le pays aux îles Salomon devient un État souverain, membre du Commonwealth, sous le régime de monarchie constitutionnelle. La reine Élisabeth II en est le chef d’État symbolique, représentée par un gouverneur général. Sir Peter Kenilorea devient le premier Premier ministre, tandis que Baddeley Devesi occupe le fauteuil de gouverneur général. Le duc de Gloucester représente la couronne britannique lors des cérémonies.
Toutes les provinces n’accueillent pas cette indépendance avec le même enthousiasme. Dans l’Ouest, un mouvement dit de « Western Breakaway » exprime sa crainte d’être marginalisé dans un État dominé par Honiara et Malaita. La province boycotte même les cérémonies à Gizo, scène d’un incident lors de la levée du nouveau drapeau.
Tableau : principales étapes vers l’indépendance
| Année | Étape institutionnelle ou politique |
|---|---|
| 1960 | Création de Conseils exécutif et législatif (nommés) |
| 1964–1967 | Introduction, puis extension, de la représentation élue |
| 1970 | Constitution instaurant un Governing Council |
| 1974 | Nouvelle constitution, création du poste de Chief Minister |
| 1975 | Changement officiel du nom en « The Solomon Islands » |
| 1976 | Large autonomie interne, Kenilorea devient Chief Minister |
| 1977 | Conférence constitutionnelle à Londres, décision d’indépendance |
| 7 juillet 1978 | Indépendance, Peter Kenilorea Premier ministre, Baddeley Devesi gouverneur général |
Après l’indépendance : un État jeune face aux inégalités et aux tensions
L’indépendance ne règle pas d’un coup les problèmes structurels hérités de la colonisation : fortes disparités régionales, dépendance économique à quelques produits d’exportation, défis de gouvernance dans un archipel fragmenté, tensions foncières anciennes et récentes.
Construction de l’État et cycles politiques
Les premières décennies voient une alternance de gouvernements dirigés par quelques figures récurrentes : Peter Kenilorea, Solomon Mamaloni, Ezekiel Alebua, Francis Billy Hilly, Bartholomew Ulufa’alu, Manasseh Sogavare, Allan Kemakeza, puis d’autres. Les coalitions parlementaires sont fragiles, les motions de censure fréquentes, les partis politiques peu ancrés. Les gouvernements successifs tentent de doter le pays d’institutions économiques modernes – création d’une banque centrale, d’une compagnie aérienne nationale –, tout en gérant les pressions de compagnies étrangères dans les secteurs du bois, du poisson, de l’huile de palme ou de l’or.
Parallèlement, les provinces revendiquent davantage de pouvoir. Dans l’Ouest, le Western Breakaway Movement continue de plaider pour un système fédéral qui garantirait une autonomie provinciale forte, dénonçant ce qu’il perçoit comme une forme de « colonialisme interne » exercé par le gouvernement central.
Une économie fragile, dépendante des ressources naturelles
L’économie reste étroite et très dépendante de quelques filières : coprah, cacao, huile de palme, bois, pêche et, plus récemment, mines. À l’indépendance, le coprah représente environ un quart des recettes d’exportation, mais sa production décline ensuite. Le vide est en partie comblé par le bois, dont les exportations grimpent en flèche dans les années 1980–1990 au point de devenir la première source de devises. Les taux d’abattage dépassent largement les niveaux durables – jusqu’à 19 fois ceux recommandés selon certaines estimations, faisant craindre l’épuisement des forêts commerciales avant la fin des années 2020.
La pêche, notamment de thon, est un pilier économique avec une conserverie à Noro, mais l’essentiel des prises est exporté congelé vers l’Asie pour transformation. Les projets miniers des années 1990, comme la mine d’or de Gold Ridge et l’exploitation de bauxite sur Rennell, génèrent d’importants revenus mais causent aussi des dégâts environnementaux massifs, des conflits fonciers et des scandales de corruption.
Pour l’immense majorité de la population – plus de 75 % des actifs –, la subsistance reste fondée sur l’agriculture vivrière (patate douce, manioc, taro, ignames, bananes), la pêche côtière et, dans certaines régions, l’élevage de porcs ou de volailles. La monnaie traditionnelle en coquillage fabriquée notamment à Malaita continue d’être utilisée dans certaines transactions cérémonielles et même dans une partie des échanges commerciaux locaux.
Les « tensions » : quand les fractures éclatent au grand jour
La crise la plus grave de l’ère post‑indépendance éclate à la fin des années 1990. Sur l’île de Guadalcanal, les habitants autochtones (souvent appelés « Guale ») voient avec inquiétude la croissance rapide de Honiara, la pression sur les terres près de la capitale et l’arrivée massive de migrants originaires de Malaita, une île densément peuplée.
Les griefs vont du sentiment d’expropriation foncière à l’impression que les emplois, les contrats et les bénéfices du développement profitent largement aux Malaitans. Vers la fin de 1998, un groupe armé, d’abord présenté comme l’Armée révolutionnaire de Guadalcanal puis rebaptisé Isatabu Freedom Movement (IFM), commence à intimider et attaquer des Malaitans vivant en dehors de Honiara. En quelques mois, des milliers de personnes fuient, certaines vers la capitale, d’autres vers Malaita.
En réaction, des Malaitans organisent la Malaita Eagle Force (MEF) pour défendre leurs communautés, notamment à Honiara. En 1999, le gouvernement de Bartholomew Ulufa’alu proclame l’état d’urgence et sollicite l’aide de l’Australie et de la Nouvelle‑Zélande, qui déclinent d’intervenir militairement à ce stade. La Honiara Peace Accord de juin 1999 n’apporte qu’un répit temporaire.
Le 5 juin 2000, la MEF, désormais bien armée après la prise de dépôts de police, mène un coup de force à Honiara. Les miliciens prennent le contrôle du Parlement, retiennent le Premier ministre Ulufa’alu et exigent sa démission. Ce dernier finit par céder. Le 30 juin, le Parlement élit Manasseh Sogavare comme nouveau chef de gouvernement.
Malgré la signature, en octobre 2000, du Townsville Peace Agreement entre la MEF, des éléments de l’IFM et l’État, puis d’un accord spécifique à Marau en février 2001, la violence se poursuit, notamment dans la région de la Weathercoast au sud de Guadalcanal, où un chef guadalcanalien, Harold Keke, refuse tout compromis. Les forces de police, souvent infiltrées par les factions armées, peinent à rétablir l’ordre. Des enlèvements, extorsions et règlements de compte se multiplient. Des religieux, dont sept membres de la Fraternité mélanésienne en 2003, sont assassinés sur la Weathercoast.
On estime que le conflit, généralement appelé « the tensions », fait environ 100 à 200 morts directs et déplace jusqu’à 30 000 personnes. L’économie, déjà fragilisée par la baisse des cours du bois et l’endettement, s’effondre littéralement. En 2001, près de la moitié des dépenses publiques sont financées par l’aide extérieure, et l’État est au bord de la faillite.
RAMSI : une intervention régionale inédite
En 2003, après la victoire électorale d’Allan Kemakeza, le gouvernement se résout à demander officiellement l’aide internationale via le Forum des îles du Pacifique. Une mission régionale, la Regional Assistance Mission to Solomon Islands (RAMSI), dominée par l’Australie mais incluant des forces de police et de défense de plusieurs États océaniens (Nouvelle‑Zélande, Papouasie‑Nouvelle‑Guinée, Fidji, etc.), est déployée en juillet 2003.
RAMSI combine présence policière, appui militaire, réforme du secteur de la justice et assistance budgétaire. L’arrivée de cette force multinationale change rapidement la donne : des milliers d’armes sont collectées, les principaux chefs de milices sont arrêtés, dont Harold Keke qui se rend en août 2003. La sécurité est rétablie à Honiara et progressivement dans les provinces. Sur le plan politique, la mission facilite le fonctionnement régulier des institutions et pousse à des réformes de gouvernance.
La composante militaire de RAMSI se retire en 2013, la mission civile étant officiellement close en 2017. Le bilan est contrasté – certains pointent une dépendance accrue vis‑à‑vis de l’extérieur, d’autres la négligence des causes profondes du conflit –, mais la plupart des observateurs reconnaissent que sans cette intervention, l’État risquait l’effondrement pur et simple.
Crises récurrentes et recomposition des alliances
Les années 2000–2020 voient se succéder d’autres épisodes de tension et de recomposition politique, dans un contexte marqué par des scandales de corruption, des rivalités géopolitiques croissantes et des fragilités socio‑économiques persistantes.
Riots, changement de cap diplomatique et rivalité sino‑taïwanaise
En 2006, après des élections très disputées, la nomination de Snyder Rini comme Premier ministre déclenche des émeutes violentes à Honiara, ciblant en particulier le quartier chinois de la capitale. Des commerces sont pillés, des bâtiments incendiés, plus de 1000 personnes, principalement d’origine chinoise, sont contraintes de fuir. Rini démissionne au bout de huit jours. Manasseh Sogavare revient alors au pouvoir à la tête d’une coalition dite Grand Coalition for Change Government. Il sera cependant renversé par une motion de censure en 2007.
Une décennie plus tard, en 2019, une décision stratégique majeure fait basculer l’archipel dans le cœur de la rivalité sino‑américaine. Le gouvernement de Sogavare rompt les relations diplomatiques avec Taïwan, qui soutenait le pays depuis 36 ans, et reconnaît la République populaire de Chine. Pékin s’engage rapidement dans des projets d’infrastructures, tandis que des fonds chinois sont accusés par certains de nourrir des clientélismes locaux.
La province de Malaita, sous l’autorité du Premier ministre provincial Daniel Suidani, s’oppose au revirement diplomatique national et maintient son alignement avec Taïwan et les États-Unis. Cette position se concrétise par un programme d’aide substantiel de Washington et par l’organisation, en 2020, d’un référendum d’indépendance provincial symbolique, déclaré illégal par le gouvernement central des Îles Salomon.
Dans ce climat tendu, marqué aussi par la pandémie de COVID‑19, les inégalités sociales et le manque d’emplois, une nouvelle vague de protestations éclate en novembre 2021. Parties de Malaita, des manifestations pacifiques à Honiara dégénèrent rapidement en émeutes. Des bâtiments sont incendiés près du Parlement, le quartier chinois est de nouveau pris pour cible. Le gouvernement fait appel à l’Australie en vertu d’un traité bilatéral de sécurité signé en 2017, et d’autres pays du Pacifique (Papouasie‑Nouvelle‑Guinée, Fidji, Nouvelle‑Zélande) envoient des forces de maintien de l’ordre.
Un accord de sécurité entre la Chine et les Îles Salomon autorise le déploiement de forces chinoises sur demande. Bien que le gouvernement salomonais nie tout projet de base militaire, cet accord suscite de vives inquiétudes chez l’Australie, la Nouvelle-Zélande et les États-Unis, qui y perçoivent un changement dans l’équilibre stratégique de la région Pacifique.
Vérité, réconciliation et défis de gouvernance
Pour tenter de solder l’héritage des tensions de 1998–2003, un processus de vérité et de réconciliation est lancé à la fin des années 2000. Une Commission Vérité et Réconciliation, inspirée de l’expérience sud‑africaine, mène des auditions dans les années 2010 et remet un rapport détaillé au gouvernement en 2012. Longtemps resté confidentiel, ce document ne sera rendu public que par des voies officieuses quelques années plus tard.
Les recommandations de la Commission, portant sur la réforme foncière, la lutte contre la corruption, la prise en compte des griefs provinciaux, restent en partie lettre morte. Le pays demeure confronté à des problèmes de gouvernance : partis politiques faibles, coalitions parlementaires instables, motions de censure fréquentes, influence disproportionnée de quelques groupes économiques, y compris étrangers, dans les secteurs clés (forêt, mines, pêche).
Les inégalités de genre et la violence faite aux femmes restent aussi des défis majeurs : sur 50 membres du Parlement, seules quelques femmes parviennent à se faire élire, tandis que la participation des femmes aux processus de décision en matière de sécurité ou de gestion des conflits demeure marginale.
Un archipel ancien à la croisée des chemins
L’histoire du pays aux îles Salomon est celle d’un archipel qui, depuis 30 000 ans, compose avec la distance, la mer et la diversité. Les premiers chasseurs‑cueilleurs du Pléistocène, les navigateurs Lapita, les guerriers de Roviana, les missionnaires venus de France, d’Angleterre ou d’Australie, les commissaires coloniaux, les soldats japonais et américains de Guadalcanal, les leaders de Maasina Rule, les miliciens de la MEF et de l’IFM, les représentants actuels débattant des alliances avec Pékin, Canberra ou Taipei : tous ont, à leur manière, façonné ce chapelet d’îles.
L’archipel fait face à un cumul de crises : vulnérabilité extrême au changement climatique et aux catastrophes naturelles, dégradation environnementale (déforestation, épuisement des ressources halieutiques), pression démographique avec l’urbanisation rapide autour de Honiara, instabilité politique, ingérence croissante des puissances étrangères, et la menace persistante des engins non explosés datant de la Seconde Guerre mondiale.
Mais il dispose aussi d’atouts uniques : une mosaïque culturelle et linguistique d’une richesse exceptionnelle, des systèmes coutumiers de gestion des terres toujours vivants, des Églises fortement implantées, un héritage historique de réseaux interinsulaires et de pratiques de médiation qui, malgré les conflits récents, restent une ressource pour l’avenir.
À l’heure où l’archipel tente de concilier traditions et exigences d’un État moderne pris dans les turbulences géopolitiques du XXIᵉ siècle, comprendre la profondeur de son histoire – des grottes de Kilu à la bataille de Guadalcanal, de Maasina Rule aux accords de sécurité contemporains – est essentiel pour saisir les dilemmes qui se jouent aujourd’hui sur ses rivages.
Un retraité de 62 ans, avec un patrimoine financier supérieur à un million d’euros bien structuré en Europe, souhaitait changer de résidence fiscale pour optimiser sa charge imposable et diversifier ses investissements, tout en maintenant un lien fort avec la France. Budget alloué : 10 000 euros pour l’accompagnement complet (conseil fiscal, formalités administratives, délocalisation et structuration patrimoniale), sans vente forcée d’actifs.
Après analyse de plusieurs destinations attractives (Îles Salomon, Grèce, Chypre, Maurice), la stratégie retenue a consisté à cibler les Îles Salomon pour leur fiscalité très favorable sur les revenus étrangers, l’absence d’impôt sur la fortune, un coût de vie nettement inférieur à la France et un environnement anglophone facilitant les échanges financiers internationaux. La mission a inclus : audit fiscal pré‑expatriation (exit tax ou non, report d’imposition), obtention de la résidence avec achat d’un bien principal, structuration de la couverture santé internationale, transfert de la résidence bancaire vers une juridiction adaptée, plan de rupture des liens fiscaux français (183 jours/an hors de France, centre des intérêts économiques), mise en relation avec un réseau local (avocat, immigration, prestataires bilingues) et restructuration patrimoniale internationale pour optimiser revenus, protection et transmission.
Vous souhaitez vous expatrier à l'étranger : contactez-nous pour des offres sur mesure.
Décharge de responsabilité : Les informations fournies sur ce site web sont présentées à titre informatif uniquement et ne constituent en aucun cas des conseils financiers, juridiques ou professionnels. Nous vous encourageons à consulter des experts qualifiés avant de prendre des décisions d'investissement, immobilières ou d'expatriation. Bien que nous nous efforcions de maintenir des informations à jour et précises, nous ne garantissons pas l'exhaustivité, l'exactitude ou l'actualité des contenus proposés. L'investissement et l'expatriation comportant des risques, nous déclinons toute responsabilité pour les pertes ou dommages éventuels découlant de l'utilisation de ce site. Votre utilisation de ce site confirme votre acceptation de ces conditions et votre compréhension des risques associés.
Découvrez mes dernières interventions dans la presse écrite, où j'aborde divers sujets.