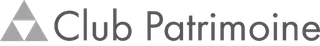Publié le et rédigé par Cyril Jarnias
Publié le et rédigé par Cyril Jarnias
Au Kenya, l’histoire ne se lit pas seulement dans les archives coloniales ou les mémoires politiques. Elle affleure partout : dans les outils en pierre du Turkana, les murailles sèches de Thimlich Ohinga, les portes sculptées de Lamu, les rails de la ligne Mombasa–Kisumu, les tranchées creusées pendant l’insurrection Mau Mau, ou encore dans les articles de la Constitution de 2010. Retracer l’histoire du pays au Kenya, c’est donc parcourir un arc de temps qui va des premiers hominidés à l’un des processus constitutionnels les plus débattus d’Afrique contemporaine.
Des origines préhistoriques : un berceau pour l’humanité
Bien avant l’apparition des royaumes, des sultanats et des colonies, le territoire du Kenya actuel était déjà occupé par des ancêtres très lointains de l’humanité. Les recherches archéologiques menées depuis le début du XXe siècle ont fait du pays un terrain majeur de la paléoanthropologie.
Âge, en millions d’années, des plus anciens outils en pierre découverts à Lomekwi, dans le bassin du Turkana.
Ces découvertes se multiplient au XXe siècle. Louis Leakey, en 1929, identifie à Kariandusi des bifaces acheuléens vieux d’environ un million d’années, première preuve claire d’ancêtres humains sur le territoire kényan. Dans les collines de Tugen, un fossile daté de six millions d’années, Orrorin tugenensis, mis au jour en 2000, devient l’un des plus anciens hominidés connus. Autour du lac Turkana encore, Meave Leakey décrit Australopithecus anamensis, espèce vieille de 4,1 millions d’années.
Les fouilles d’Olorgesailie, au Kenya, indiquent qu’il y a environ 320 000 ans, les humains modernes pratiquaient déjà le commerce à longue distance (comme en témoigne la présence d’obsidienne provenant de sources éloignées), utilisaient des pigments et fabriquaient probablement des armes de jet. Par ailleurs, à Panga ya Saidi, sur la côte kényane, la sépulture datant de 78 000 ans d’un enfant de trois ans représente la plus ancienne pratique funéraire connue en Afrique, avec un corps déposé avec soin, la tête reposant sur une sorte d’oreiller.
Le Kenya préhistorique est donc plus qu’un décor : il est l’un des lieux où se dessinent les premiers gestes techniques, les premières formes de symbolisme, les premières communautés humaines structurées.
Des chasseurs-cueilleurs aux pasteurs et forgerons
En sortant de la très longue durée, on voit apparaître, vers le 5e millénaire avant notre ère, des sociétés de chasseurs-cueilleurs qui laissent derrière elles poteries et sites de pêche, comme la culture Kansyore près du lac Victoria. Elles exploitent les ressources de la savane, de la forêt et des lacs, puis se transforment progressivement au contact de nouveaux arrivants.
Dès le 3e millénaire avant notre ère, des pasteurs couchitiques s’installent dans le nord du Kenya avec leurs troupeaux. Des sites comme Namoratunga, avec ses alignements de pierres, suggèrent des connaissances astronomiques avancées. Le cimetière monumental de Lothagam North, abritant au moins 580 individus, révèle une société déjà très hiérarchisée et complexe.
Peu à peu, le pastoralisme gagne le centre du pays et le nord de la Tanzanie. Les groupes de chasseurs-cueilleurs comme les Eburran, près du lac Nakuru, commencent à adopter le bétail dès 1 000 avant notre ère. Parallèlement, les communautés nilotiques du sud migrent depuis la zone frontière entre Soudan, Ouganda, Kenya et Éthiopie vers les hautes terres de l’ouest et la vallée du Rift.
Cette mosaïque s’enrichit encore avec l’arrivée des populations bantouphones, qui apportent le fer et une agriculture plus intensive.
Le temps du fer et des grandes migrations bantoues
Entre le premier millénaire avant notre ère et les premiers siècles de notre ère, le Kenya s’inscrit dans un vaste mouvement de migrations bantoues parties d’Afrique occidentale et centrale. Ces populations apportent la métallurgie du fer – qui permet de produire des outils plus résistants et des armes efficaces – ainsi que des cultures vivrières variées.
Dès le 1er siècle avant notre ère, des communautés bantouphones de la culture d’Urewe, identifiée par ses fours, scories et poteries dans la région des Grands Lacs et sur des sites kényans comme Yala, maîtrisaient déjà la production d’acier au carbone.
Les migrations se poursuivent pendant des siècles. Des groupes sud-luo quittent le Sud-Soudan au XVe siècle pour s’installer sur les rives du lac Victoria, autour de la colline fortifiée de Thimlich Ohinga, un ensemble de murs en pierres sèches de plus de 500 ans, aujourd’hui classé au patrimoine mondial. D’autres lignées bantoues se fixent sur les hauts plateaux centraux, donnant naissance à ce qui deviendra les Kikuyu, les Embu, les Meru ou encore les Kamba.
Au fil de ces mouvements, l’espace kényan se peuple d’une quarantaine de groupes ethniques aux langues, économies et institutions variées, mais souvent structurés autour de conseils d’anciens plutôt que d’États fortement centralisés.
La naissance de la côte swahilie : échanges, Islam et cités marchandes
Sur le littoral, une autre histoire s’écrit, tournée vers l’océan Indien plutôt que vers l’intérieur. Les premières communautés y vivent de pêche, d’agriculture et d’un commerce côtier modeste. Mais à partir du 1er siècle de notre ère, l’arrivée régulière de navires arabes et indiens, profitant des vents de mousson, transforme profondément cette frange littorale.
Décrit déjà des escales comme Mombasa ou Malindi, reliées à l’Arabie et à l’Inde par un trafic de produits bruts – ivoire, bois, peaux, résines – contre textiles fins, perles, verrerie. Entre le 7e et le 9e siècles, des marchands arabes et persans s’installent durablement, épousent des femmes bantoues, construisent des mosquées, introduisent l’Islam. Les villes côtières se densifient, s’urbanisent et prennent un caractère singulier : ce sont les cités swahilies.
Le Périple de la mer Érythrée, manuscrit gréco-romain du Ier siècle
Dans ces ports – Pate, Lamu, Malindi, Mombasa, Gede – se forme une culture originale, à la fois bantoue et arabo-persane. La langue swahilie, issue d’un substrat bantou enrichi de milliers d’emprunts arabes, devient la langue pivot des échanges régionaux. Des mosquées en corail apparaissent dès le 8e siècle, des épitaphes musulmanes en arabe sont gravées sur des stèles funéraires entre le XIe et le XVe siècle.
La prospérité swahilie était fondée sur un commerce intensif dans l’océan Indien. Ce réseau, aussi structurant que la route de la soie et appelé Zanj dans les textes arabes, voyait arriver des produits comme la porcelaine de Chine, le coton et les épices d’Inde, et l’encens d’Arabie. En échange, la côte exportait vers le nord de l’ivoire, de l’or (notamment du Zimbabwe via Kilwa) et, de plus en plus, des êtres humains réduits en esclavage.
Lamu et son archipel restent, jusqu’à aujourd’hui, un condensé de cet héritage. La vieille ville, classée au patrimoine mondial, conserve ses ruelles étroites, ses maisons en pierre de corail, ses portes finement sculptées, ses madrasa, et reste un centre vivant de l’Islam et de la culture swahilie.
Entre Portugais et Omanais : la bataille pour le contrôle de la côte
À la fin du XVe siècle, cet équilibre océanique est bouleversé par l’arrivée de la puissance portugaise. Vasco de Gama accoste à Mombasa en 1498, dans sa quête d’une route maritime vers l’Inde. En quelques années, les expéditions de Francisco de Almeida et d’Afonso de Albuquerque imposent à la côte swahilie un nouveau rapport de force. Cités brûlées, tributs exigés, garnisons : le commerce est désormais surveillé par les canons portugais.
Forteresse portugaise édifiée à la fin du XVIe siècle pour sécuriser la route maritime des Indes et contrôler les échanges dans l’océan Indien.
Construit entre 1593 et 1596 pour le compte de Lisbonne. Dessiné par l’ingénieur Giovanni Battista Cairati selon les normes de la fortification renaissante.
Sécuriser la route des Indes et incarner la volonté portugaise de dominer les échanges commerciaux dans la région, en dominant la baie de Mombasa.
Aujourd’hui transformé en musée, le site est classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, témoignant de cette période historique.
Mais cette domination reste fragile. À partir du XVIIe siècle, le sultanat d’Oman, arabe et ibadite, conteste l’hégémonie lusitanienne. Après un siège de 33 mois, les Omanais prennent Fort Jesus en 1698, chassent progressivement les Portugais de la côte kényane et tanzanienne, et finissent par installer leur capitale à Zanzibar en 1840 sous Seyyid Saïd. À partir de là, la côte swahilie entre dans l’orbite politique de Zanzibar.
Nombre estimé d’esclaves vivant sur la côte kényane entre 1875 et 1884, représentant près de 44% de la population locale.
En parallèle, les missions chrétiennes commencent à s’implanter : le 25 août 1846, le missionnaire Johann Ludwig Krapf fonde à Rabai, près de Mombasa, la première mission protestante de l’actuel Kenya. L’abolition progressive de la traite et l’affirmation des puissances européennes vont bientôt faire basculer la région vers une autre forme de domination.
Royaumes, peuples et résistances avant la conquête coloniale
À l’intérieur des terres, la période qui précède la colonisation européenne est marquée par des recompositions démographiques et des structures politiques très diverses. Trois grands ensembles linguistiques se partagent le territoire : les Couchites (dans le nord et l’est arides), les Nilotiques (autour du Rift et des lacs) et les Bantous (dans les hautes terres et les zones côtières).
Parmi les formations politiques les plus structurées, le royaume Wanga, dans l’actuel ouest du Kenya, se distingue. Fondé à la fin du XVIIe siècle par un prince d’origine buganda, Wanga, ce royaume luhya centralisé, dirigé par un roi appelé “Nabongo”, contrôle une vaste zone allant de Jinja en Ouganda à Naivasha. Les Wanga développent une organisation militaire en régiments de clans, nouent des alliances commerciales avec des marchands swahilis et arabes, et deviennent un intermédiaire important dans le commerce des esclaves et de l’ivoire. Leur dernier grand souverain, Nabongo Mumia Shiundu, traitera directement avec les Britanniques à la fin du XIXe siècle.
Avant la colonisation, le territoire kenyan était occupé par plusieurs groupes ethniques aux modes de vie distincts. Les Kikuyu, peuple bantou de cultivateurs, étendaient leurs champs sur les pentes du mont Kenya et les hauts plateaux centraux. Les Maasai, pasteurs nilotiques, ont imposé leur puissance militaire au centre et au sud à partir du XVIIIe siècle, contrôlant des routes pastorales grâce à leur élite guerrière, les *morani*. Dans le nord-ouest, les Nandi et d’autres groupes kalenjin occupaient les plateaux du Rift.
Ces sociétés ne sont pas figées. Des conflits éclatent pour l’accès à l’eau, aux pâturages, aux terres cultivables. Mais jusqu’à la fin du XIXe siècle, aucune puissance extérieure ne parvient à imposer durablement son contrôle sur l’intérieur. Cela change avec la conjonction de la “course au clocher” coloniale européenne et des intérêts britanniques en Ouganda.
De la “folie du chemin de fer” au Protectorat : la mainmise britannique
La décision qui scelle le sort du Kenya intérieur est prise à Londres pour des raisons stratégiques : il faut un corridor sûr entre la côte de l’océan Indien et le protectorat ougandais. En 1895, la Grande-Bretagne proclame l’East Africa Protectorate et lance la construction d’un chemin de fer reliant Mombasa à Kisumu, sur le lac Victoria. Ce chantier, commencé la même année, s’achève en 1901–1903 au prix d’un effort colossal.
Pour bâtir cette voie ferrée surnommée “lunatic line” par certains parlementaires britanniques, l’administration coloniale fait venir environ 32 000 ouvriers de l’Inde britannique. Près de 2 500 meurent de maladie ou d’accidents, environ 23 000 repartent, mais quelque 7 000 s’installent sur place, formant le noyau de la communauté indo-kényane. À la fin des années 1910, les Indiens sont plus nombreux que les colons européens dans la colonie, ce qui leur vaudra un statut ambivalent : indispensables économiquement, mais politiquement marginalisés.
Le rail ouvre l’intérieur aux colons, aux missionnaires et aux administrateurs. Des Européens, encouragés par des responsables comme le commissaire Sir Charles Eliot, obtiennent des concessions de terres dans les hautes terres centrales, très fertiles. Pour rationaliser cette dépossession, l’ordonnance sur les terres de la Couronne déclare que toutes les terres “non occupées” appartiennent à la Couronne. Les zones les plus productives deviennent les “White Highlands”, réservées aux colons blancs.
Commissaire Sir Charles Eliot
En 1920, l’East Africa Protectorate est officiellement transformé en Colony and Protectorate of Kenya. Les terres intérieures sont annexées comme colonie, tandis qu’une bande côtière de 16 kilomètres de large reste un protectorat loué au sultan de Zanzibar. À cette époque, la population totale est estimée à un peu plus de 2,3 millions d’habitants, dont moins de 10 000 Européens, environ 23 000 Indiens et quelque 10 000 Arabes.
Les structures politiques coloniales restent longtemps fermées aux Africains. En 1907, les colons européens obtiennent une représentation dans un conseil législatif, mais les Africains n’y siègent pas. Il faut attendre 1944 pour qu’Eliud Mathu devienne le premier Africain membre du Conseil législatif, geste tardif qui n’apaise pas le ressentiment accumulé.
Terres confisquées, impôts forcés, travail contraint
Au cœur du conflit colonial se trouvent la terre et le travail. Les Kikuyu, les Maasai, les Nandi et d’autres communautés perdent une grande partie de leurs territoires les plus fertiles, reléguées dans des “réserves” surpeuplées et souvent peu productives. Le déséquilibre est flagrant : à la fin des années 1940, environ 1,25 million de Kikuyu se partagent 5 200 km², tandis qu’environ 30 000 colons contrôlent plus de 31 000 km².
Pour fournir de la main-d’œuvre aux plantations coloniales, l’administration a instauré plusieurs mesures coercitives : une ‘hut tax’ (1902) puis une ‘poll tax’ forçant les familles à travailler pour les Européens pour se procurer des liquidités. Le non-paiement entraînait amendes ou travail forcé. Les relations employeurs-employés étaient strictement encadrées et, à partir de 1919, le système du *kipande* obligeait les hommes africains à porter en permanence un livret d’identité métallique pour contrôler leurs déplacements et leur emploi.
Les colons bénéficient d’investissements publics massifs : construction de routes secondaires, subventions de fret, services agricoles, accès au crédit, droits fonciers quasi perpétuels (baux de 999 ans). À l’inverse, l’agriculture africaine est maintenue sous tutelle : interdiction pour les Africains de cultiver certaines cultures de rente comme le café, restrictions foncières, réserves éloignées des marchés. Des systèmes de squattérisation, puis des ordonnances durcissant les obligations de travail des “squatters” (souvent kikuyu) fixent dans les années 1930 jusqu’à 270 jours de travail obligatoire par an pour conserver le droit de rester sur une ferme européenne.
Dans ce contexte, les premiers mouvements de contestation structurés émergent dès les années 1920.
Premiers mouvements politiques et résistances anticoloniales
Les injustices foncières, la dégradation des conditions de vie et le mépris raciste alimentent une politisation rapide, d’abord parmi les élites urbanisées. En 1921, Harry Thuku fonde la Young Kikuyu Association, bientôt rebaptisée East African Association. Cette organisation proteste contre la baisse des salaires africains, la ségrégation raciale et la politique foncière. L’arrestation de Thuku en mars 1922 déclenche une immense manifestation à Nairobi, réprimée dans le sang – la police tire sur la foule, faisant au moins une vingtaine de morts.
D’autres foyers de contestation émergent, comme le mouvement religieux Mumbo dans le Sud-Nyanza et l’association *Piny Owacho* chez les Luo, qui dénoncent les injustices fiscales et foncières. À l’ouest, des organisations telles que la Kavirondo Taxpayers Welfare Association relaient les revendications des contribuables africains.
Pendant l’entre-deux-guerres, les organisations se multiplient malgré les interdictions. Le Kikuyu Central Association (KCA), dont Jomo Kenyatta devient le secrétaire général en 1928, plaide pour la restitution des terres et une meilleure représentation politique. Dans les années 1940, la création de la Kenya African Study Union (KASU), transformée en Kenya African Union (KAU) en 1946, marque une nouvelle étape : pour la première fois, une formation politique se veut pan-ethnique à l’échelle du territoire, malgré une forte présence kikuyu.
Guerres mondiales et radicalisation
Les deux guerres mondiales jouent un rôle important. Pendant la Première Guerre mondiale, plus de 400 000 Africains sont mobilisés comme porteurs dans les forces britanniques d’Afrique de l’Est. La seconde guerre voit l’enrôlement d’environ 98 000 soldats africains (“askaris”) dans les campagnes contre l’Italie en Éthiopie et au-delà. Beaucoup découvrent le monde, manient les armes, constatent l’hypocrisie des discours coloniaux sur la liberté et la démocratie, puis retrouvent à leur retour l’injustice foncière et raciale inchangée.
À partir de 1942, dans les régions kikuyu, embu, meru et kamba, une pratique de serments (oath-taking) se diffuse pour préparer la lutte pour la terre et la liberté. Ces serments, ancrés dans des traditions anciennes, sont radicalisés, notamment suite aux expulsions du règlement foncier d’Olenguruone, où des paysans jurent de résister.
Dans ce climat, de jeunes militants, souvent issus de la KAU ou de groupes clandestins comme les “Anake a 40” (Les gars de quarante), glissent progressivement vers la lutte armée. Le conflit à venir, la révolte Mau Mau, se nourrit directement de ces frustrations accumulées.
L’insurrection Mau Mau : guerre pour la terre, guerre de mémoire
En octobre 1952, le gouverneur Evelyn Baring décrète l’état d’urgence dans la colonie, après une série d’attaques attribuées aux Mau Mau – notamment le meurtre de la première Européenne tuée près de Thika, puis l’assassinat du chef kikuyu pro-britannique Senior Chief Waruhiu. Dans la nuit du 20 au 21 octobre, l’opération Jock Scott entraîne l’arrestation de Jomo Kenyatta et de près de 180 militants soupçonnés d’être les cerveaux du mouvement.
Pourtant, la véritable direction de la rébellion se trouve déjà dans les forêts de l’Aberdare et du mont Kenya. Des figures comme Dedan Kimathi, Stanley Mathenge, Waruhiu Itote (connu comme General China), Musa Mwariama ou Baimungi organisent le Kenya Land and Freedom Army (KLFA), force armée du mouvement. La majorité des combattants sont kikuyu, épaulés par des unités meru et embu, avec le soutien ponctuel de Kamba ou de Maasai, tandis qu’une partie importante des Kikuyu reste fidèle au camp loyaliste.
La lutte des Mau Mau, concentrée sur la région centrale et Nairobi, est une guérilla rurale marquée par des attaques nocturnes et des sabotages. Le massacre de Lari (mars 1953), où des combattants tuèrent des dizaines de civils kikuyu accusés de collaboration, suivi de violentes représailles coloniales, illustre le caractère profondément intra-kikuyu de ce conflit.
Les autorités britanniques, déjà expérimentées par la guerre de Malaisie, déploient une vaste panoplie contre-insurrectionnelle. Des bombardiers Avro Lincoln et des avions Harvard mitraillent les forêts, larguant jusqu’à six millions de bombes et de tracts de propagande. Une “Home Guard” kikuyu, armée et encadrée par les Britanniques, est constituée et devient un outil clé : plus de 25 000 hommes se battent ainsi contre les insurgés, transformant le conflit en une véritable guerre civile locale.
Camps de détention, villages forcés, torture
Le cœur de la stratégie britannique est cependant moins visible : il se trouve dans les camps de détention et les villages de regroupement. Dès 1953, des dizaines de milliers de suspects sont arrêtés. Un système baptisé la “Pipeline” organise leur passage par des camps comme Langata, Manyani, Athi River, Kamiti (pour les femmes), Hola, GilGil. On estime qu’environ 70 000 à 80 000 personnes sont ainsi internées, tandis que plus de 150 000 sont soumises à une détention prolongée au fil du conflit.
Nombre de détenus battus à mort par des gardiens dans le camp de Hola en mars 1959.
Parallèlement, une vaste opération de “villagisation” est menée à partir de 1954. En dix-huit mois, plus d’un million de Kikuyu sont déplacés dans 804 villages fortifiés, entourés de fossés et de barbelés. Officiellement présentés comme des “villages protégés”, ces regroupements ressemblent plutôt à des camps de concentration ruraux : contrôles permanents, rationnement, surveillance collective, interdiction de circulation.
Bilan humain et politique
Le bilan humain exact de la révolte Mau Mau reste controversé. Les chiffres officiels britanniques évoquent environ 11 500 insurgés tués, une centaine d’Européens et près de 2 000 Africains loyalistes. Des chercheurs comme David Anderson estiment cependant autour de 25 000 morts, alors que la démographe John Blacker avance un chiffre pouvant atteindre 50 000, dont la moitié d’enfants de moins de dix ans. L’historienne Caroline Elkins défend, de son côté, l’hypothèse de “dizaines de milliers, voire des centaines de milliers” de victimes, chiffres contestés mais qui témoignent de l’ampleur de la violence. Un point est en revanche avéré : plus de 1 090 Kenyans sont exécutés par pendaison, soit la plus grande utilisation de la peine capitale dans l’Empire britannique en temps de guerre.
Année de l’arrestation de Dedan Kimathi, chef de la révolte des Mau Mau, le 21 octobre.
Si la Mau Mau est militairement vaincue, elle fait bouger les lignes politiques. Le coût de la répression (environ 55 millions de livres pour la Grande-Bretagne), la publicité autour des camps, l’usure du modèle colonial et, plus largement, le contexte mondial de décolonisation poussent Londres à envisager un transfert rapide du pouvoir.
Des décennies plus tard, les survivants obtiendront une forme de reconnaissance. En 2013, à l’issue d’une bataille judiciaire appuyée sur des archives longtemps dissimulées, le gouvernement britannique accepte d’indemniser plus de 5 000 anciens détenus à hauteur de près de 20 millions de livres sterling et reconnaît officiellement les tortures et mauvais traitements infligés.
De la décolonisation à l’indépendance : l’ascension de Jomo Kenyatta
Pendant que la guerre se déroule dans les forêts, une autre bataille se joue sur le terrain politique et diplomatique. Jomo Kenyatta, arrêté en 1952, condamné en 1953 à sept ans de travaux forcés puis à une assignation à résidence, devient malgré lui le symbole de la lutte pour l’indépendance. La KAU, son parti, est interdite, mais de nouvelles formations émergent à la fin de l’état d’urgence.
En 1960, la levée de l’interdiction des partis nationaux permet la création de la Kenya African National Union (KANU), qui regroupe la KAU ressuscitée de James Gichuru, le Kenya Independence Movement de Tom Mboya et le Nairobi People’s Convention Party. Très vite, KANU devient le principal vecteur nationaliste, fort de l’appui kikuyu et luo. Face à lui, des leaders de minorités ethniques et de régions périphériques – Ronald Ngala, Daniel arap Moi, Masinde Muliro – créent la Kenya African Democratic Union (KADU), qui défend un fédéralisme “majimbo” destiné à limiter la domination des “grandes tribus”.
Ces deux camps s’affrontent lors des conférences constitutionnelles de Lancaster House à Londres au début des années 1960. Les délégués négocient le futur système politique : KANU plaide pour un État centralisé, KADU impose l’idée de régions dotées d’assemblées et de pouvoirs importants. La solution adoptée pour l’indépendance est un compromis calqué sur le modèle de Westminster : une monarchie constitutionnelle avec la reine d’Angleterre comme chef d’État, un gouverneur général, un parlement bicaméral (Sénat et Chambre des représentants) et des gouvernements régionaux.
Lors des élections de 1961 puis de 1963, KANU l’emporte largement en voix et en sièges. Kenyatta, libéré en 1961 de sa dernière résidence surveillée, prend la tête du parti. Le 1er juin 1963, après un scrutin décisif en mai, il devient Premier ministre d’un gouvernement autonome. Le 12 décembre 1963, l’Indépendance est proclamée : le Kenya devient un dominion du Commonwealth, avec la reine Élisabeth II comme chef d’État représentée par un gouverneur général, Malcolm MacDonald, et Jomo Kenyatta comme chef de gouvernement.
Un an plus tard, le 12 décembre 1964, une nouvelle modification constitutionnelle fait du Kenya une république. Le poste de Premier ministre est aboli, Jomo Kenyatta devient président exécutif, Oginga Odinga vice-président. L’Indépendance “juridique” est réalisée – la souveraineté britannique et les droits du sultan de Zanzibar sur la bande côtière prennent fin – mais le pays hérite d’institutions déjà en cours de centralisation.
Le long règne de Kenyatta : un État centralisé et un parti dominant
La période Kenyatta, de 1964 à 1978, est marquée par une consolidation rapide du pouvoir présidentiel et de KANU. Le système “majimbo” qui devait protéger les régions est progressivement vidé de sa substance, puis aboli. En 1966, le Sénat et la Chambre des représentants sont fusionnés en une Assemblée nationale unique. Les gouvernements régionaux disparaissent, remplacés par une administration provinciale contrôlée depuis Nairobi.
KADU, qui incarnait l’option fédéraliste, se dissout dès 1964 et rejoint KANU. Ronald Ngala, Daniel arap Moi et d’autres rejoignent le camp présidentiel. Dans les faits, le Kenya devient un État à parti hégémonique, même si le monopartisme ne sera inscrit dans la Constitution qu’en 1982.
Le gouvernement de Jomo Kenyatta a mis en œuvre une politique d’« africanisation » de l’économie, formalisée dans le document « Le socialisme africain et son application à la planification au Kenya » (1965). Cette vision prônait une économie mixte, mais visait principalement à transférer les actifs économiques détenus par les Européens et les Asiatiques vers une élite africaine. Un programme clé, le « million acre scheme », financé en partie par le Royaume-Uni, a permis le rachat de terres aux colons pour les redistribuer à des coopératives et à des sociétés de colonisation, souvent dirigées par des proches du pouvoir.
Ce processus permet à une classe de politiciens et d’hommes d’affaires d’accumuler des propriétés, tandis que de nombreux anciens combattants Mau Mau ou paysans sans terre restent exclus. Dans le même temps, Kenyatta encourage le slogan “Harambee” – “tirons tous ensemble” – qui légitime des campagnes de mobilisation communautaire pour bâtir écoles, dispensaires, routes, mais sert aussi parfois de couverture à des pratiques clientélistes.
Le taux de croissance démographique annuel du Kenya, qui met à rude épreuve les infrastructures du pays.
Tensions politiques et dérive autoritaire
Politiquement, la promesse pluraliste de l’Indépendance se réduit rapidement. À gauche de KANU, Oginga Odinga quitte la vice-présidence en 1966 et fonde la Kenya People’s Union (KPU), parti socialiste favorable à une relation plus étroite avec le bloc de l’Est et à une redistribution plus radicale des terres. Le gouvernement réagit par une série d’amendements constitutionnels : tout député changeant de parti doit démissionner et se représenter devant les électeurs. Lors des partielles de 1966, la KPU ne remporte que neuf sièges sur 29, affaiblie par la machine KANU.
Nombre de personnes tuées lors du massacre de Kisumu en 1969, après des heurts entre la sécurité présidentielle et la foule.
S’ajoutent à cela les assassinats de figures politiques marquantes : Pio Gama Pinto en 1965, puis Tom Mboya en 1969, brillant ministre de la Planification et architecte de nombreux compromis politiques. En 1975, l’élu Josiah Mwangi Kariuki, critique acerbe des inégalités croissantes, disparaît et est retrouvé mort ; sa phrase restée célèbre – “Le Kenya est une nation de dix millions de pauvres gouvernés par une élite de dix millionnaires” – résonne comme un acte d’accusation.
À la fin des années 1970, Kenyatta, âgé et malade, gouverne de plus en plus par l’entremise d’un cercle rapproché, tandis que les réseaux de corruption se densifient. Le jour de sa mort, le 22 août 1978, à Mombasa, la Constitution prévoit que le vice-président Daniel arap Moi assure l’intérim. Une tentative de certains notables kikuyu de modifier ce dispositif a échoué plus tôt, permettant une succession pacifique, mais lourde de conséquences.
Daniel arap Moi : de l’État-parti à la transition multipartite
Daniel Toroitich arap Moi, issu de la communauté kalenjin, accède à la présidence d’abord à titre intérimaire, puis officiellement après une élection sans concurrent en octobre 1978. Il consacre son pouvoir autour d’une idéologie baptisée “Nyayo” (“sur les traces”), censée prolonger l’héritage de Kenyatta avec comme mots d’ordre “paix, amour et unité”.
Dans un premier temps, Moi se montre plus proche des populations que son prédécesseur, multipliant les tournées dans les districts. Il libère certains prisonniers politiques, introduit la gratuité du lait scolaire et élargit l’accès à l’enseignement primaire. Mais ce climat d’ouverture ne dure pas. La tentative de coup d’État menée par des soldats de l’armée de l’air le 1er août 1982 sert de tournant. La mutinerie, qui fait entre 159 et 1 200 morts selon les estimations, est brutalement réprimée par les forces loyalistes. Dans la foulée, Moi purge l’armée, dissout l’armée de l’air, limoge de nombreux responsables associés au “régime Kenyatta” et centralise davantage le pouvoir.
En juin 1982, un amendement constitutionnel fait du Kenya un État à parti unique, avec le KANU comme seul parti autorisé. Le régime renforce la répression : surveillance des universités, interdiction du marxisme, exil d’intellectuels, et torture d’opposants dans les geôles de la Nyayo House à Nairobi.
Sur le plan économique, les années 1980 et 1990 sont marquées par la fin de la rente géopolitique de la guerre froide. Avec l’effondrement du bloc de l’Est, les alliés occidentaux, États-Unis en tête, conditionnent de plus en plus leur aide au respect des droits humains et à l’ouverture politique. La chute des prix des matières premières, les scandales de corruption – comme Goldenberg, montage d’exportations fictives d’or qui coûte des centaines de millions de dollars au pays – aggravent la situation. La croissance s’érode, la pauvreté gagne du terrain.
Sous la pression conjuguée d’une société civile de plus en plus organisée, de l’opposition interne et des bailleurs internationaux, Moi finit par céder sur le principe du multipartisme. En décembre 1991, lors d’un congrès de KANU à Kasarani, il annonce l’abrogation de la section 2A. Les partis d’opposition peuvent à nouveau se former.
Élections pluralistes et violences politiques
Les élections pluralistes de 1992 puis de 1997 voient pourtant Moi et KANU conserver le pouvoir, grâce à une combinaison de facteurs : fragmentation de l’opposition, clientélisme, contrôle des médias, mais aussi attisement de tensions ethniques, notamment dans la vallée du Rift où des violences meurtrières chassent des dizaines de milliers de personnes de leurs terres.
Pourcentage des suffrages avec lequel le président Moi a été réélu en 1992, illustrant un pouvoir contesté.
Des commissions sont créées, comme la Constitution of Kenya Review Commission (CKRC) dirigée par Yash Pal Ghai à partir de 2000, pour recueillir l’avis du public, élaborer des projets de nouvelle constitution et organiser des conférences nationales (les fameuses “Bomas Conferences”). Mais les divisions politiques, notamment sur la répartition des pouvoirs entre président et Premier ministre, et la question de la dévolution territoriale, bloquent le processus.
En 2002, la limite de deux mandats présidentiels introduite après la réintroduction du multipartisme empêche Moi de se représenter. Il désigne comme dauphin Uhuru Kenyatta, fils de Jomo, mais une large coalition d’opposition, la National Rainbow Coalition (NARC) menée par Mwai Kibaki, l’emporte largement. Pour la première fois depuis l’Indépendance, KANU quitte le pouvoir.
De Kibaki à la crise de 2007–2008 : entre espoirs de réforme et fractures profondes
L’arrivée de Mwai Kibaki à la présidence, le 30 décembre 2002, est saluée comme une rupture historique. La NARC promet une nouvelle constitution en 100 jours, une lutte acharnée contre la corruption, une réforme de la justice. Pendant quelques années, la croissance économique repart, l’enseignement primaire devient gratuit, les indicateurs macroéconomiques s’améliorent.
Mais la réforme constitutionnelle patine. Un premier projet, dit “projet Bomas” (2004), propose un régime parlementaire renforcé avec un Premier ministre puissant et une forte dévolution. Le gouvernement, craignant de voir ses prérogatives réduites, présente un texte amendé, dit “projet Wako” (2005), qui maintient un président fort. Le référendum de 2005 voit la victoire du “non”, porté notamment par Raila Odinga et l’Orange Democratic Movement (ODM), issu de cette campagne. La coalition NARC se fracture, un nouveau clivage politique s’installe entre le camp Kibaki et le camp Odinga.
Nombre de personnes tuées en quelques semaines lors des violences post-électorales de 2007-2008 au Kenya.
Face à l’embrasement, l’Union africaine mandate un panel d’éminentes personnalités présidé par Kofi Annan pour une médiation. Après de longues négociations, un accord est signé le 28 février 2008 : le National Accord and Reconciliation Act crée un gouvernement de grande coalition, instaure le poste de Premier ministre (confié à Raila Odinga) et prévoit, au titre de “l’Agenda 4”, une réforme profonde des institutions, dont la Constitution.
La Constitution de 2010 : refonder l’État après la crise
Le processus qui aboutit à la Constitution promulguée le 27 août 2010 est l’un des plus participatifs et les plus surveillés du continent. Une loi de 2008 institue une Committee of Experts (CoE) composée de juristes et constitutionnalistes kényans et étrangers – parmi lesquels Nzamba Kitonga, Atsango Chesoni, Njoki Ndung’u, Otiende Amollo, Christina Murray – chargée de reprendre les travaux antérieurs, d’identifier les points de blocage et de produire un texte de compromis.
La CoE organise des consultations publiques dans tout le pays, recueille plus de 26 000 mémorandums, tient des auditions, travaille en lien avec un comité parlementaire multipartite. Un premier projet harmonisé est publié en novembre 2009, puis retravaillé à la lumière des réactions. La question la plus épineuse reste la forme du régime : présidentiel, parlementaire ou semi-présidentiel. Les experts optent pour un modèle hybride à l’origine, mais, sous la pression politique, le texte final s’oriente vers un présidentialisme encadré, avec un président fort mais soumis à des contre-pouvoirs.
Le projet prévoit un bicaméralisme (Assemblée nationale et Sénat), une dévolution à deux niveaux (État central et 47 comtés dotés d’assemblées et de gouverneurs élus), une Charte des droits fondamentaux très avancée (droits économiques et sociaux inclus), une réforme en profondeur de la justice, la reconnaissance de la double nationalité, des quotas de genre (au moins un tiers de chaque sexe dans les instances élues), la création de commissions indépendantes (Commission des terres, Commission des droits de l’homme, Commission d’éthique, Commission de répartition des revenus, etc.).
Pourcentage des votants ayant approuvé la nouvelle Constitution lors du référendum du 4 août 2010.
Quelques grandes transformations institutionnelles
Pour mesurer la profondeur du changement, quelques éléments structurants peuvent être comparés entre l’ancien système (Constitution de 1969 amendée) et celui de 2010.
| Aspect clé | Avant 2010 (Constitution 1969) | Après 2010 (nouvelle Constitution) |
|---|---|---|
| Structure de l’État | État unitaire centralisé | État unitaire avec forte dévolution vers 47 comtés |
| Régime politique | Présidentiel hyper-concentré | Présidentiel avec séparation stricte des pouvoirs |
| Parlement | Assemblée nationale monocamérale | Bicameral : Assemblée nationale et Sénat |
| Chef de l’exécutif | Président, souvent chef du parti majoritaire | Président, non membre du Parlement |
| Gouvernement local | Administrations provinciales nommées | Gouverneurs et assemblées de comté élus |
| Droits fondamentaux | Bill of Rights limité et restreint par amendements | Charte élargie incluant droits socio-économiques |
| Citoyenneté | Pas de double nationalité, règles discriminatoires | Double nationalité autorisée, égalité hommes-femmes |
| Justice | Forte influence de l’exécutif sur les nominations | Commission de services judiciaires indépendante, vetting des juges |
| Contrôle des ressources | Centralisé, faible transparence | Commission de répartition des revenus, Fonds d’égalisation |
Cette “seconde fondation” juridique du Kenya redéfinit les rapports entre centre et périphéries, entre gouvernants et gouvernés, et doit beaucoup aux traumatismes de la crise postélectorale de 2007–2008. Elle fait du pays un laboratoire de rééquilibrage des pouvoirs sur le continent.
Héritages et continuités : une histoire toujours en débat
Raconter l’histoire du pays au Kenya, c’est donc articuler plusieurs niveaux : la très longue durée préhistorique, les siècles d’échanges de la côte swahilie, la violence coloniale et la révolte Mau Mau, la construction d’un État postcolonial centralisé, puis le patient travail de reconfiguration constitutionnelle. C’est aussi reconnaître combien cette histoire reste vive dans les paysages, les mémoires collectives et les institutions.
Le Kenya possède de nombreux sites matérialisant son histoire, comme les parcs nationaux du lac Turkana et du mont Kenya, la vieille ville de Lamu et le site archéologique de Thimlich Ohinga, tous inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO. Les musées, notamment ceux de Nairobi, Kariandusi et Kapenguria, conservent la mémoire des luttes politiques et des découvertes scientifiques. Le Fort Jesus à Mombasa illustre quant à lui des siècles de rivalités entre puissances coloniales portugaises, omanaises et britanniques.
En parallèle, les débats contemporains – sur la réforme de la Constitution via des initiatives comme le Building Bridges Initiative (BBI), sur le partage des ressources naturelles, sur les mémoires du Mau Mau ou de la répression somalie dans le Nord-Est – montrent que l’histoire est aussi un enjeu de pouvoir. Qui contrôle le récit de la terre, de la liberté, de la nation ? Qui hérite de quoi, sur quelle base juridique et symbolique ?
Le Kenya d’aujourd’hui, avec ses 47 comtés, son parlement bicaméral, sa Charte des droits et ses institutions multiples, est le résultat d’une succession de compromis, de ruptures et de résistances. Des premiers outils taillés sur les rives du Turkana aux articles de la Constitution de 2010, un fil se dessine : celui d’une société qui, malgré les violences et les inégalités, n’a cessé de reconfigurer ses structures pour tenter d’articuler diversité, justice et gouvernance.
Cette histoire, loin d’être close, continue de s’écrire dans les tribunaux, les assemblées de comté, les universités, les villages et les villes du pays. Comprendre le Kenya contemporain passe inévitablement par ce détour : celui d’une histoire longue, complexe, souvent douloureuse, mais aussi riche en inventions politiques et sociales.
Un retraité de 62 ans, avec un patrimoine financier supérieur à un million d’euros bien structuré en Europe, souhaitait changer de résidence fiscale pour optimiser sa charge imposable et diversifier ses investissements, tout en gardant un lien étroit avec la France. Budget alloué : 10 000 euros pour un accompagnement complet (conseil fiscal, formalités administratives, délocalisation et structuration patrimoniale), sans vente forcée d’actifs.
Après analyse de plusieurs destinations attractives (Kenya, Grèce, Chypre, Maurice), la stratégie retenue a consisté à cibler le Kenya pour son régime favorable aux revenus étrangers (possibilités d’optimiser la taxation des pensions et revenus de capitaux), son coût de vie nettement inférieur à celui de Paris (notamment à Nairobi et Mombasa) et ses opportunités immobilières et entrepreneuriales en Afrique de l’Est. La mission a inclus : audit fiscal pré‑expatriation (exit tax ou non, report d’imposition), obtention du permis de résidence au Kenya avec achat de résidence principale, détachement CNAS/CPAM, transfert de résidence bancaire, plan de rupture des liens fiscaux français (183 jours/an hors France, centre d’intérêts économiques…), mise en relation avec un réseau local (avocat, immigration, experts bilingues) et intégration patrimoniale (analyse et restructuration si nécessaire), tout en maîtrisant les risques de double imposition via la convention FR‑KE et d’adaptation culturelle.
Vous souhaitez vous expatrier à l'étranger : contactez-nous pour des offres sur mesure.
Décharge de responsabilité : Les informations fournies sur ce site web sont présentées à titre informatif uniquement et ne constituent en aucun cas des conseils financiers, juridiques ou professionnels. Nous vous encourageons à consulter des experts qualifiés avant de prendre des décisions d'investissement, immobilières ou d'expatriation. Bien que nous nous efforcions de maintenir des informations à jour et précises, nous ne garantissons pas l'exhaustivité, l'exactitude ou l'actualité des contenus proposés. L'investissement et l'expatriation comportant des risques, nous déclinons toute responsabilité pour les pertes ou dommages éventuels découlant de l'utilisation de ce site. Votre utilisation de ce site confirme votre acceptation de ces conditions et votre compréhension des risques associés.
Découvrez mes dernières interventions dans la presse écrite, où j'aborde divers sujets.