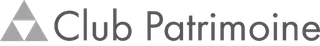Publié le et rédigé par Cyril Jarnias
Publié le et rédigé par Cyril Jarnias
Pendant longtemps, le Koweït n’a été qu’un nom discret sur les cartes, une bande de désert au fond du golfe Persique entre Irak et Arabie saoudite. Pourtant, ce petit État de l’émirat cache une histoire étonnamment dense, qui commence bien avant l’islam et se poursuit aujourd’hui avec les grands chantiers de la Vision 2035. De Dilmun aux champs pétroliers de Burgan, des caravanes de chevaux aux supertankers, l’histoire du pays au Koweït est celle d’un territoire minuscule devenu un acteur stratégique au Moyen‑Orient.
Aux origines : un carrefour habité depuis la préhistoire
Bien avant que le nom « Koweït » n’apparaisse, la région est déjà peuplée. Les archéologues ont mis au jour des outils datant du Mésolithique, vers 8000 av. J.-C., dans la zone de Burgan. Ces premières traces humaines montrent que les hommes exploitent très tôt ce bout de péninsule, à la jonction de la Mésopotamie et de l’Arabie.
Durant la période d’Ubaid au Néolithique, le territoire du Koweït actuel a été un lieu d’échanges intenses entre les populations de Mésopotamie et de l’est de la péninsule Arabique. Les sites archéologiques comme Subiya (site H3), Bahra 1, Khiran et Sulaibikhat en attestent. Ces communautés étaient d’importants marins : à Subiya, on a découvert l’un des plus anciens modèles de bateau en roseaux au monde, preuve de navigations organisées dans le golfe dès cette époque.
L’emplacement du territoire joue un rôle central. La côte koweïtienne, environ 500 kilomètres aujourd’hui, se situe exactement au débouché naturel du système Tigre‑Euphrate. À l’époque d’Alexandre, l’embouchure de l’Euphrate se trouvait encore dans le nord du Koweït, le fleuve se jetant dans le golfe par le chenal de Khor Subiya, avant que celui‑ci ne s’assèche à la fin de l’Antiquité. Autrement dit, ce qui n’est plus qu’un désert côtier était jadis une estuaire fertile et stratégique, ce qui aide à comprendre pourquoi tant de civilisations s’y sont succédé.
Pour mesurer l’ancienneté de l’occupation humaine au Koweït, on peut s’appuyer sur la chronologie des principales cultures identifiées sur son territoire. Cette succession de cultures matérielles et de périodes historiques documentées (telles que les périodes préhistoriques, la civilisation de Dilmun, les époques hellénistique, parthe, sassanide et islamique) fournit un cadre archéologique concret pour retracer et dater la présence humaine dans la région.
| Période | Civilisation / contexte | Sites et indices majeurs |
|---|---|---|
| Mésolithique | Premiers chasseurs‑cueilleurs | Outillages en silex à Burgan |
| Néolithique (Ubaid) | Sociétés de paysans‑marins | Bahra 1, site H3 à Subiya, Khiran, Sulaibikhat, modèle de bateau en argile |
| Âge du Bronze ancien | Début de Dilmun | Al‑Shadadiya, premiers échanges intensifs dans le golfe |
| Bronze moyen / récent | Apogée de Dilmun | Failaka (« Agarum »), Umm an Namil, Akkaz |
Ces couches préhistoriques, longtemps ignorées, sont aujourd’hui au cœur de missions archéologiques internationales, venues de Pologne, du Danemark, de France, d’Italie ou du Royaume‑Uni. Elles donnent au Koweït une profondeur historique que l’image simplifiée de « pays du pétrole » fait souvent oublier.
Dilmun, Babylone, Ikaros : quand le Koweït est un pivot des empires
Du IVe au IIe millénaire av. J.-C., la région entre pleinement dans l’histoire sous le nom de Dilmun. Cette civilisation de marchands contrôle une partie des routes maritimes du golfe Persique. Les textes mésopotamiens situent Dilmun sur un axe reliant la Mésopotamie à la vallée de l’Indus. Sur le territoire actuel du Koweït, Dilmun laisse une empreinte forte, notamment à Failaka, Akkaz et Umm an Namil.
Failaka occupe une place à part. L’île, longue d’une douzaine de kilomètres et large de six, est connue alors sous le nom d’« Agarum ». Elle apparaît comme un centre religieux et administratif de Dilmun, associé au dieu Inzak. Des temples, dont l’un dédié à ce dieu, ainsi que des bâtiments de style mésopotamien témoignent de cette phase. Sur le continent, des sites comme Al‑Shadadiya contribuent à dessiner un paysage densément occupé.
Sur Failaka, on identifie clairement la présence de rois célèbres de Babylone. Des tablettes cunéiformes mentionnent un gouverneur stationné sur l’île, un palais, des temples dédiés à Shamash, dieu du soleil, et à des divinités de Dilmun. Le site devient un avant‑poste avancé de Babylone sur le golfe.
Rois de Babylone, Nabuchodonosor II et Nabonide
Après une phase d’abandon, la zone est réinvestie à l’époque achéménide. Des inscriptions araméennes et des niveaux archéologiques datés de cette période montrent que l’empire perse n’a pas négligé cet espace côtier. Là encore, la raison tient à la géographie : maîtriser la sortie maritime de la Mésopotamie, c’est contrôler une partie des échanges entre l’intérieur du continent et l’océan Indien.
Cette vocation de carrefour s’accentue avec l’arrivée des Grecs d’Alexandre le Grand. Au IVe siècle av. J.-C., les troupes macédoniennes colonisent la baie de Koweït. Les géographes antiques conservent les traces de cette entreprise : le territoire continental est appelé « Larissa », l’île de Failaka devient « Ikaros », probablement en référence à sa ressemblance avec l’île grecque homonyme, et la baie prend le nom de « Hieros Kolpos », « golfe sacré ».
Année de la découverte d’une inscription grecque évoquant une offrande à Zeus, Poséidon et Artémis par une garnison grecque sur l’île de Failaka.
L’époque suivante reste tout aussi connectée. À partir de 127 av. J.-C., la région tombe dans l’orbite des Parthes. Le petit royaume de Characène, centré sur le port de Teredon, s’impose autour de l’embouchure du Tigre et de l’Euphrate. Des monnaies de Characène retrouvées à Akkaz, Umm an Namil et Failaka confirment le rôle du secteur comme station commerciale. Puis, au IIIe siècle de notre ère, l’empire sassanide rebaptise la région « Meshan », y érige des installations défensives et religieuses, dont une « tour du silence » zoroastrienne à Akkaz, et laisse des traces jusque sur l’île de Bubiyan.
Ainsi, dès l’Antiquité, l’espace koweïtien est tout sauf marginal. Il sert de trait d’union entre mondes persan, mésopotamien et arabe, et cette fonction de pivot ne cessera de se réactiver, sous d’autres formes, dans les siècles suivants.
Des batailles de l’islam aux villages chrétiens de Failaka
L’arrivée de l’islam ajoute une nouvelle couche à cette stratification historique. En 636, la célèbre bataille des Chaînes oppose, près de Kazma, les forces sassanides aux troupes du califat rashidun. La victoire musulmane ouvre la voie à l’intégration progressive de la région dans l’aire islamique.
Kazma (ou Kadhima) était une petite ville de la première époque islamique, située au fond d’une baie. Elle servait à la fois de port de commerce et d’étape sur la route du pèlerinage vers le Hedjaz. La ville dépendait du royaume d’al-Hira en Irak. Elle est notamment la ville natale du poète Al-Farazdaq, une figure majeure de la littérature arabe classique, ce qui témoigne de son intégration dans les grands courants culturels de l’époque, malgré sa position périphérique.
Les archéologues ont retrouvé sur plusieurs points du territoire koweïtien des traces d’occupation allant des débuts de l’islam jusqu’aux périodes omeyyade et abbasside : Subiya, Akkaz, Kharaib al‑Dasht, Umm al‑Aïsh, al‑Rawdatain, Umm an Namil, Miskan et le versant koweïtien du wadi al‑Batin. Une grande partie du pays reste encore à explorer, ce qui laisse entrevoir de possibles découvertes futures.
Fait souvent méconnu, le Koweït médiéval a connu des implantations chrétiennes nestoriennes de la fin de l’Antiquité tardive jusqu’au IXe siècle. Des communautés s’installèrent sur les îles de Failaka et Akkaz. À al-Qusur, sur Failaka, les fouilles ont révélé un monastère et des églises datés des VIe-VIIe siècles. Akkaz présente également les ruines d’une église médiévale. Ces découvertes témoignent d’un littoral du golfe où, à certaines périodes, des foyers chrétiens et musulmans ont coexisté, dans un paysage dominé plus au nord par les grandes capitales de l’Irak.
Dans ce puzzle historique, les périodes de creux alternent avec des phases de densité. Quand la géopolitique régionale se réorganise autour d’autres axes, les sites côtiers déclinent. Quand les routes commerciales maritimes se réactivent, ils reprennent vie. Ce mouvement de flux et de reflux annonce déjà ce qui se produira, bien plus tard, avec la montée puis la chute de la perle, puis l’irruption du pétrole.
De Grane à Koweït : naissance d’un port arabe
Lorsqu’on entre dans l’époque moderne, le décor change : la région n’est plus une marge de grands empires antiques mais un avant‑poste arabe face à l’océan Indien. Au début du XVIIIe siècle, un petit village de pêche appelé Grane (ou Kureyn) s’étend autour d’un fort, sur une éminence côtière. Ce bourg, alors sous l’autorité de l’émirat bédouin des Bani Khalid, est à l’écart des routes terrestres majeures mais bien placé pour le cabotage dans le golfe.
Le nom « Koweït » provient d’un diminutif arabe mésopotamien de « kut » (forteresse près de l’eau), ce qui correspond à la réalité historique de Grane/Koweït, un port fortifié dans un environnement désertique.
C’est à ce moment qu’intervient un acteur qui va structurer tout l’avenir du pays : la confédération tribale des Banî Utub, issue du grand ensemble des ‘Anizah du Najd. Plusieurs familles, dont les Al‑Sabah, les Al‑Khalifa et les Al‑Jalahma, migrent par vagues depuis l’intérieur de l’Arabie, en passant par le sud de l’Irak, des points de la côte iranienne et la ville de Zubara au Qatar, avant de s’installer à Grane. Une tradition veut que leur nom, « Utub », vienne de l’expression « atabu ila al‑chimal », « ils sont montés vers le nord ».
Au moment de cette installation, au milieu du XVIIIe siècle, les Banî Utub concluent une sorte de pacte interne : aux Al‑Sabah reviennent les affaires de gouvernement, aux Al‑Jalahma les activités maritimes, aux Al‑Khalifa le commerce. De ce partage des rôles naît une micro‑société tournée vers la mer, le négoce et les alliances régionales.
Le pouvoir formel reste encore rattaché aux Bani Khalid, mais leur affaiblissement, après la mort de leur chef Barrak bin Urair, permet aux Utub d’asseoir progressivement leur autonomie. La fondation de la chefferie locale est généralement datée de la décennie 1750, lorsque la communauté choisit un cheikh issu des Al‑Sabah, Sabah Ier ben Jaber. Cette désignation par consensus tribal marque le début de la dynastie qui règne encore aujourd’hui.
À la fin du XVIIIe siècle, la formule koweïtienne fonctionne à plein régime : une petite entité politique relativement autonome, un port bien placé au fond du golfe et une société qui conjugue traditions bédouines et savoir‑faire maritime. Tous les ingrédients sont réunis pour que la ville devienne un centre commercial de premier plan.
Le « Marseille du golfe » : commerce, chevaux et perles
Entre la fin du XVIIIe et le XIXe siècle, Koweït se transforme en plaque tournante régionale. Son port sert de relais au commerce entre l’Inde, Muscat, Bagdad, la Perse et l’Arabie. Quand la Perse assiège Bassora dans les années 1770, une partie des marchands irakiens se replient sur Koweït. Les routes de l’Inde vers Alep, Smyrne ou Constantinople se détournent alors vers ce port plus sûr, accélérant son essor.
À partir de la fin du XVIIIe siècle, la Compagnie britannique des Indes orientales utilise le Koweït comme escale maritime stratégique, s’appuyant sur sa flotte de boutres adaptés au golfe. Cette collaboration permet à de grands négociants koweïtiens (comme les familles Al‑Ghanim, Al‑Hamad, Hilal Al‑Mutairi, Ibrahim Al‑Mudhaf et Shamlan Ali bin Saïf Al‑Roumi) de nouer des partenariats lucratifs et de bâtir des fortunes considérables.
La ville se spécialise dans plusieurs activités. La construction nautique la place au rang de premier chantier naval du golfe : ses bateaux sillonnent toute la mer d’Oman et l’océan Indien. Dans la seconde moitié du XIXe siècle, Koweït devient également un centre majeur du commerce de chevaux arabes. On estime qu’environ 800 chevaux sont exportés chaque année vers l’Inde à cette époque, un chiffre impressionnant pour un si petit port.
L’économie du Koweït, comme celle du golfe, est rythmée par les campagnes de plongée estivales pour les perles. Elle repose sur un système complexe de dettes et d’avances, des grands marchands (tawawish) aux capitaines (nukhada) et aux équipages. Bien que socialement dure et risquée, cette industrie est très lucrative et mobilise des centaines de bateaux et des milliers d’hommes.
La combinaison du commerce maritime, du négoce caravanier, de la perle et des chevaux fait du Koweït un nœud économique singulier dans le golfe. Les voyageurs européens de la fin du XIXe parlent parfois de la ville comme du « Marseille du golfe Persique », tant sa population apparaît cosmopolite, ses quais animés, ses entrepôts bien garnis.
Mais cette prospérité reste fragile. Elle repose beaucoup sur l’habileté des cheikhs Al‑Sabah à naviguer entre les velléités ottomanes, les ambitions des nouveaux puissants de la péninsule – notamment la maison Al‑Saoud – et l’influence grandissante de la Grande‑Bretagne.
Entre Istanbul et Londres : la lente fabrication d’un protectorat
Au XIXe siècle, l’Empire ottoman tente de reprendre pied dans le golfe. À partir de Bagdad, des responsables comme Midhat Pacha cherchent à resserrer le contrôle sur les marges. Koweït, jusque‑là relativement autonome, se voit pressé d’accepter les règles fiscales et administratives ottomanes. Sous le règne de Abdullah II Al‑Sabah, le cheikh adopte un ton pro‑ottoman, prend même le titre officiel de gouverneur provincial, tout en préservant une large marge de manœuvre.
Le tournant se produit à la fin du siècle avec l’arrivée au pouvoir de Mubarak Al‑Sabah, dit « al‑Kabir » (« le Grand »). En 1896, il s’empare du pouvoir en éliminant son frère Muhammad. Confronté aux menaces turques et aux voisins bédouins, il comprend que la survie de son micro‑État passe par une alliance solide avec une puissance extérieure. Son choix se porte sur la Grande‑Bretagne.
En 1899, le cheikh Mubarak signe un accord secret avec le Royaume-Uni, marquant un tournant décisif dans l’histoire du Koweït et établissant les bases de son protectorat.
Le cheikh Mubarak s’engage à ne céder aucun territoire et à ne pas accueillir de représentants d’autres puissances sans l’accord préalable du gouvernement britannique de Londres.
En échange, le Koweït reçoit une allocation annuelle et des garanties de sécurité de la part du Royaume-Uni.
L’accord verrouille la politique étrangère koweïtienne et accorde à la Royal Navy un droit de regard conséquent sur les affaires du pays.
Londres, de son côté, se décide à soutenir le cheikh pour contrer simultanément l’influence ottomane et les projets allemands de chemin de fer Berlin‑Bagdad, qui envisageaient un terminus au Koweït. Au début du XXe siècle, un bureau politique britannique s’installe dans la ville, dirigé par un agent politique, à partir de 1904. En pratique, Koweït reste administré par la famille Al‑Sabah, mais dans un cadre de plus en plus structuré par les intérêts britanniques.
Une convention signée en 1913 entre Londres et Istanbul, bien que jamais ratifiée, tente de clarifier le statut de la chefferie : Koweït y apparaît comme un district autonome de l’Empire ottoman (kaza), placé sous l’autorité d’un qaimmaqam (en l’occurrence le cheikh), tout en maintenant un « statut spécial » lié à la protection britannique. Ce compromis bancal reflète la réalité : le cheikhdom n’est ni totalement indépendant, ni véritablement intégré à l’Empire.
À la suite de la Première Guerre mondiale et de l’effondrement de l’Empire ottoman, le Koweït est officiellement reconnu en 1914 par les Britanniques comme un « gouvernement indépendant sous protection ». Cependant, cette reconnaissance n’a pas résolu les conflits territoriaux persistants avec le Nejd, dirigé par Ibn Saoud, et avec la nouvelle monarchie irakienne.
C’est dans ce contexte qu’a lieu la conférence d’Al-Uqair en 1922, moment clé pour les frontières actuelles. Sous la houlette du haut commissaire britannique Percy Cox, les lignes séparant Irak, Nejd et Koweït sont tracées. Le cheikh de Koweït n’est même pas représenté à la table des négociations. Résultat : l’émirat perd de vastes étendues de son arrière-pays au profit du Nejd et se voit confiné à un territoire beaucoup plus réduit, tandis que l’Irak se voit attribuer un accès maritime minimal d’une soixantaine de kilomètres seulement. Beaucoup des tensions ultérieures, notamment irako-koweïtiennes, trouvent là leur origine.
Parallèlement, un blocus économique imposé par Ibn Saoud entre 1923 et 1937, puis la crise mondiale et l’effondrement de la perle naturelle dans les années 1930, mettent l’économie de Koweït à rude épreuve. Les riches marchands voient leur influence relative diminuer, tandis que la famille régnante cherche de nouvelles ressources. Elles viendront du sous‑sol.
L’irruption du pétrole : d’un port pauvre à un État pétrolier
Au milieu des années 1930, alors que les finances du cheikhdom sont fragilisées, un nouveau mot entre dans le vocabulaire local : pétrole. En 1934, une compagnie mixte, la Kuwait Oil Company, est créée par la British Anglo‑Iranian Oil Company (futur BP) et l’Américaine Gulf Oil. Deux ans plus tard, un accord de concession est signé avec le cheikh Ahmad Al‑Jaber Al‑Sabah. En 1938, le gisement géant de Burgan est découvert.
Ce champ s’avérera être l’un des plus riches de la planète. Mais la Seconde Guerre mondiale retarde l’exploitation massive. Ce n’est qu’après 1946 que les premières cargaisons de brut quittent le port, marquant le début d’une « ère dorée » qui transformera en quelques décennies un port poussiéreux en État rentier à haut revenu.
Dès les années 1950, le Koweït devient le premier exportateur de pétrole du Golfe. Les recettes massives sont utilisées pour financer un vaste programme d’équipements publics (hôpitaux, écoles, routes, port, aéroport) et pour établir les bases d’un État-providence, avec l’éducation et la santé gratuites, des subventions aux denrées et des salaires publics élevés, sous les règnes des cheikhs Ahmad et Abdullah Al-Salem Al-Sabah.
Pour gérer ces excédents, Koweït crée très tôt, dans les années 1950, un fonds souverain, la Kuwait Investment Authority. Il s’agit du premier fonds de ce type au monde. Une partie des revenus pétroliers est investie à l’étranger et dans un « fonds pour les générations futures », censé préparer l’après‑pétrole. La logique de la rente s’installe cependant solidement : le secteur public devient l’employeur dominant, et la diversification économique reste limitée.
La richesse pétrolière a transformé la capitale en remplaçant l’ancien tissu urbain (maisons en torchis et pierre de corail, ruelles étroites, souks) par une ville moderne conçue pour la voiture, avec de grandes artères et des quartiers pavillonnaires. Le mur d’enceinte du XXe siècle a été démoli dans les années 1950. Cette métamorphose, planifiée par des experts étrangers, est critiquée par certains observateurs locaux comme un « péché originel urbain » ayant sacrifié le patrimoine bâti ancien.
De la chefferie protégée à l’État indépendant
C’est dans ce contexte de boom pétrolier que se joue la question de l’indépendance politique. En 1950, Abdullah Al‑Salem Al‑Sabah accède au pouvoir. Ce cheikh, souvent présenté comme le « père de la constitution », va orchestrer la transition de protectorat à État souverain.
À la fin des années 1950, plusieurs lois structurantes sont adoptées : code de la nationalité et organisation judiciaire, loi monétaire, mise en place d’un département de la fatwa et de la législation. Le Koweït se dote de ses propres institutions administratives, en préparation d’une rupture avec le traité de 1899.
Le 19 juin 1961, un échange de lettres met fin à l’accord de protection britannique. Le Royaume-Uni conserve un rôle défensif via une déclaration d’amitié, s’engageant à aider le Koweït en cas d’agression, mais le pays accède à la pleine souveraineté et devient juridiquement l’« État du Koweït ».
L’indépendance provoque immédiatement une réaction hostile à Bagdad. Le dirigeant irakien Abd al‑Karim Qasim revendique le Koweït comme partie intégrante de son pays, au motif que le territoire aurait historiquement relevé de la province ottomane de Bassora. Face à cette menace, l’émir active la clause de défense mutuelle avec la Grande‑Bretagne. L’opération « Vantage » est déclenchée à l’été 1961 : des troupes britanniques, appuyées par des navires comme les porte‑avions HMS Bulwark et Victorious, débarquent pour dissuader toute tentative d’invasion irakienne.
Parallèlement, le Koweït cherche à s’inscrire dans le concert arabe. Il rejoint la Ligue arabe quelques semaines après son indépendance. Un contingent arabe multinational se déploie pour progressivement remplacer les forces britanniques, qui se retirent en octobre. Ce double ancrage – protection occidentale, légitimité arabe – va devenir une constante de la diplomatie koweïtienne.
Sur le plan interne, l’émir Abdullah lance la rédaction d’une constitution. Une Assemblée constituante est élue, et en novembre 1962 est promulgué un texte de 183 articles qui établit un régime d’émirat héréditaire à système parlementaire. La famille Al‑Sabah conserve la direction de l’exécutif, mais un Parlement élu, le Majlis al‑Oumma, détient des prérogatives législatives et de contrôle sur les ministres. Les premières élections législatives se tiennent en 1963, et le Koweït est admis à l’ONU la même année.
En quelques années, l’ancien cheikhdom devient donc un État moderne, membre des grandes organisations internationales, doté d’une constitution et d’institutions parlementaires. Ce choix le distingue de la plupart des autres monarchies du Golfe, où les assemblées élues resteront longtemps absentes ou très limitées.
Entre prospérité pétrolière et tensions régionales
Les décennies qui suivent sont marquées par un contraste permanent entre prospérité intérieure et environnements régionaux instables. Dans les années 1960‑1970, le Koweït apparaît comme l’un des pays les plus avancés du monde arabe en matière d’éducation, de services publics et de vie intellectuelle. Il devient un refuge pour de nombreux intellectuels arabes fuyant des régimes autoritaires, et une scène culturelle dynamique se développe : presse, maisons d’édition, revues comme Al‑Arabi, théâtre, arts plastiques.
La région a été marquée par la « guerre froide arabe », opposant notamment le nationalisme nassérien, les monarchies conservatrices et les régimes baasistes. Des événements majeurs comme la guerre de 1967, la montée en puissance des pétromonarchies après 1973, la révolution iranienne de 1979 et l’arrivée au pouvoir de Saddam Hussein en Irak ont profondément bouleversé l’équilibre régional.
Dans ce contexte, le Koweït choisit souvent une voie médiane : soutien financier aux « États de confrontation » face à Israël, appui à la cause palestinienne, tout en maintenant des liens étroits avec les États‑Unis et le Royaume‑Uni. Il est l’un des fondateurs, en 1981, du Conseil de coopération du Golfe (CCG), qui réunit les six monarchies de la région autour d’intérêts sécuritaires et économiques communs.
Pendant la guerre Iran-Irak (1980-1988), le Koweït a soutenu financièrement et logistiquement l’Irak, ce qui a provoqué des représailles iraniennes. Ces dernières ont inclus des attentats contre des intérêts occidentaux, une tentative d’assassinat contre l’émir en 1985, et des attaques contre des navires koweïtiens. Pour sécuriser ses exportations pétrolières, le Koweït a obtenu en 1987 une protection navale conjointe des États-Unis et de l’Union soviétique.
Durant ces mêmes années, le système interne montre ses fragilités. Le marché boursier parallèle de Souq al‑Manakh s’effondre en 1982, mettant en lumière des pratiques spéculatives et impliquant des personnalités proches du pouvoir. La dissolution du Parlement en 1976 puis en 1986, accompagnée de la suspension partielle de la constitution, alimente un mécontentement politique croissant, surtout parmi les élites urbaines et les milieux commerçants. Mais c’est un choc extérieur, en 1990, qui va bouleverser de façon irréversible l’histoire du pays.
L’invasion irakienne et la guerre du Golfe : traumatisme fondateur
Au lendemain de la guerre Iran‑Irak, Saddam Hussein revendique avec insistance l’effacement des dettes accumulées auprès du Koweït et de l’Arabie saoudite – environ 25 milliards de dollars pour le seul Koweït, selon certaines sources. Il accuse aussi l’émirat de pomper au‑delà de ses quotas de l’OPEP, faisant baisser le prix du baril au détriment d’un Irak exsangue, et l’accuse de « forage incliné » sur le champ partagé de Rumaila.
Les tensions montent tout au long de 1990. Les services occidentaux observent un déploiement de troupes irakiennes près de la frontière. Les tentatives de médiation arabes échouent. Dans la nuit du 1er au 2 août, l’armée irakienne lance l’opération qui conduira à l’occupation de Koweït en quelques heures. Le palais princier de Dasman est pris d’assaut ; un membre de la famille régnante, le cheikh Fahd Al‑Ahmad Al‑Jaber Al‑Sabah, est tué en défendant la résidence.
L’émir Jaber Al‑Ahmad Al‑Sabah et son gouvernement se réfugient en Arabie saoudite. Saddam Hussein installe à Koweït un gouvernement fantoche, avant d’annoncer l’annexion pure et simple de l’émirat comme « 19e province » de l’Irak. Son cousin, Ali Hassan al‑Majid, est nommé gouverneur. Les billets de dinar sont confisqués, l’économie est pillée, les musées – dont le musée national – sont dévalisés. De nombreux artefacts sont emportés vers l’Irak, dans une tentative de nier symboliquement l’identité indépendante du pays.
Sur place, une résistance koweïtienne se structure, éditant par exemple un journal clandestin, Sumoud al‑Cha’ab. Les services de sécurité irakiens réagissent par la répression : arrestations, tortures, exécutions. Environ 600 Koweïtiens sont emmenés en Irak, nombre d’entre eux resteront disparus après la guerre. La société subit aussi des fractures profondes : plus de la moitié de la population pré‑guerre fuit le pays, la communauté palestinienne, importante et perçue comme proche de l’OLP de Yasser Arafat, qui a soutenu Saddam, sera durement visée après la libération.
Sur le plan international, l’invasion provoque une réaction rapide. Le Conseil de sécurité de l’ONU condamne dès le 2 août l’agression et exige le retrait irakien. Une coalition de plus de 30 pays, conduite par les États‑Unis et soutenue par l’Arabie saoudite, se met en place. De l’automne 1990 à janvier 1991, l’opération « Desert Shield » voit l’arrivée massive de troupes alliées dans le Golfe. Le 17 janvier, la campagne aérienne d’« Desert Storm » commence, suivie d’une offensive terrestre fin février. Le 26, les forces irakiennes amorcent une retraite chaotique, marquée par les images terribles de la « route de la mort » au nord de Koweït‑City. Le 28, l’émirat est officiellement libéré.
Avant de se retirer, les troupes de Saddam incendient plus de 700 puits de pétrole. Pendant des mois, des colonnes de fumée noire obscurcissent le ciel, des lacs d’hydrocarbures se forment, la faune et la flore sont dévastées. Il faudra jusqu’à novembre pour éteindre le dernier puits. Le coût de la reconstruction est évalué à environ 70 milliards de dollars, sans compter les pertes économiques liées au pillage et à l’interruption des exportations.
Au-delà des chiffres, l’occupation de sept mois marque durablement la mémoire collective. Le Centre de recherche et d’études sur le Koweït, créé en 1992, consacre une partie importante de son travail à documenter cette période, à restaurer des centaines de milliers de documents et à préserver les témoignages du conflit. Les commémorations de la « Journée de la libération » rejoignent celles de l’indépendance comme piliers du calendrier national.
Après la guerre : reconstruction, tensions politiques et enjeux sociaux
Trois mois après la libération, en mars 1991, l’émir et le gouvernement rentrent dans une capitale meurtrie mais décidée à se relever. Un vaste programme de « rétablissement et d’urgence » est lancé : remise en état des infrastructures, prioritairement dans le secteur pétrolier, rééchelonnement des dettes internes, soutien financier aux citoyens restés sur place pendant l’occupation.
Le gouvernement rachète pour 20 milliards de dollars de dettes des banques locales, annule des milliards de prêts immobiliers et de consommation, distribue des compensations symboliques à ceux qui ont subi l’occupation. Le secteur pétrolier est remis sur pied à marche forcée, avec l’aide de firmes internationales spécialisées dans la maîtrise des incendies de puits.
La guerre a servi de catalyseur politique, renforçant les élites favorables à une vie politique plus ouverte. Après la libération, des élections législatives en 1992 ont conduit à l’installation d’un Parlement plus combatif, avec une forte présence islamiste, face à un exécutif toujours largement contrôlé par la famille Al-Sabah. Les années suivantes ont été marquées par des dissolutions d’assemblées, des remaniements gouvernementaux et des bras de fer institutionnels répétés.
Les questions de société ressurgissent aussi, comme celle du statut des Bidoon, ces populations apatrides longtemps composées en partie de familles bédouines n’ayant pas été enregistrées lors des premières lois de nationalité, ou issues de vagues migratoires anciennes. À partir des années 1980, leurs droits sociaux se réduisent sensiblement. Après la guerre, le traitement de ce dossier reste source de tension, entre revendications d’intégration et politiques de restriction voire de retrait de nationalité.
Année de l’expulsion de la majorité des Palestiniens du Koweït suite au soutien de l’OLP à Saddam Hussein.
Dans le même temps, le Koweït renforce ses liens stratégiques avec les États‑Unis. Le pays devient l’une des principales bases arrière de l’intervention de 2003 contre l’Irak de Saddam Hussein, puis joue le rôle de partenaire logistique dans différents déploiements américains dans la région. Il est désigné « allié majeur non‑membre de l’OTAN » par Washington, statut qui entérine la dépendance sécuritaire de l’émirat vis‑à‑vis de la puissance américaine.
Modernité politique sous contrainte : un parlementarisme sous pression
Le système politique institué en 1962 – un émirat héréditaire doté d’un Parlement élu – a fait du Koweït un cas à part dans le Golfe. Mais son fonctionnement reste heurté. L’émir nomme le Premier ministre, qui est presque toujours un membre de la famille Al‑Sabah, ainsi qu’un gouvernement où siègent des ministres de droit dans l’Assemblée, pouvant représenter jusqu’à un tiers des sièges. Les partis politiques formels sont interdits, mais des blocs se constituent de facto : libéraux, nationalistes arabes, islamistes sunnites (dont les Frères musulmans à travers le Mouvement constitutionnel islamique), groupes chiites, indépendants tribaux, etc.
Les périodes de tension entre le gouvernement et le Parlement sont fréquentes, avec plusieurs dissolutions de l’Assemblée. Des mobilisations populaires ont marqué certaines périodes, comme en 2006 avec le mouvement « Nabiha Khamsa » qui a réussi à réduire le nombre de circonscriptions de 25 à 5 pour limiter le clientélisme. Puis, en 2011-2012, dans le contexte des révolutions arabes, des manifestations ont dénoncé la corruption et contesté une réforme unilatérale de la loi électorale réduisant le nombre de voix par électeur.
Les autorités répondent tantôt par des concessions – comme l’octroi en 2005 du droit de vote et d’éligibilité aux femmes, puis, en 2009, l’élection de quatre députées – tantôt par des mesures plus répressives, comprenant arrestations, poursuites judiciaires, voire déchéances de nationalité pour certains opposants. Cette oscillation entretient une forme de blocage politique chronique, qui a un coût en termes de réformes économiques et de diversification, d’autant plus visible lors de la chute des prix du pétrole dans les années 2010.
Héritage culturel, archéologie et « soft power » discret
L’histoire du pays au Koweït ne se résume pas aux rivalités géopolitiques et à la rente pétrolière. En parallèle, un vaste travail de mise en valeur du patrimoine matériel et immatériel s’est développé, porté par le Conseil national pour la culture, les arts et les lettres (NCCAL), le Département des antiquités et musées, des institutions comme Dar al‑Athar al‑Islamiyyah, la Bibliothèque nationale, le Musée national, l’université du Koweït ou des fondations privées comme le musée Tareq Rajab.
Année à partir de laquelle des missions archéologiques internationales travaillent sur l’île de Failaka, proposée au patrimoine mondial de l’UNESCO.
Le patrimoine immatériel n’est pas en reste. La tradition du tissage Al‑Sadu, liée aux tribus bédouines et portée notamment par la Sadu Society, présidée par une membre de la famille Al‑Sabah, est inscrite sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité. Des pratiques comme la calligraphie arabe ou les savoirs et rituels liés au palmier‑dattier, également partagés avec d’autres pays arabes, sont reconnues par l’UNESCO. La musique et les chants marins, comme le fjiri des plongeurs en perles, les rassemblements dans les diwaniyyah, ou encore le jeu des danses d’épée ‘arda continuent d’incarner une culture qui mêle désert et mer, tradition tribale et mémoire portuaire.
Le Koweït structure sa politique culturelle via des collaborations avec des institutions internationales (UNESCO, PNUD, British Council, organismes britanniques de protection du patrimoine) dans le cadre de stratégies pluriannuelles. Le pays a été désigné Capitale de la culture arabe pour 2025, avec un programme de plusieurs centaines de jours d’événements, illustrant une approche de soft power discrète centrée sur la valorisation de son héritage culturel.
Une petite puissance aux grands défis
Aujourd’hui, le Koweït reste l’un des plus petits États du monde en superficie, mais figure parmi les plus riches en termes de revenus par habitant, grâce à des réserves pétrolières classées parmi les plus importantes du globe. Son économie demeure cependant massivement dépendante des hydrocarbures, qui représentent l’essentiel des recettes publiques. Les tentatives de diversification – qu’il s’agisse d’initiatives industrielles, logistiques ou financières, ou de projets urbains comme la « Cité de la soie » – se heurtent à la fois aux blocages politiques et à la concurrence des voisins, notamment Dubaï et le Qatar.
La société koweïtienne est caractérisée par un dualisme marqué, avec environ 70% de résidents étrangers occupant des emplois dans la construction, les services et le secteur domestique, tandis que les nationaux, majoritairement employés dans le secteur public, bénéficient d’une protection sociale élevée mais font face à des interrogations sur la soutenabilité à long terme de ce modèle économique basé sur la rente pétrolière.
La trajectoire historique du Koweït, de l’âge de pierre aux annonces de nouvelles découvertes d’hydrocarbures offshore au XXIe siècle, montre cependant une constante : la capacité de ce minuscule territoire à occuper des positions stratégiques disproportionnées par rapport à sa taille. Forteresse d’eau aux temps préislamiques, escale de Dilmun, île grecque d’Ikaros, port des chevaux arabes et des perles, relais de la Royal Navy puis tête de pont des opérations américaines, l’émirat n’a cessé d’être un point de passage, une charnière entre mondes voisins.
L’histoire du pays au Koweït est ainsi faite d’allers‑retours entre dépendances et affirmations, entre ouverture et protection, entre héritages plurimillénaires et défis très contemporains. Comprendre cette histoire, c’est saisir pourquoi ce nom, issu d’un simple diminutif arabe signifiant « petit fort près de l’eau », continue de compter dans les grandes batailles politiques, économiques et culturelles du Moyen‑Orient.
Un retraité de 62 ans, avec un patrimoine financier supérieur à un million d’euros bien structuré en Europe, souhaitait changer de résidence fiscale pour optimiser sa charge imposable et diversifier ses investissements, tout en maintenant un lien avec la France. Budget alloué : 10 000 euros pour l’accompagnement complet (conseil fiscal, formalités administratives, délocalisation et structuration patrimoniale), sans vente forcée d’actifs.
Après analyse de plusieurs destinations attractives (Koweït, Grèce, Chypre, Maurice), la stratégie retenue a consisté à cibler le Koweït pour son régime d’imposition très favorable aux non-résidents, l’absence d’impôt sur la fortune et de taxation sur la plupart des revenus du capital, combinant coût de vie maîtrisé par rapport à d’autres pays du Golfe et forte stabilité monétaire. La mission a inclus : audit fiscal pré‑expatriation (exit tax ou non, report d’imposition), obtention d’un titre de séjour via investissement ou structure professionnelle, couverture santé internationale en relais de la CNAS/CPAM, transfert de résidence bancaire, plan de rupture des liens fiscaux français (183 jours/an hors France, centre des intérêts économiques…), mise en relation avec un réseau local (avocat, immigration, conseils bilingues) et intégration patrimoniale (analyse et restructuration si nécessaire).
Vous souhaitez vous expatrier à l'étranger : contactez-nous pour des offres sur mesure.
Décharge de responsabilité : Les informations fournies sur ce site web sont présentées à titre informatif uniquement et ne constituent en aucun cas des conseils financiers, juridiques ou professionnels. Nous vous encourageons à consulter des experts qualifiés avant de prendre des décisions d'investissement, immobilières ou d'expatriation. Bien que nous nous efforcions de maintenir des informations à jour et précises, nous ne garantissons pas l'exhaustivité, l'exactitude ou l'actualité des contenus proposés. L'investissement et l'expatriation comportant des risques, nous déclinons toute responsabilité pour les pertes ou dommages éventuels découlant de l'utilisation de ce site. Votre utilisation de ce site confirme votre acceptation de ces conditions et votre compréhension des risques associés.
Découvrez mes dernières interventions dans la presse écrite, où j'aborde divers sujets.