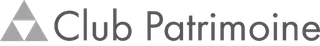Publié le et rédigé par Cyril Jarnias
Publié le et rédigé par Cyril Jarnias
L’histoire du pays Cuba est souvent racontée comme un face-à-face entre colonisateurs espagnols, esclaves africains et révolutionnaires barbus sortis de la Sierra Maestra. Mais derrière ce triptyque bien connu se cache une trame plus ancienne et plus complexe, où les voix des peuples autochtones, longtemps déclarés « disparus », reviennent aujourd’hui bousculer les certitudes. De la Cueva del Paraíso à Baracoa jusqu’aux homesteads perdus des montagnes orientales, la mémoire de Cuba ne se limite ni à 1492, ni à 1959.
Retracer l’histoire de Cuba, c’est donc raconter à la fois la conquête et la résistance, l’esclavage et les révolutions, mais aussi la lente réapparition de racines indigènes que des siècles de colonisation, de métissage et de discours savants avaient prétendu effacer.
Aux origines : Cuba, île des Taïnos et des anciens peuples
Bien avant que les caravelles de Christophe Colomb ne s’approchent des côtes de Baracoa, l’île était déjà un carrefour humain depuis des millénaires. Les plus anciens sites connus, comme Levisa, remontent au 4ᵉ millénaire avant notre ère. Des cultures néolithiques identifiées sous les noms de Cayo Redondo ou Guayabo Blanco, surtout dans l’ouest, vivaient de pêche, de chasse et de cueillette, avec des outils de pierre polie et de coquillage.
Parmi ces groupes anciens, les Guanajatabey occupent longtemps l’ouest de l’île. Ils seront repoussés vers ces marges par l’arrivée progressive de populations arawakiennes — les Ciboneys, puis les Taïnos — venues du continent sud-américain, probablement par étapes depuis le bassin de l’Amazone et la vallée de l’Orénoque.
Lorsque Christophe Colomb arrive à Cuba, les Taïnos en sont la population la plus nombreuse et la plus structurée. Ils ne sont pas isolés et cohabitent dans l’espace antillais avec d’autres peuples, comme les Guanajatabeyes à l’ouest de Cuba, les Ciguayos et les Macorix à Hispaniola. Ils sont également en conflit régulier avec les Caribs, connus pour leurs raids violents dans le sud de l’arc insulaire.
Société taïno : une Caraïbe déjà mondialisée
Les Taïnos sont des agriculteurs organisés en chefferies, les cacicazgos. L’île de Cuba en compte 29 au moment de l’arrivée européenne, dont plusieurs laissent des noms devenus emblématiques : La Havane, Baracoa, Bayamo, Camagüey, Batabanó conservent la trace lexicale de ce monde.
Leur société est hiérarchisée mais loin d’être primitive. Elle repose sur deux grandes classes sociales :
| Classe | Rôle principal | Particularités |
|---|---|---|
| Naborías | Communauté de base | Travaux agricoles, pêche, chasse, construction |
| Nitaínos | Nobles et élites locales | Chefs subalternes, guerriers, intermédiaires du pouvoir |
Au sommet trône le cacique, chef politique et religieux, dont le pouvoir est transmis par la lignée maternelle. Il vit dans une maison rectangulaire, le caney, quand le reste de la population habite des maisons circulaires, les bohíos. Les prêtres-guérisseurs, les bohíques, cumulent savoir médicinal, rôle rituel et fonction d’intermédiaires avec les divinités, les zemís.
Autour des places centrales des villages, appelées *yucayeques*, les Taïnos organisaient des cérémonies, des échanges et des danses rituelles nommées *areítos*. Cet exemple illustre la dynamique de la société taïno, qui, contrairement aux clichés d’immobilisme, était intégrée dans un vaste réseau d’échanges couvrant les Bahamas, les Grandes Antilles, le nord des Petites Antilles et jusqu’aux côtes de la Floride.
Une économie subtile : conucos, canoas et casabe
Les Taïnos ont mis au point un système agricole sophistiqué reposant sur de petites buttes, les conucos, qui assurent drainage, fertilité et protection des sols tropicaux. La culture principale est le manioc (yuca), transformé en un pain sec, le casabe, capable de se conserver longtemps.
On y associe d’autres productions essentielles :
| Produit | Usage principal |
|---|---|
| Maïs | Consommé grillé, utilisé pour une boisson fermentée (chicha), mais pas panifié |
| Haricots, courges, piments | Base de l’alimentation végétale |
| Arachides, ananas, goyaves | Consommation courante |
| Tabac | Usage médicinal et rituel (fumé ou inhalé) |
| Coton, calebasses | Textiles, contenants, objets du quotidien |
La pêche et la chasse complètent ce régime : poissons capturés au harpon, au filet, dans des nasses ou étourdis à l’aide de plantes toxiques ; lamantins, tortues, oiseaux d’eau pour la viande ; coquillages sur les racines des palétuviers. Les Taïnos utilisent de grandes pirogues, les kanoa, capables d’embarquer jusqu’à une centaine de personnes, ce qui explique la rapidité de leur expansion régionale.
L’héritage linguistique de ce monde est loin d’avoir disparu : hamaca (hamac), barbacoa (barbecue), canoa, tabaco, sabana (savane), juracán (ouragan) sont autant de mots taïnos passés dans l’espagnol, puis dans d’autres langues.
1492 : rencontre, conquête et effacement organisé
La première rencontre documentée entre Européens et Taïnos sur le territoire cubain a lieu à Baracoa en novembre 1492. Colomb décrit une population accueillante, généreuse, « simple » selon ses critères, parfois avec une admiration teintée de condescendance. Il plante une croix sur le rivage, geste inaugural d’une domination qui basculera très vite dans la violence.
De la croix à l’encomienda
En quelques décennies, la conquête espagnole transforme radicalement l’île. Diego Velázquez de Cuéllar, parti d’Hispaniola en 1511, fonde Baracoa comme premier établissement permanent et enchaîne la création des villas coloniales. La résistance autochtone est vite brisée : des chefs comme Hatuey, venu d’Hispaniola pour mobiliser les Cubains contre les envahisseurs, sont capturés et exécutés.
Le système de l’encomienda, présenté comme une protection et une évangélisation des populations, était en réalité une forme de travail forcé. Combiné à l’arrivée de maladies européennes (variole, typhus, grippe, rougeole), il a provoqué une décimation massive des populations autochtones.
Les estimations de Bartolomé de Las Casas, souvent jugées excessives, parlent de centaines de milliers de morts. Les historiens contemporains retiennent des chiffres plus bas mais tout aussi effarants. À Cuba comme à Hispaniola, la principale force de destruction est la combinaison entre violence coloniale, effondrement des structures sociales et chocs épidémiques.
Un génocide légal et administratif
Au fil du temps, la couronne espagnole cherche à encadrer les abus les plus flagrants, notamment via les Nouvelles Lois promulguées au milieu du XVIᵉ siècle. Sur le papier, les autochtones ne peuvent plus être réduits en esclavage. Dans les faits, le recours à la main-d’œuvre indigène se poursuit, jusqu’à l’effondrement démographique.
L’objectif est clair : annihiler tout fondement légal à d’éventuelles revendications foncières indigènes.
José Barreiro, intellectuel et membre de la Taíno Nation of the Antilles
Dans les tribunaux, les derniers recours autochtones échouent. La dernière plainte fondée sur des titres de propriété indigènes est rejetée en 1850. Officiellement, il n’y a plus d’« Indiens » à Cuba.
L’autre grand pilier de Cuba coloniale : l’esclavage africain
La disparition programmée des Taïnos ne signifie pas que Cuba se vide. Elle ouvre au contraire un nouveau chapitre tragique : la traite esclavagiste à grande échelle. Si les premiers captifs africains arrivent dès le XVIᵉ siècle, c’est surtout à partir de la fin du XVIIIᵉ siècle que l’île devient un des principaux récepteurs du commerce transatlantique des esclaves.
Les chiffres donnent la mesure du drame :
| Période / Indicateur | Estimation |
|---|---|
| Esclaves africains débarqués à Cuba (3 siècles) | > 600 000 (certains travaux évoquent 800 000 à plus d’un million) |
| Esclaves dans la population totale (pic) | jusqu’à près d’un tiers des habitants |
| Population esclave (1770s → 1840s) | 39 000 → ~400 000 |
| Années clés de la traite | surtout 1780–1860 |
Le boom sucrier, accentué après la Révolution haïtienne qui détruit Saint-Domingue comme concurrent, transforme l’île en « usine à sucre » du monde. Au milieu du XIXᵉ siècle, Cuba fournit près d’un tiers de la production mondiale de sucre, portée par les grandes plantations et des sucreries de plus en plus mécanisées, munies de machines à vapeur et de voies ferrées à voie étroite.
Durée en heures que pouvait atteindre une journée de travail en saison de coupe dans les plantations sucrières.
Au XIXᵉ siècle, un contexte international de plus en plus hostile à la traite et à l’esclavage amène l’Espagne à signer des traités pour limiter d’abord, puis abolir officiellement le trafic. En théorie, la traite est interdite à partir de 1820. En pratique, la contrebande se poursuit jusqu’aux années 1860, et l’esclavage lui-même n’est aboli à Cuba qu’en 1886, faisant de l’île l’un des derniers territoires du Nouveau Monde à s’en débarrasser officiellement.
Les guerres d’indépendance : vers la République, sans les Indiens
Le XIXᵉ siècle cubain est traversé par une autre grande lutte : celle pour l’indépendance vis-à-vis de l’Espagne. Trois guerres principales secouent l’île entre 1868 et 1898, dans un contexte où se mêlent revendication nationale, abolitionnisme, tensions raciales et enjeux internationaux.
De Carlos Manuel de Céspedes à José Martí, en passant par Antonio Maceo et Máximo Gómez, s’est forgée une culture politique insistant sur l’unité de tous les Cubains — blancs, métis, noirs — contre la métropole coloniale. Les insurgés, baptisés *mambises* (terme d’origine discutée devenu synonyme de guérillero indépendantiste), ont incarné cette lutte unificatrice pour l’indépendance.
Cette rhétorique de l’unité a un effet paradoxal : en dissolvant les différences, elle relègue encore davantage la spécificité autochtone. Dans la nouvelle nation en devenir, il n’y a plus de place pour des « Indiens » distincts : tout le monde, au mieux, est cubain.
Ce schéma se prolongera bien au-delà de la rupture avec l’Espagne, jusqu’après la révolution de 1959.
De l’occupation américaine à la révolution castriste : une histoire bien connue
À partir de 1898, l’histoire de Cuba est mieux documentée et plus familière : guerre hispano-américaine, occupation militaire américaine, mise en place d’une république étroitement encadrée par Washington (Platt Amendment, base de Guantánamo, interventions répétées), montée de dictatures militaires, puis renversement du régime de Fulgencio Batista par le Mouvement du 26 juillet dirigé par Fidel Castro.
La révolution de 1959 inaugure une nouvelle phase : nationalisations massives, rupture avec les États-Unis, alignement sur l’Union soviétique, crise des missiles, interventionnismes internationalistes, construction d’un État socialiste. Cette séquence a fait l’objet d’innombrables analyses, tout comme la crise économique gigantesque provoquée par l’effondrement du bloc de l’Est, connue sous le nom de « Période spéciale ».
Analyse de la place marginale accordée à l’héritage taïno face à la construction d’une identité nationale socialiste.
Dans les récits politiques, la présence et l’héritage des populations indigènes restent traités comme un élément secondaire et peu intégré.
Le pouvoir révolutionnaire promeut une identité nationale fondée sur la synthèse des héritages espagnol et africain, au sein d’un projet socialiste.
Les références aux Taïnos sont cantonnées au folklore, aux manuels scolaires et au tourisme, sans reconnaissance d’une continuité culturelle vivante.
Après 1959, la promotion d’une identité unique — celle du cubano — laisse peu de place aux expressions distinctes, qu’elles soient raciales, religieuses ou ethniques. Dans les années soviétiques, les recherches sur la présence autochtone contemporaine se heurtent souvent à l’indifférence ou au scepticisme des autorités.
C’est pourtant dans ce contexte que se prépare le retour inattendu des Taïnos.
Le choc de la Période spéciale et le retour des racines
Avec l’effondrement de l’Union soviétique au début des années 1990, Cuba perd l’essentiel de ses partenaires commerciaux et les subventions qui faisaient tourner son économie. Le pays plonge dans une crise d’une ampleur inédite, officiellement baptisée « Période spéciale en temps de paix ».
Les chiffres de ce séisme économique sont vertigineux :
| Indicateur | Évolution (1989–1993) |
|---|---|
| PIB total | -35 à -50 % |
| PIB par habitant | – plus de 50 % |
| Importations totales | -75 à -80 % |
| Exportations | – plus de 80 % |
| Production agricole | – environ 47 % |
| Production de sucre | de 7,3 à 4,1 millions de tonnes |
| Construction | – autour de 70–75 % |
| Capacité industrielle | chute pouvant atteindre 90 % |
| Pétrole importé | réduit à 10 % des niveaux antérieurs |
La vie quotidienne s’effondre : rationnement drastique, pannes d’électricité pouvant durer 16 à 20 heures par jour, transports publics quasi paralysés, pénurie de médicaments, perte de poids moyenne de la population de près de neuf kilos, épidémie de neuropathie optique liée à une carence en vitamine B.
Face à une crise, l’État adopte des mesures d’austérité comparables à une économie de guerre, tout en préservant les budgets de la santé et de l’éducation. Il est contraint de réviser ses principes économiques par plusieurs réformes : une légalisation partielle du dollar, une réhabilitation du travail indépendant, une ouverture aux investissements étrangers, une priorité donnée au tourisme, et la création d’une monnaie convertible (CUC) parallèlement au peso national.
Quand l’économie vacille, les savoirs traditionnels réapparaissent
Dans ce contexte de crise profonde, un autre phénomène se produit en sourdine : la société cubaine commence à revaloriser des savoirs et pratiques longtemps relégués à la marge. La chute du modèle soviétique, l’effritement de grands récits idéologiques et l’angoisse face à l’avenir ouvrent un espace pour la redécouverte de traditions rurales, de médecines populaires, de techniques agricoles résilientes.
Dans l’est de l’île, des communautés aux racines autochtones, évoquées par l’historien Alejandro Hartmann comme faisant partie de la « Cuba profonde », répondent à la crise par des pratiques agricoles traditionnelles. Elles cultivent le manioc, le malanga, le boniato et l’igname, pratiquent la polyculture sur de petites parcelles, utilisent des herbes médicinales et des outils simples comme la *coa* (bâton à planter). Ces méthodes redeviennent vitales face à la pénurie de carburant, d’engrais chimiques et de pièces détachées.
De manière presque involontaire, la Période spéciale contraint Cuba à renouer avec des formes de vie largement héritées du substrat taïno, même si le langage officiel continue de parler en termes de « traditions paysannes » ou de savoirs des campesinos.
Baracoa et l’archéologie vivante : « el arqueólogo » et la Cueva del Paraíso
Si l’on cherche un lieu symbolique où cette mémoire autochtone commence à se réaffirmer, il faut remonter à la pointe orientale de l’île, vers Baracoa — la première ville espagnole, mais aussi la porte d’entrée du monde précolombien cubain.
C’est là qu’un homme, Roberto Ordúñez Fernández, entame à 17 ans, il y a plus de quarante ans, une patiente collecte de vestiges dans les collines et les grottes entourant la ville. À force de fouilles, de marches sous la pluie et de coups de pioche, il met au jour un abondant matériel taïno : poteries, outils, idoles, ossements.
Les habitants le surnomment simplement « el arqueólogo ». Dans une région où les moyens institutionnels sont rares, il occupe une place singulière : autodidacte, formé au contact d’Antonio Núñez Jiménez — un ancien révolutionnaire devenu archéologue, qui avait jadis combattu aux côtés de Fidel Castro — il incarne ce pont inattendu entre la geste révolutionnaire et la quête des racines plus lointaines.
Année de l’ouverture du musée archéologique Cueva del Paraíso, seul musée explicitement dédié à la culture taïno à l’extrémité orientale de Cuba.
Dans ses vitrines, les visiteurs peuvent voir notamment les ossements découverts dans une grotte de Boma, que l’équipe d’Ordúñez identifie comme une possible sépulture du cacique Guamá, chef taïno qui mena une résistance de près d’une décennie contre les Espagnols. Sur le site lui-même, une tombe reconstituée sert de lieu de mémoire.
Pour protéger les sites archéologiques fragiles menacés par l’érosion, les constructions ou le vandalisme, l’archéologue Ordúñez met en place des fouilles encadrées, négocie le classement de terres et transforme progressivement son salon en un second musée taïno.
Archéologie, école et areítos : réinventer l’indigène
À Boma, village isolé accessible par des chemins boueux, Ordúñez conçoit un projet pédagogique simple mais ambitieux : intégrer l’archéologie et la culture taïno au programme de l’école locale. Les enfants apprennent à distinguer un mortier taïno d’un simple caillou, à respecter les sites funéraires, à reconnaître des fragments de céramique.
Le week-end, des ateliers enseignent à reconstituer les areítos, des cérémonies dansées taïnos décrites par les chroniqueurs coloniaux. Les chorégraphies et chants s’inspirent de données archéologiques et de textes anciens, mais intègrent une part de réinterprétation créative. Ce projet a un double objectif : offrir une activité structurante aux jeunes et, à terme, attirer des touristes pour générer des revenus destinés à financer le musée de Boma et d’autres projets éducatifs.
Fait significatif : l’État, longtemps réticent à laisser prospérer des expressions identitaires spécifiques, se montre ici plus tolérant, notamment parce qu’il y voit un potentiel touristique. Pour les familles du village, ces activités ont un mérite immédiat : « les enfants sont occupés », explique une habitante dont le mari se revendique d’ascendance taïna. Entre transmission culturelle, bricolage économique et gestion de l’enfance, la renaissance indigène s’enracine dans le quotidien.
Dans les grottes à l’est de Bariguá, Ordúñez et ses collègues continuent de documenter des pétroglyphes, des peintures à l’oxyde de fer représentant des silhouettes humaines, des animaux marins, peut-être un lézard. Certaines images ont été grattées, vandalisées, preuve que ce patrimoine reste vulnérable, y compris aux actions des forces armées : l’entrée de l’une des cavernes a été partiellement murée par l’armée cubaine, ne laissant qu’une meurtrière pour observer les environs.
Le Gran Cemí de Patana : un dieu taïno en exil
L’un des symboles les plus frappants de ce passé confisqué se trouve… aux États-Unis. Dans les années 1910, l’archéologue américain Mark Raymond Harrington explore les cavernes de La Patana, un ensemble de grottes perdues dans un paysage de roches tranchantes, accessibles seulement à cheval ou en vieux 4×4 branlant.
Dans l’une de ces cavernes, derrière une antichambre qui attire le regard vers le plafond et non vers le sol, il finit par remarquer une grande stalagmite d’environ 1,20 mètre de haut, sculptée en idole taïno à large base. C’est le « Gran Cemí de Patana », une représentation majeure d’une divinité, vraisemblablement installée là depuis des siècles.
Pour extraire et transporter une idole Taíno d’un site cubain, l’explorateur M.R. Harrington et son équipe la scièrent en cinq morceaux avec une scie de bûcheron à deux hommes. Les fragments, placés dans des caisses en cèdre, furent d’abord transportés à dos de mule jusqu’à Maisí, puis par bateau vers Baracoa, avant d’être expédiés à New York à bord d’un cargo norvégien. L’idole a finalement intégré la collection de George Gustav Heye et se trouve aujourd’hui dans les réserves du National Museum of the American Indian du Smithsonian, au Maryland.
Aujourd’hui, le socle du Gran Cemí est toujours visible dans la caverne de La Patana. À côté, des pétroglyphes longtemps ignorés lors des premières explorations rappellent que le lieu n’était pas un simple décor, mais un sanctuaire vivant.
Il insiste sur un principe : « travailler avec des faits » et se méfier de ce qu’il appelle les *jineteros intelectuales*, ces opportunistes du discours identitaire.
Alexis Morales Prado, ancien procureur et employé de l’Entreprise nationale pour la protection de la flore et de la faune
Un projet de musée taïno dans la région doit ouvrir ses portes, annonçait-on, vers la fin de 2016. En attendant, Morales sillonne les écoles locales pour raconter les techniques de pêche, de chasse, quelques éléments de langue, et apprendre aux enfants à distinguer une simple roche d’un objet archéologique. À La Patana, l’école compte huit élèves ; le village est pratiquement désert lors des visites. Mais dans les cartes mentales qui se redessinent, ce bout de Cuba redevient un centre, non plus une périphérie.
Des négociations de restitution du Gran Cemí sont en cours entre Cuba et les États-Unis. Le Smithsonian s’attend à recevoir une demande formelle de rapatriement. Cette perspective condense bien l’enjeu actuel : redonner à Cuba des fragments matériels de sa mémoire autochtone, longtemps exportés vers les musées du Nord.
Taïno ou pas taïno ? Gènes, coutumes et débats identitaires
La question de savoir s’il existe encore des Taïnos « vivants » fait débat depuis des décennies. Pendant longtemps, la réponse institutionnelle a été négative : les Taïnos auraient disparu, absorbés dans un métissage généralisé, ne subsistant que sous forme de traces génétiques diluées et de bribes culturelles intégrées à une « créolité » plus large.
Pourtant, un faisceau d’indices anthropologiques, historiques et génétiques invite à nuancer, voire à renverser cette vision.
Les archives disent autre chose
Dès le XIXᵉ siècle, diplomates, anthropologues et voyageurs signalent la présence de communautés à forte composante amérindienne dans l’est de Cuba : Guanabacoa, El Caney, Jiguaní, Sierra Maestra, Yateras, Baracoa. Certains parlent de familles « pur sang », d’autres de villages « réservés aux Indiens ». Des patronymes récurrents — Gainsa, Azahares, Rojas, Ramírez — se retrouvent dans ces zones de refuge.
Des chercheurs comme Irving Rouse et Manuel Rivero de la Calle ont documenté, au XXᵉ siècle, la persistance de traits physiques, de pratiques agricoles et de rituels d’origine amérindienne dans certaines populations rurales cubaines. Leurs travaux, considérés comme marginaux, contredisent le récit historiographique dominant de l’époque, qui mettait l’accent sur une dualité hispano-africaine pour des raisons idéologiques.
Les gènes confirment la continuité
Un tournant décisif vient de la génétique. Une étude réalisée à Porto Rico en 2003 montre que 61 % des personnes testées possèdent un ADN mitochondrial d’origine amérindienne. Cela signifie que, du point de vue maternel, une nette majorité de la population descend de femmes autochtones. Ces données sont cohérentes avec ce que l’on sait de la dynamique coloniale : hommes européens prenant des épouses ou compagnes indigènes, puis, plus tard, métissage avec des Africains réduits en esclavage.
Des recherches analogues dans d’autres îles (Porto Rico, République dominicaine) et en Amérique du Sud confirment l’idée que la disparition proclamée des Taïnos relève plus d’un discours politique que d’un constat biologique.
Le fait de reconnaître une créolisation, un mélange des patrimoines, n’implique pas la disparition des composantes indigènes. Au contraire, on peut parler de continuité amérindienne au sein même des sociétés créoles.
Anthropologues Antonio Curet et Ranald Woodaman
Être Taïno, être Cubain : entre coutumes et ressentis
À Cuba, la question reste délicate. Pour l’historien de Baracoa, Alejandro Hartmann, l’identité taïno contemporaine se définit moins par des traits physiques que par un ensemble de pratiques et de croyances : respect de la « mère terre » et du « père soleil », demande de permission à des entités comme Osaín avant de récolter, usage cérémoniel des arbres sacrés, persistence de certaines formes de sociabilité rurale.
Selon Hartmann, la véritable identité cubaine (cubanía) réside dans les campagnes de l’Oriente, où se mêlent des influences espagnoles et africaines. Elle se manifeste par l’usage d’outils traditionnels comme la coa et les charrues à bœufs, et se perpétue à travers les récits oraux évoquant les ancêtres qui se cachaient dans les ravins pour fuir les expropriations.
Beaucoup de personnes interrogées dans l’est de Cuba alternent entre des auto-désignations ambiguës : « Indio », « mestizo », « Cubain », selon le contexte, la situation administrative, le regard extérieur. Dans un salon de tatouage à Baracoa, on propose des motifs aztèques ou mayas, mais rarement des symboles taïnos, révélant un paradoxe : l’indigène globalisé est plus visible que l’indigène local.
Pour l’artiste Mildo Matos, né dans la province de Guantánamo, la prise de conscience de ses racines taïnas a été progressive. Sa famille vivait dans des bohíos, mangeait du casabe, cultivait des variétés anciennes, pratiquait des rituels discrets. Ce n’est qu’en quittant son village pour aller à l’école d’art en ville qu’il a compris le caractère singulier de ce mode de vie. Aujourd’hui, il peint des dieux taïnos avec une esthétique surréaliste inspirée des traditions européennes : une manière de montrer que l’identité indigène contemporaine est aussi un processus d’interprétation personnelle, de dialogue entre héritages.
La grande famille Rojas-Ramírez : un cacique dans la Cuba révolutionnaire
Parmi les communautés qui symbolisent cette survivance amérindienne, les familles Rojas-Ramírez occupent une place particulière. Dispersées dans plus de vingt localités de l’est de Cuba, elles forment ce que Hartmann appelle « la Gran Familia » — environ 4 000 personnes qui partagent des liens de parenté, une histoire de déplacements forcés et une mémoire des temps où les Indiens vivaient dans des villes juridiquement reconnues, comme San Luis de los Caneyes (El Caney), près de Santiago.
Au XIXᵉ siècle, lorsque la monarchie espagnole révoque la juridiction indienne d’El Caney en 1850, beaucoup de ces familles sont poussées vers des zones plus reculées, des palenques de montagne comme La Ranchería ou La Escondida, dans la municipalité de Caridad de los Indios. Là, elles aménagent de petites exploitations où manioc, malanga, boniato, riz, maïs et haricots prospèrent sur des pentes abruptes.
Panchito Ramírez, cacique depuis plus de quarante ans, a consacré trente ans à rendre visible l’existence de sa communauté élargie auprès des chercheurs et des autorités. Son action représente un tournant dans un pays où les leaders autochtones étaient historiquement marginalisés ou ignorés.
En 2014, il présente sa communauté lors d’une conférence nationale et internationale sur les cultures indigènes, brisant symboliquement la barrière de l’« extinction ». Sa fille Idalis l’accompagne dans ces démarches de représentation. Lorsque sa petite-fille est baptisée, c’est une femme de 94 ans, Doña Luisa, qui officie, mêlant eau, herbes et prières adressées au soleil et à la lune. Une cérémonie « presque chrétienne », dit-on, mais dont l’architecture rituelle renvoie clairement à des cosmologies préchrétiennes.
Pour Panchito, l’essentiel réside dans le respect global : de l’enfant, des parents, de la communauté, de la nature et de Dieu — un Dieu qui n’est plus uniquement celui des catéchismes, mais aussi celui des montagnes et des ancêtres.
Panchito
Quand les savoirs indigènes sauvent des vies
La trajectoire de la famille Rojas-Ramírez éclaire un autre aspect souvent oublié : le rôle de ces communautés dans la résilience du pays pendant la Période spéciale. Quand les grandes fermes d’État s’effondrent faute de carburant et de pièces détachées, et que les importations de nourriture se raréfient, ce sont les cultures traditionnelles des « Indios campesinos » des montagnes qui permettent à bien des familles d’éviter la famine.
Les tubercules rustiques, les plantes médicinales, les techniques de conservation ancestrales offrent des filets de sécurité là où le système industriel a failli. Aujourd’hui, de jeunes chercheurs et militants se penchent sur cette « indigenidad en la cubanía », cette présence indigène dans la cubanité, pour la documenter, la valoriser et la transmettre.
Spiritualités, mythes et objets : une cosmologie toujours parlante
Au cœur de la vision du monde taïno, passée et réinterprétée, se trouvent les zemís, ces esprits-divinités associés à des forces naturelles, à des ancêtres, parfois matérialisés sous forme d’idoles de bois, de pierre ou de terre cuite. Parmi les plus importants :
| Zemi | Domaine / fonction |
|---|---|
| Atabey | Lune, eaux douces, fertilité, maternité |
| Yúcahu | Manioc, mer, abondance alimentaire |
| Iguanaboína | Météo favorable |
| Boinayel et Marohu | Pluie et ciel clair |
| Baibrama | Croissance du manioc |
| Maquetaurie Guayaba | Terre des morts |
| Opiyelguabirán | Gardien des âmes, sous forme de chien |
| Deminán Caracaracol | Héros culturel, ancêtre mythique |
Des pétroglyphes représentant ces figures sont gravés dans la roche de sites comme La Patana. Certains zemís prennent forme de pierres à trois pointes, plantées dans les conucos pour protéger les cultures, d’autres comportent des plateaux destinés à recevoir des poudres hallucinogènes, comme la cohoba, prise lors de cérémonies pour communiquer avec l’invisible.
Lors de l’exploration des grottes, un visiteur a découvert *La Muñequina*, une petite figurine tridimensionnelle taïno. Elle combine les traits d’une grenouille (symbolisant la vie), d’un crâne (représentant la mort) et d’une chouette (évoquant les âmes errantes). Cette triade illustre la conception taïno d’un monde aux frontières poreuses entre vivants, morts, humains, animaux et objets, où les défunts reviennent sous de nouvelles formes et participent à de nouveaux cycles.
Quand aujourd’hui des artistes comme Mildo Matos réinterprètent ces figures dans leurs tableaux, ou quand des communautés de l’est de Cuba adressent encore des prières à la lune et au soleil, c’est cette continuité symbolique qui se manifeste, malgré les ruptures historiques.
Une histoire cubaine réécrite depuis les marges
Relire l’histoire du pays Cuba à partir de ces fragments, c’est accepter qu’elle ne se réduit ni à la « découverte » de 1492, ni à l’épopée révolutionnaire de 1959. C’est reconnaître qu’entre les deux, et au-delà, des peuples et des pratiques ont été systématiquement relégués hors du récit national.
Il ne s’agit pas de nier l’importance des apports espagnols, africains, chinois ou d’autres migrations dans la formation de la société cubaine. Ni de prétendre qu’il existerait aujourd’hui des Taïnos « purs », figés dans le temps. Les communautés indigènes contemporaines sont des produits de siècles de métissage, de déplacements, d’ajustements.
Mais les données archéologiques, les archives coloniales, les études génétiques et les témoignages actuels convergent pour affirmer au moins trois choses :
Contrairement à une idée reçue, les populations autochtones de Cuba n’ont jamais totalement disparu. Elles ont évolué par un processus de métissage et d’adaptation, mais des traces significatives perdurent. Des lignées biologiques, des pratiques culturelles et des identités conscientes subsistent encore aujourd’hui, particulièrement dans la région orientale de l’île.
2. Leur effacement a été autant politique et symbolique que démographique. L’imposition de patronymes espagnols, la suppression des juridictions indiennes, la négation savante de leur existence ont servi des intérêts coloniaux et nationaux, en simplifiant le récit identitaire.
3. La crise économique et idéologique de la fin du XXᵉ siècle a rouvert un espace pour leur réapparition. Période spéciale, effondrement soviétique, ouvriront paradoxalement la voie à une redécouverte des savoirs indigènes, à l’essor d’initiatives comme les musées de Baracoa et de Maisí, et à la prise de parole publique de caciques comme Panchito Ramírez.
Les projets d’Ordúñez, Morales, Hartmann, Matos et des familles Rojas-Ramírez ne sont pas de simples curiosités régionales. Ils s’inscrivent dans un mouvement plus large qui participe à redéfinir ce que signifie être cubain à notre époque.
L’histoire du pays Cuba se lit alors comme un palimpseste : sur l’écriture coloniale et républicaine, puis socialiste, réapparaissent les traces plus anciennes d’une île façonnée par les voyages des Arawaks, les chants des areítos, les fumées du tabac rituel et les sillons tracés à la coa. La tâche historique et politique qui s’ouvre consiste moins à opposer ces couches qu’à apprendre à les lire ensemble.
Car derrière le slogan souvent entendu dans les montagnes de l’Oriente — « nous sommes Cubains avant tout » — se glisse aujourd’hui une nuance nouvelle : « mais nous n’avons jamais cessé d’être aussi, d’une certaine manière, Taïnos ».
Un retraité de 62 ans, disposant de plus d’un million d’euros de patrimoine financier bien structuré en Europe, souhaite transférer sa résidence fiscale à Cuba pour optimiser sa fiscalité, diversifier ses investissements internationaux et conserver un lien fort avec la France. Budget : 10 000 € pour un accompagnement complet (conseil fiscal international, formalités migratoires, délocalisation logistique, structuration patrimoniale), sans vente forcée d’actifs existants.
Après étude de plusieurs destinations (Portugal, République dominicaine, Mexique, Panama), la stratégie retenue consiste à cibler Cuba, combinant coût de vie nettement inférieur à la France, climat tropical, proximité avec l’Amérique du Nord et possibilité d’investissements ciblés (tourisme, immobilier via structures adaptées). La mission inclut : audit fiscal pré-expatriation (exit tax, conventions fiscales applicables), obtention du droit de résidence à Cuba, structuration des flux de revenus via l’Europe, plan de rupture des liens fiscaux français (183 jours/an hors France, centre d’intérêts économiques), ouverture de comptes adaptés, mise en relation avec un réseau local francophone/anglophone (avocat, immigration, comptable) et stratégie patrimoniale globale (protection, transmission, diversification géographique).
Vous souhaitez vous expatrier à l'étranger : contactez-nous pour des offres sur mesure.
Décharge de responsabilité : Les informations fournies sur ce site web sont présentées à titre informatif uniquement et ne constituent en aucun cas des conseils financiers, juridiques ou professionnels. Nous vous encourageons à consulter des experts qualifiés avant de prendre des décisions d'investissement, immobilières ou d'expatriation. Bien que nous nous efforcions de maintenir des informations à jour et précises, nous ne garantissons pas l'exhaustivité, l'exactitude ou l'actualité des contenus proposés. L'investissement et l'expatriation comportant des risques, nous déclinons toute responsabilité pour les pertes ou dommages éventuels découlant de l'utilisation de ce site. Votre utilisation de ce site confirme votre acceptation de ces conditions et votre compréhension des risques associés.
Découvrez mes dernières interventions dans la presse écrite, où j'aborde divers sujets.