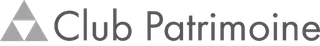Publié le et rédigé par Cyril Jarnias
Publié le et rédigé par Cyril Jarnias
L’Uruguay occupe un coin discret de l’Amérique du Sud, coincé entre les géants argentin et brésilien. Pourtant, son histoire ressemble à un concentré de tous les grands thèmes du continent : colonisation disputée, caudillos rivaux, guerres civiles interminables, immigration massive, expériences sociales audacieuses, guérilla urbaine, dictature puis réformes démocratiques radicales. Retracer l’histoire du pays Uruguay, c’est suivre le passage d’un territoire marginal à un État qui se rêve « petit pays modèle ».
Des peuples originaires à la convoitise coloniale
Bien avant l’arrivée des Européens, le territoire de l’actuel Uruguay est peuplé depuis environ 13 000 ans par des communautés de chasseurs‑cueilleurs. Au moment du contact, on estime à quelque 9 000 le nombre de Charrúas et à environ 6 000 celui des Chanás et Guaranis, aux côtés d’autres groupes comme les Aracháns. Ces peuples ne forment pas de grands États centralisés, ce qui pèsera lourd dans leur confrontation avec les empires européens.
Au XVIᵉ siècle, la région du Río de la Plata a d’abord été explorée par les Portugais (1512-1513) puis par les Espagnols (Juan Díaz de Solís en 1516, Sebastian Cabot en 1526). Ce dernier y fonda le premier établissement européen, San Lázaro, en 1527. Cependant, l’absence de métaux précieux et la résistance des populations indigènes ont retardé une colonisation massive, rendant la présence européenne initiale fragile.
Un tournant intervient au XVIIᵉ siècle. En 1603, Hernando Arias de Saavedra introduit du bétail : les troupeaux, livrés à eux‑mêmes, prolifèrent sur les prairies orientales. La base de l’économie rurale future est en place. En 1624, des Jésuites fondent Villa Soriano sur le Río Negro, premier établissement espagnol permanent du territoire.
À la fin du XVIIᵉ siècle, pour contrer l’établissement portugais de Colônia do Santíssimo Sacramento (1680) sur la rive nord du Río de la Plata, la Couronne espagnole renforce sa présence dans la région. Sur ordre royal, vingt-cinq familles des îles Canaries sont transférées dans la Banda Oriental et participent, en 1726, à la fondation de Montevideo. Cette nouvelle ville est conçue comme une place forte militaire et un port de commerce pour faire face à l’avancée portugaise.
Un traité clé, celui de Madrid en 1750, confirme la mainmise espagnole sur la Banda Oriental. Puis, en 1776, la couronne crée le vice‑royaume du Río de la Plata, avec Buenos Aires pour capitale, intégrant l’actuel Uruguay à un vaste ensemble administratif. À la veille des indépendances, Montevideo dépasse les 10 000 habitants, la campagne environnante en compte environ 20 000 de plus, et les esclaves africains représentent près de 30 % de la population : un fait souvent oublié dans le récit national.
Artigas et la gestation de la nation orientale
La rupture avec l’ordre colonial naît de la tourmente provoquée par les guerres napoléoniennes. Le 25 mai 1810, Buenos Aires renverse l’autorité espagnole : c’est la Révolution de Mai, qui ouvre la voie à l’indépendance des Provinces Unies du Río de la Plata. De l’autre côté du fleuve, un officier de cavalerie va jouer un rôle décisif : José Gervasio Artigas.
Né en 1764 à Montevideo dans une famille aisée de propriétaires terriens, Artigas a grandi à la campagne, au contact des gauchos et des peuples indigènes. Cavalier émérite, excellent tireur, il a d’abord mené une vie trouble de trafiquant de bétail avant d’obtenir un pardon en échange de son engagement dans le corps des Blandengues. Il combat les Britanniques lors des invasions de 1806‑1807 et participe à la défense de Montevideo.
Influencé par les Lumières, il se rallie à la junte révolutionnaire de Buenos Aires en 1810 mais a sa propre vision de la rupture avec l’Empire espagnol. Le 26 février 1811, il lance un appel à la guerre contre l’autorité coloniale. Quelques mois plus tard, le 18 mai 1811, il remporte la bataille des Piedras sur les forces espagnoles et entreprend le siège de Montevideo.
José Gervasio Artigas, Premier chef des Orientaux
Très vite, les intérêts divergent entre Buenos Aires, centraliste et méfiante, et Artigas, partisan d’un fédéralisme radical. Quand la capitale conclut une trêve avec le représentant espagnol Francisco Javier de Elío en 1811, en échange d’un retrait portugais, le caudillo oriental se sent trahi. Il choisit l’exil intérieur, entraînant des milliers de familles dans l’« Exodus du peuple oriental » vers la rive argentine du fleuve Uruguay, près de l’actuelle Concordia. Ce drame fondateur marque profondément la mémoire uruguayenne.
En 1815, José Artigas fédère plusieurs provinces en une Ligue Fédérale, proclamant leur indépendance de l’Espagne et revendiquant un modèle républicain et fédéral avec de larges autonomies provinciales, la liberté civile et religieuse, et une capitale distincte de Buenos Aires. Il adopte également un drapeau spécifique, barré de rouge pour symboliser le fédéralisme.
Sa vision ne se limite pas aux institutions. En septembre 1815, un règlement provisoire pour la Province orientale pose une des premières tentatives de réforme agraire du continent : redistribution des terres, priorité accordée aux plus démunis, aux noirs libres, aux zambos, aux indigènes. Cet Artiguismo, nourri de lectures révolutionnaires nord‑américaines et françaises, en fait l’« apôtre du fédéralisme » autant que le « père de la nation uruguayenne ».
De la province cisplatine à l’État indépendant
Ce projet se heurte cependant à deux forces convergentes : l’hostilité de Buenos Aires, adepte d’un État centralisé, et l’intervention portugaise. Dès 1816, le Royaume Uni de Portugal, Brésil et Algarve envahit la Banda Oriental, avec la passivité bienveillante des autorités du Río de la Plata. Le général Carlos Frederico Lecor s’empare de Montevideo le 20 janvier 1817. Artigas poursuit la lutte dans la campagne pendant plusieurs années, mais, vaincu à Tacuarembó en 1820, il doit fuir au Paraguay, où il vivra en exil pendant trois décennies.
C’est le nombre de patriotes, les ‘Trente-Trois Orientaux’, menés par Juan Antonio Lavalleja, qui se sont soulevés contre la domination brésilienne en 1825.
Le 19 avril 1825, ce petit groupe d’exilés débarque sur la côte du Río de la Plata, à Agraciada. Rapidement rejoint par d’autres chefs comme Fructuoso Rivera, il s’empare de plusieurs localités et installe, le 14 juin, un gouvernement provisoire à Florida. Le 25 août 1825, une assemblée y proclame la séparation de Cisplatine du Brésil et son union aux Provinces Unies du Río de la Plata. Le geste déclenche la guerre dite « cisplatine » entre l’Argentine et l’Empire du Brésil.
Cette guerre, marquée par des batailles terrestres (Sarandí, Ituzaingó) et un blocus naval brésilien de Buenos Aires, s’éternise. Ni l’Empire ni les Provinces Unies ne parviennent à s’assurer un avantage décisif. Londres, inquiet de la paralysie du commerce du Río de la Plata, entre alors en scène. Sous l’impulsion du diplomate britannique John Ponsonby, les belligérants acceptent une solution médiane : un État tampon indépendant. La convention préliminaire de paix, dite Traité de Montevideo, signée le 27 août 1828, reconnaît la naissance de la République Orientale de l’Uruguay. Les frontières sont fixées, le Brésil conservant certaines zones missionnaires à l’est.
En contrepartie de cette indépendance, l’Uruguay s’inscrit dans un jeu d’équilibres régionaux complexe. La jeune république devient un espace charnière où s’affrontent régulièrement les influences brésilienne et argentine, sur fond de rivalités internes.
La naissance de l’État et l’ombre des caudillos
La première constitution uruguayenne, promulguée le 18 juillet 1830, est fortement inspirée des modèles français et états‑unien. Elle institue une république unitaire à pouvoir exécutif présidentiel, dans un cadre de séparation classique des pouvoirs. Le président est élu par l’Assemblée générale pour quatre ans ; le territoire est découpé en départements, dirigés par des gouverneurs nommés.
Après l’indépendance, la jeune nation est dirigée par des figures militaires issues de la guerre contre le Brésil, les ‘Trente-Trois’.
Élu premier président de l’Uruguay le 6 novembre 1830. Ancien compagnon d’armes de Manuel Oribe.
Succède à Rivera à la présidence en 1835. Figure centrale issue des ‘Trente-Trois’.
Demeure une référence politique majeure pour une partie de l’élite ruraliste, bien que n’ayant pas été président dans cette première période.
Très vite, la rivalité entre Rivera et Lavalleja, puis entre Rivera et Oribe, dégénère en affrontements armés. Dès 1832, les partisans de Lavalleja tentent d’assassiner Rivera ; la garnison de Montevideo se soulève pour réclamer la nomination de leur chef comme commandant en chef. Rivera réagit, bat Lavalleja à Tupambaé et le repousse vers le Rio Grande do Sul brésilien.
Au milieu des années 1830, les clivages politiques durables de l’Uruguay émergent. En 1836, la rébellion de Fructuoso Rivera contre le président Manuel Oribe conduit à la création des deux partis traditionnels. Les partisans d’Oribe adoptent un brassard blanc, devenant les Blancos. Ceux de Rivera arborent d’abord du bleu, puis du rouge, devenant les Colorados. Ces couleurs représentent des intérêts socio-économiques distincts : les Blancos défendent les grands domaines agricoles de l’intérieur et un protectionnisme favorable aux propriétaires terriens (estancieros), tandis que les Colorados représentent plutôt les milieux urbains et commerçants de Montevideo, favorables au libre-échange.
Les premières batailles de cette longue confrontation interne rythment les années 1830 : Carpintería, Yucutujá, Palmar. Avec l’appui du Brésil et, bientôt, de la France, Rivera finit par renverser Oribe, qui se réfugie à Buenos Aires en 1838. Mais ce n’est qu’un épisode d’une guerre civile qui va prendre une tout autre dimension : la Guerra Grande.
La Guerra Grande : l’Uruguay au cœur des rivalités atlantiques
La « Grande Guerre » uruguayenne, officiellement datée de 1839 à 1851, déborde largement les frontières du pays. Elle oppose d’abord les deux partis uruguayens, Blancos d’Oribe et Colorados de Rivera, mais elle se greffe sur le grand affrontement régional entre le caudillo argentin Juan Manuel de Rosas et ses opposants fédéralistes ou unitaires, et sur les interventions de puissances européennes soucieuses de contrôler la navigation sur le Río de la Plata.
En 1842, Oribe, soutenu par Rosas, inflige à Rivera une lourde défaite à Arroyo Grande. L’année suivante, il met le siège devant Montevideo. Commence alors le célèbre « Grand siège » de la capitale, qui va durer près de neuf ans. Le pays se retrouve littéralement divisé en deux États rivaux : à Montevideo, le « Gouvernement de la Défense » présidé par Joaquín Suárez, dominé par les Colorados et protégé par les marines britannique et française ; dans le reste du territoire, le « Gouvernement du Cerrito » dirigé par Oribe, reconnu par la Confédération argentine.
Population totale de Montevideo lors du siège de 1843, dont seulement un tiers était uruguayen.
Montevideo assiégée, vitrine d’un conflit global
Pour Londres et Paris, l’enjeu dépasse la survie d’une petite république : il s’agit de garantir la libre navigation sur les fleuves Paraná et Uruguay, vitale pour le commerce vers l’intérieur du continent. Les deux puissances imposent un blocus naval à Buenos Aires en 1845, protègent Montevideo depuis la mer, tout en jouant un jeu diplomatique complexe avec Rosas. Alexandre Dumas, fasciné par l’héroïsme et la durée du siège, parlera d’un « nouveau siège de Troie ».
Le conflit tourne à l’impasse. Rivera est finalement mis hors de jeu, les finances des uns et des autres sont exsangues, et la lassitude gagne même les soutiens européens. En 1850, France et Royaume‑Uni, après avoir négocié un accord favorable à Rosas, retirent leurs flottes. La solution viendra finalement du cœur même de la Confédération argentine.
Justo José de Urquiza, gouverneur d’Entre Ríos, se rebelle contre Rosas avec l’appui du Brésil et des Colorados uruguayens. En 1851, les forces d’Oribe sont vaincues en Uruguay ; l’année suivante, l’armée de coalition remporte la bataille décisive de Caseros, près de Buenos Aires. Rosas s’enfuit en exil en Grande‑Bretagne. Le siège de Montevideo est levé, Oribe se retire. Les Colorados sortent maîtres de l’Uruguay, mais au prix d’une dépendance accrue à l’égard du voisin brésilien.
Les traités de 1851 : l’indépendance sous garantie brésilienne
En reconnaissance du soutien militaire et financier reçu, le gouvernement de Montevideo signe en 1851 cinq traités avec l’Empire du Brésil. Ces textes instaurent une alliance permanente entre les deux pays. L’Uruguay accepte de livrer les esclaves fugitifs et les criminels réfugiés sur son sol, même si, ironie de l’histoire, Blancos comme Colorados ont aboli l’esclavage pendant la guerre pour élargir leurs troupes.
La superficie de l’Uruguay est fixée à environ 176 000 km² suite à la renonciation de ses revendications territoriales au nord du Río Cuareim.
Les conséquences économiques de la Guerra Grande sont lourdes : le cheptel bovin, pilier de la richesse du pays, chute d’environ 6,5 millions de têtes à 2 millions. Mais la guerre a aussi consolidé deux faits durables : l’ancrage définitif de l’indépendance uruguayenne et la structuration de la vie politique autour du duel Colorado‑Blanco.
Un XIXᵉ siècle marqué par la guerre civile et la construction lente de l’État
Entre 1830 et 1903, l’Uruguay connaît une quarantaine de soulèvements, coups de force et guerres civiles. La rivalité entre Colorados, généralement au pouvoir, et Blancos, souvent révoltés depuis l’intérieur rural, dégénère régulièrement en conflits armés. La Guerra Grande n’est que la plus spectaculaire de ces crises.
Après 1852, une tentative de rapprochement des élites échoue. En 1864-1865, la guerre de l’Uruguay éclate : le caudillo colorado Venancio Flores, soutenu par l’Argentine, se révolte contre le gouvernement blanco. Le Brésil intervient militairement, invoquant la protection de ses ressortissants (près de 18% de la population uruguayenne). L’alliance de Flores et de l’Empire brésilien assiège et prend plusieurs villes, dont Montevideo, entraînant la capitulation des Blancos en février 1865. Cette victoire instaure l’hégémonie colorada en Uruguay et contribue indirectement au déclenchement de la guerre de la Triple Alliance contre le Paraguay.
La fin du XIXᵉ siècle voit pourtant l’amorce d’un compromis. Après la sanglante Révolution des Lances (1870‑1872), menée par le chef blanco Timoteo Aparicio, un accord reconnaît aux Blancos le contrôle de quatre départements ruraux (Canelones, San José, Florida, Cerro Largo), tandis que les Colorados gardent Montevideo et la frange côtière. Ce système de partage de postes, appelé coparticipación, cherche à désamorcer les rébellions en garantissant une part du pouvoir à l’opposition.
Les derniers soulèvements, menés notamment par Aparicio Saravia, prennent fin au début du XXᵉ siècle. La défaite décisive des Blancos à la bataille de Masoller en 1904, où Saravia est mortellement blessé, marque la fin des conflits armés. Cette période est considérée par les historiens comme la « seconde fondation » de la République, avec une transition progressive des armes vers le processus démocratique et les urnes.
Immigration massive et mutation démographique
Parallèlement à ces déchirements internes, l’Uruguay se transforme profondément sur le plan démographique. À l’indépendance, la population ne dépasse pas 75 000 habitants. Un siècle plus tard, elle approche le million, largement à la faveur de l’immigration européenne. Entre le dernier tiers du XIXᵉ siècle et la Seconde Guerre mondiale, le pays accueille plus de 600 000 arrivants venus du Vieux Continent, principalement d’Espagne et d’Italie, mais aussi de France, d’Allemagne, de Suisse, de l’Empire austro‑hongrois ou encore du Proche‑Orient.
Un simple tableau permet de visualiser quelques jalons de cette transformation :
| Période / repère | Indicateur clé |
|---|---|
| Vers 1800 | Montevideo > 10 000 hab., province +20 000, 30 % esclaves |
| Indépendance (vers 1830) | Population totale < 75 000 |
| 1860 | Environ 30–34 % de la population est née à l’étranger |
| 1889 (Montevideo) | 47 % de la population est étrangère |
| 1908–1910 | Environ 17 % de la population est d’origine étrangère |
| 1911 | Population ≈ 1,4 million |
| Aujourd’hui | 90–95 % de la population d’ascendance européenne |
À la fin du XIXᵉ siècle, Montevideo est une véritable ville cosmopolite. En 1889, près de la moitié de ses habitants sont nés à l’étranger ; parmi les adultes de plus de 20 ans, les immigrés représentent plus de 70 %. Italiens et Espagnols dominent, mais les Français forment la troisième grande communauté : dans les années 1840 déjà, ils représentent près du tiers des habitants de la capitale. Des colons suisses, allemands et autrichiens fondent Nueva Helvecia en 1862, des vaudois piémontais créent Colonia Valdense ; des Basques, des Juifs ashkénazes et séfarades, des Libanais maronites, des Polonais, des Russes, des Ukrainiens, des Arméniens s’installent également.
L’arrivée massive d’immigrants européens en Uruguay au XIXᵉ siècle a nourri l’image d’un ‘petit Europe’ en Amérique du Sud. Cette politique a directement contribué au blanchiment démographique et à la marginalisation des populations indigènes, culminant avec le massacre des Charrúas en 1831 à Salsipuedes, ordonné par le président Rivera. Paradoxalement, ce bouillonnement culturel et social a aussi créé les conditions permettant l’émergence, au tournant du XXᵉ siècle, d’une expérience politique singulière dans le pays.
Au début du XXᵉ siècle, l’Uruguay reste un pays agropastoral, mais relativement prospère grâce à l’exportation de viande et de laine. Le contexte international – forte demande durant les guerres mondiales – et l’absence de grandes fractures ethniques ou religieuses favorisent une certaine stabilité. C’est dans ce cadre que se déploie l’œuvre de José Batlle y Ordóñez, figure majeure de l’histoire du pays.
Journaliste de formation, directeur du quotidien El Día, Batlle entre en politique sous la bannière colorada, s’oppose aux dictatures militaires de la fin du XIXᵉ siècle et devient président en 1903. Son premier mandat est marqué par la dernière guerre civile contre les Blancos d’Aparicio Saravia, mais aussi par un vaste programme de réformes. Réélu en 1911, il va façonner ce qu’on appellera le batllisme, mélange original de libéralisme politique, d’interventionnisme économique et de réformisme social.
L’État‑providence à l’uruguayenne
Sous son impulsion, l’Uruguay adopte un ensemble de mesures qui feront sa réputation de « Suisse de l’Amérique » :
Ces mesures comprennent la généralisation de l’école primaire gratuite, laïque et obligatoire, l’élargissement de l’accès à l’enseignement secondaire et universitaire (notamment pour les femmes), ainsi que l’instauration de droits sociaux fondamentaux comme la journée de 8 heures, le repos hebdomadaire, l’indemnisation des accidents du travail, les pensions de vieillesse et une compensation en cas de licenciement.
Un court tableau résume quelques jalons sociaux emblématiques :
| Domaine | Mesure majeure (période batlliste) |
|---|---|
| Temps de travail | Journée de 8 heures, repos hebdomadaire obligatoire |
| Protection | Pensions de vieillesse, indemnisation des accidents du travail |
| Travail féminin | « Loi de la chaise » obligeant à prévoir un siège pour les employées |
| Famille | Légalisation du divorce (d’abord par consentement, puis à la demande de l’épouse) |
| Peine capitale | Abolition de la peine de mort |
En matière de libertés individuelles, l’Uruguay de Batlle est en avance sur son temps : la peine de mort est supprimée, le divorce est légalisé dès 1907 et élargi en 1913, et la séparation de l’Église et de l’État est progressivement mise en pratique. L’enseignement religieux est exclu des écoles publiques, les crucifix sont retirés des hôpitaux, les références à Dieu disparaissent des serments officiels.
Nationalisations stratégiques et capitalisme encadré
Sur le plan économique, Batlle n’est pas socialiste, mais il refuse de livrer les secteurs clés au capital étranger. Il encourage la création ou la nationalisation de grandes entreprises publiques : banque de la République (BROU), banque d’assurance d’État, banque hypothécaire, compagnies d’électricité, de tramways, de chemins de fer, télégraphes, puis, plus tard, monopole public sur les carburants, l’alcool et le ciment. L’objectif est double : offrir des services à bas prix et éviter la fuite de profits vers l’extérieur.
Le schéma proposé, bien que compatible avec l’initiative privée, repose sur une vision interventionniste de l’État, conçu comme un arbitre et protecteur des plus faibles. Sur le plan fiscal, Batlle s’inspire des idées géorgistes : il privilégie la taxation de la rente foncière plutôt que celle des revenus du travail, considérant l’impôt sur le revenu comme une pénalisation de l’effort individuel.
Enfin, Batlle défend une vision originale des institutions : pour limiter le pouvoir personnel, il milite en faveur d’un exécutif collégial, un conseil national d’administration. Cette idée ne triomphe qu’en partie : la constitution de 1918 instaure un système mixte avec président et conseil, qui sera ensuite remanié au fil des décennies. Mais elle traduit une méfiance structurelle à l’égard du caudillisme qui a marqué le XIXᵉ siècle.
Au sortir de cette période, l’Uruguay affiche des indicateurs sociaux remarquables : taux d’alphabétisation élevé, mortalité infantile parmi les plus basses du monde, large classe moyenne urbaine. Le pays gagne son surnom de « Suisse de l’Amérique », et son image de démocratie libérale stable se consolide. Mais cette prospérité reste fragile, car très dépendante des exportations agricoles.
Crises, radicalisation et dérive autoritaire
Le choc de la Grande Dépression, dans les années 1930, met fin à la longue phase de croissance tirée par les exportations. L’Uruguay tente une stratégie d’industrialisation par substitution aux importations, mais la taille réduite du marché intérieur et la dépendance vis‑à‑vis des prix agricoles limitent les résultats. Après la Seconde Guerre mondiale, la conjoncture favorable de l’économie mondiale permet un nouveau cycle de prospérité, mais à partir du milieu des années 1950, la machine se grippe.
La demande mondiale de laine et de viande recule, entraînant une croissance quasi nulle, une inflation dépassant 50% par an au début des années 1960, un chômage massif et une baisse du niveau de vie. L’État, employeur d’un travailleur sur cinq, est en outre accusé de bureaucratie tentaculaire et de corruption.
Dans ce contexte de frustration économique, la vie politique uruguayenne reste longtemps dominée par les deux partis historiques, Colorados et Blancos, engagés dans une forme de social‑démocratie modérée. Mais à la marge, les radicalisations se multiplient. Un Parti communiste influent tient un discours révolutionnaire, tandis que, dans la jeunesse, l’exemple de la révolution cubaine fascine. C’est dans ce climat que naît, au début des années 1960, un mouvement armé qui va bousculer le mythe de la « Suisse de l’Amérique » : les Tupamaros.
Tupamaros : la guérilla urbaine au cœur de la « Suisse de l’Amérique »
Le Mouvement de Libération Nationale – Tupamaros (MLN‑T) prend forme autour de 1963‑1965, sous l’impulsion de Raúl Sendic, avocat et organisateur syndical. Son nom renvoie à Túpac Amaru II, meneur d’une grande révolte indigène au Pérou au XVIIIᵉ siècle, mais il fait aussi écho à un surnom jadis utilisé pour des partisans d’Artigas. Le groupe se réclame du marxisme‑léninisme et se fixe pour objectif une révolution socialiste, destinée à « libérer » le pays d’une oligarchie jugée corrompue et d’une domination impérialiste.
Particularité notable : bon nombre de ses membres viennent de la classe moyenne ou de milieux éduqués – étudiants, professionnels, intellectuels – plus que des campagnes. Ils adoptent une stratégie de guérilla urbaine, en rupture avec le modèle rural castriste. Vols de banques, attaques de clubs de tir, braquages de commerces et redistributions spectaculaires de nourriture ou d’argent dans les quartiers populaires forgent leur réputation de « Robin des Bois » modernes.
Rapidement, leurs méthodes se durcissent : pose de bombes, sabotages, vols d’armes, enlèvements politiques. Ils créent des « prisons du peuple » clandestines pour détenir et interroger des personnalités : banquiers, diplomates, techniciens étrangers. Parmi leurs actions les plus retentissantes figurent les enlèvements de Dan Mitrione, agent états‑unien spécialisé dans la formation de policiers latino‑américains, exécuté en 1970, du consul brésilien Aloysio Dias Gomide, de l’agronome américain Claude Fly, du banquier Ulysses Pereira Reverbel, ou encore de l’ambassadeur britannique Geoffrey Jackson. En 1969, ils orchestrent le plus gros braquage de l’histoire du pays et, le 8 octobre, occupent la petite ville de Pando.
Les mots nous divisent, l’action nous unit
Les Tupamaros
La réponse de l’État : de l’état d’urgence à la dictature
Face à cette montée de la violence politique, les gouvernements successifs abandonnent progressivement les traditions libérales du pays. Dès juin 1968, le président Jorge Pacheco Areco décrète l’état d’urgence, suspend des garanties constitutionnelles, interdit des partis de gauche et des journaux, réprime durement les manifestations et les syndicats. Des forces de police paramilitaires, comme la Garde métropolitaine, sont gonflées à 20 000 hommes et formées par des instructeurs américains et brésiliens.
Élu en 1971 via le système des *lemas*, le président Juan María Bordaberry accélère la militarisation du conflit interne. Après les meurtres commis par les Tupamaros le 14 avril 1972, le pays est placé en « état de guerre interne ». L’armée obtient les pleins pouvoirs, menant une contre-insurrection marquée par des arrestations massives, la torture systématique et des tribunaux militaires pour les prisonniers politiques.
En quelques mois, la guérilla est écrasée. La plupart de ses cadres sont tués ou emprisonnés. Neuf d’entre eux – dont Raúl Sendic et José Mujica – sont désignés comme « otages » et détenus dans des conditions particulièrement inhumaines jusqu’en 1985. Mais cette « victoire » militaire a un prix : l’armée, désormais convaincue de son rôle tutélaire, ne compte plus regagner les casernes.
En février 1973, les commandants des forces terrestres et aériennes imposent à Bordaberry la création d’un Conseil de sécurité nationale (COSENA), organe où siègent les chefs militaires aux côtés de quelques ministres. Le 27 juin 1973, prétextant un complot subversif et l’incapacité du Parlement à y faire face, Bordaberry dissout l’Assemblée générale et instaure un Conseil d’État non élu. Les syndicats déclenchent une grève générale de quinze jours, brutalement réprimée. La dictature civilo‑militaire est en place.
Douze années de dictature et de résistance
De 1973 à 1985, l’Uruguay vit sous un régime autoritaire inspiré de la doctrine de sécurité nationale brésilienne et intégré au dispositif régional d’Opération Condor, qui coordonne la répression entre dictatures du Cône sud. Le pouvoir formel reste d’abord aux mains de présidents civils – Bordaberry, puis Demicheli, puis Aparicio Méndez – mais les décisions majeures émanent du COSENA et de la junte des officiers généraux. À partir de 1981, le général Gregorio Álvarez assume directement la présidence.
Nombre de personnes condamnées par des tribunaux militaires en Uruguay, donnant au pays le taux de prisonniers politiques par habitant le plus élevé au monde.
Sur le plan économique, la dictature cherche à rompre avec le modèle étatiste hérité du batllisme. Sous la houlette de ministres comme Alejandro Végh Villegas, elle libéralise les prix, ouvre largement le pays aux capitaux étrangers, limite les salaires et casse les droits syndicaux. Si, un temps, Montevideo retrouve un rôle régional comme place financière et si les exportations manufacturières augmentent, la stratégie se solde par un endettement massif et une crise sévère au début des années 1980. La dette extérieure quadruple entre 1981 et 1982, le PIB recule, le chômage grimpe à 17 %, les salaires réels s’effondrent.
La tentative de légitimer ce système par un nouveau texte constitutionnel échoue : en 1980, un plébiscite organisé par la junte sur un projet de constitution autoritaires est rejeté par 57 % des votants. Ce « non » ouvre une brèche. Peu à peu, les forces politiques traditionnelles (Colorados, Blancos, mais aussi le Frente Amplio de gauche), les syndicats et les organisations sociales parviennent à imposer une transition négociée.
En 1984, après des grèves générales et une grande manifestation à Montevideo, des accords comme le « Pacte du Club Naval » ont préparé le retour à la démocratie. Des élections en novembre ont vu la victoire du Colorado Julio María Sanguinetti, malgré l’interdiction de candidature du leader blanco Wilson Ferreira Aldunate. La légitimité fut assurée par la participation des principaux partis. Sanguinetti prit ses fonctions le 1er mars 1985, après une brève transition dirigée par un civil nommé par les militaires.
L’un des compromis de la transition est l’adoption en 1986 d’une loi d’amnistie pour les crimes commis par les forces armées pendant la dictature, validée par référendums en 1989 et 2009. Cette « loi de caducité » reste au cœur des débats de mémoire jusqu’au XXIᵉ siècle. Sous la présidence de l’ancien guérillero José Mujica, un tournant s’opère : la Cour interaméricaine des droits de l’homme juge l’amnistie incompatible avec les obligations internationales du pays, le Parlement adopte une loi la vidant en pratique de ses effets, et plusieurs anciens dictateurs, dont Gregorio Álvarez et Bordaberry, sont condamnés.
Crises économiques et réinvention d’un modèle
La restauration démocratique ne signifie pas la fin des turbulences. Dans les années 1990, les gouvernements colorados et blancs mettent en œuvre des politiques d’ouverture et de dérégulation, dans le droit fil du consensus de Washington. L’économie se désindustrialise partiellement, se recentre sur une agriculture de plus en plus tournée vers la monoculture et des services comme la finance et le tourisme.
Pourcentage des dépôts bancaires retirés en Uruguay entre mars et juillet 2002 suite à la crise argentine.
Là encore, la solution passe par une négociation internationale : le gouvernement obtient une aide d’urgence des États‑Unis via le Fonds de stabilisation des changes, et un paquet de près de trois milliards de dollars auprès du FMI, de la Banque mondiale et de la Banque interaméricaine de développement. Une loi de renforcement du système bancaire rééchelonne les dépôts à terme, un échange de dette permet d’éviter le défaut. L’Uruguay honore finalement l’intégralité de ses engagements et rembourse le FMI.
La crise a profondément remodelé le paysage bancaire uruguayen, entraînant la disparition de la plupart des banques privées nationales. Le système est désormais dominé par la grande banque publique BROU et des filiales de groupes étrangers comme Santander ou Itaú. Les graves traumatismes sociaux (soupes populaires, exode migratoire, perte de confiance) ont également provoqué un basculement politique.
En 2004, pour la première fois de l’histoire, une coalition de gauche, le Frente Amplio, remporte l’élection présidentielle avec Tabaré Vázquez. Elle gouvernera pendant quinze ans, jusqu’en 2020, en combinant prudence macro‑économique et réformes sociales ambitieuses. Durant ces années, l’Uruguay connaît une croissance soutenue, une forte réduction de la pauvreté et des inégalités, ainsi qu’une diversification de ses partenaires commerciaux : la part des exportations vers l’Argentine et le Brésil tombe de près de la moitié à la fin des années 1990 à environ 20 % en 2017, tandis que la Chine et l’Asie deviennent des clients majeurs.
Un pays de pionniers sociaux au XXIᵉ siècle
Dans la continuité de son histoire batlliste, l’Uruguay démocratique se distingue au XXIᵉ siècle par des réformes de société qui frappent l’opinion internationale. Sous la présidence Mujica, ancien Tupamaro, le pays légalise l’avortement jusqu’à la douzième semaine de grossesse en 2012, ouvre le mariage aux couples de même sexe en 2013, puis met en place la même année un dispositif unique de régulation complète du cannabis : production, vente et consommation encadrées par l’État, pour assécher le marché noir.
L’Uruguay est cité comme un exemple mondial pour sa transition électrique, grâce à des politiques de promotion des énergies renouvelables. Parallèlement, le pays accorde une forte attention aux droits humains, comme en témoigne la reconnaissance officielle de la langue des signes uruguayenne en 2001 et la mise en œuvre de politiques mémorielles concernant la période de la dictature.
Au plan politique, toutefois, la tradition bipartisane n’est pas morte. Les partis Colorado et Nacional (ancien Blanco) restent des acteurs importants. En 2020, Luis Lacalle Pou, du Parti national, accède à la présidence, mettant fin au long cycle de la gauche au pouvoir. Le système électoral, affiné par différentes réformes constitutionnelles, préserve une alternance pacifique.
Une trajectoire singulière dans le concert latino‑américain
L’histoire du pays Uruguay peut se lire comme un balancier constant entre violence et compromis, dépendance externe et recherche d’autonomie, conservatisme rural et réformisme urbain. Territoire disputé entre couronnes ibériques, puis entre Buenos Aires et Rio de Janeiro, il a su arracher son indépendance au prix d’une neutralisation orchestrée par la diplomatie britannique. Miné pendant tout le XIXᵉ siècle par les guerres civiles entre Blancos et Colorados, il a transformé cette rivalité en bipartisme négocié.
Grâce à l’impulsion d’Artigas, le pays porte dans ses gènes une tradition fédéraliste et démocratique qui, bien que trahie à court terme, imprègne le récit national. Avec Batlle y Ordóñez, il expérimente dès le début du XXᵉ siècle un État‑providence avancé, une laïcité vigoureuse, des droits sociaux pionniers. La guérilla tupamara et la dictature montrent que même la plus « européenne » des républiques sud‑américaines n’est pas à l’abri des tornades autoritaires qui ont ravagé la région. Mais la vigueur de la société civile, la force de la culture institutionnelle et la capacité d’autocorrection finissent par l’emporter.
Analyse historique de l’Uruguay
Au sortir des crises économiques et politiques du tournant du siècle, l’Uruguay a choisi de renouer, chacun à sa manière, avec l’héritage batlliste : État social robuste, respect des libertés publiques, politique étrangère prudente et diversification économique. Si les défis demeurent – inégalités persistantes, vulnérabilité face aux chocs extérieurs, tensions mémorielles –, l’itinéraire du pays, de la Banda Oriental disputée aux réformes de société du XXIᵉ siècle, illustre la possibilité, pour un petit État coincé entre des géants, de se forger une identité politique originale, fondée à la fois sur la mémoire des luttes et sur l’expérimentation institutionnelle.
Un retraité de 62 ans, avec un patrimoine financier supérieur à un million d’euros bien structuré en Europe, souhaitait changer de résidence fiscale pour optimiser sa charge imposable et diversifier ses investissements, tout en conservant un lien avec la France. Budget alloué : 10 000 euros pour l’accompagnement complet (conseil fiscal, formalités administratives, délocalisation et structuration patrimoniale), sans vente forcée d’actifs.
Après analyse de plusieurs destinations attractives (Uruguay, Portugal, Grèce, Maurice), la stratégie retenue a consisté à cibler l’Uruguay pour son régime fiscal territorial (imposition limitée aux revenus de source locale, avec options favorables pour certains revenus étrangers), son absence d’impôt sur la fortune et son environnement politique stable. Le coût de la vie à Montevideo reste nettement inférieur à Paris, avec une bonne qualité de soins et de services. La mission a inclus : audit fiscal pré‑expatriation (exit tax, conventions FR‑UY), obtention de la résidence fiscale (visa, cédula), transfert de résidence bancaire, plan de rupture des liens fiscaux français (183 jours/an hors France, centre d’intérêts économiques), structuration patrimoniale internationale et mise en relation avec un réseau local bilingue (avocat, fiscaliste, agents immobiliers) pour sécuriser l’installation et l’investissement immobilier.
Vous souhaitez vous expatrier à l'étranger : contactez-nous pour des offres sur mesure.
Décharge de responsabilité : Les informations fournies sur ce site web sont présentées à titre informatif uniquement et ne constituent en aucun cas des conseils financiers, juridiques ou professionnels. Nous vous encourageons à consulter des experts qualifiés avant de prendre des décisions d'investissement, immobilières ou d'expatriation. Bien que nous nous efforcions de maintenir des informations à jour et précises, nous ne garantissons pas l'exhaustivité, l'exactitude ou l'actualité des contenus proposés. L'investissement et l'expatriation comportant des risques, nous déclinons toute responsabilité pour les pertes ou dommages éventuels découlant de l'utilisation de ce site. Votre utilisation de ce site confirme votre acceptation de ces conditions et votre compréhension des risques associés.
Découvrez mes dernières interventions dans la presse écrite, où j'aborde divers sujets.