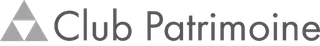Publié le et rédigé par Cyril Jarnias
Publié le et rédigé par Cyril Jarnias
La Tunisie est un petit territoire par la taille, mais immense par la densité de son histoire. De la présence humaine préhistorique aux soulèvements populaires du début du XXIᵉ siècle, ce morceau du Maghreb a vu se succéder empires, dynasties, conquêtes et expériences politiques, laissant un palimpseste d’influences berbères, puniques, romaines, arabo-musulmanes, ottomanes et européennes. Raconter l’histoire du pays en Tunisie, c’est donc suivre un fil qui relie les inscriptions libyques de Dougga aux mosaïques romaines du Bardo, les minarets de Kairouan aux canons français de la colonisation, jusqu’aux slogans « Travail, liberté, dignité » scandés dans les rues en 2010-2011.
Des peuples préhistoriques aux royaumes berbères
Bien avant l’arrivée des Phéniciens ou des légions romaines, le territoire tunisien est occupé par des populations que l’on rattache aux grandes cultures préhistoriques d’Afrique du Nord. Des vestiges comme ceux associés à la culture capsienne témoignent d’une présence humaine de très longue durée et de transitions progressives, depuis des groupes de chasseurs-cueilleurs jusqu’à des communautés pratiquant l’élevage et l’agriculture.
Les Berbères (Amazighs) sont les héritiers d’une longue histoire. Leur formation résulte du mélange de groupes paléo‑méditerranéens, de populations du Proche‑Orient et de contacts avec l’Europe méridionale. Dès le Néolithique, leur société était structurée en villages agricoles et tribus pastorales, où les liens claniques étaient centraux. L’écriture tifinagh, attestée par des inscriptions anciennes dans tout le Maghreb, témoigne de l’ancienneté de leur culture propre, qui a survécu à toutes les dominations successives.
À la veille des grandes rivalités méditerranéennes, plusieurs ensembles berbères structurent déjà l’espace nord‑africain. Trois royaumes dominent alors la région plus vaste qui englobe l’actuelle Tunisie : les Mauri à l’ouest, les Masaesyli en Algérie, et surtout les Massyli et Numidiens à l’est, au contact direct de Carthage. C’est dans cette matrice que s’inscrit la future Numidie, royaume essentiel pour comprendre l’histoire antique de la Tunisie.
Carthage, la puissance punique et la naissance d’Africa
Au IXᵉ siècle avant notre ère, des navigateurs phéniciens venus de Tyr fondent une série d’escales sur la côte tunisienne, dont Utique, Bizerte, puis Carthage. Le site, sur une péninsule dominant le golfe de Tunis, est choisi pour ses avantages maritimes, ses abris naturels entre mer et lagune et sa position idéale sur la route du détroit de Sicile. Rapidement, la « ville nouvelle » (Qart‑Hadasht) s’impose comme centre d’un véritable empire commercial occidental.
Carthage étend son influence sur les côtes d’Afrique du Nord, la Sicile occidentale, la Sardaigne, la Corse, une partie de l’Espagne et les Baléares. Sa puissance s’appuie sur un réseau de ports et de comptoirs, ainsi que sur une armée où les contingents berbères sont essentiels comme fantassins et cavaliers. La cité est gouvernée par des suffètes annuels et un Sénat puissant, et son panthéon, dominé par Baal et Tanit, intègre également des éléments berbères.
Face à la montée de Rome, la rivalité pour le contrôle du commerce méditerranéen dégénère en trois guerres puniques. La seconde, marquée par la traversée des Alpes par Hannibal et ses victoires en Italie, s’achève pourtant sur le sol tunisien : la bataille de Zama voit la défaite du grand général carthaginois face à Scipion, soutenu par le roi numide Massinissa. La troisième guerre consacre la volonté romaine d’anéantissement : Carthage est rasée, ses habitants réduits en esclavage, et son territoire transformé en province africaine.
Après sa victoire, Rome a reconstruit Carthage, qui est devenue une grande ville de l’Empire et la capitale de la province d’Africa Proconsularis. Le territoire de l’actuelle Tunisie, au cœur de cette province, a été intégré au système impérial en jouant un rôle économique vital : celui de « grenier de Rome », grâce à ses importantes productions de blé et d’huile d’olive.
Les villes romaines de Tunisie : un héritage monumental
L’empreinte de cette période est visible dans la densité exceptionnelle de sites archéologiques tunisiens, dont plusieurs sont aujourd’hui inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO. Ils illustrent la profondeur de l’intégration à l’Empire et offrent un panorama rare de la vie urbaine romaine.
| Site romain majeur | Période dominante | Particularités principales |
|---|---|---|
| Carthage | Punique puis romaine | Capitale d’Africa, thermes d’Antonin, ports puniques, tophet |
| Dougga / Thugga | Numide puis romaine | Théâtre, capitole, mausolée libyco‑punique |
| Amphithéâtre d’El Jem | Haut-Empire (IIIᵉ s.) | 4ᵉ plus grand amphithéâtre de l’Empire, ~35 000 places |
| Bulla Regia | Empire romain | Villas semi‑souterraines avec mosaïques in situ |
| Sbeitla (Sufetula) | Empire puis Byzance | Forum à trois temples séparés, nombreuses basiliques chrétiennes |
Dougga, bâtie sur un noyau numide, montre le tissage entre cultures libyques, puniques et romaines. El Jem, avec son amphithéâtre monumental, reflète la prospérité d’une région agricole capable de soutenir de vastes investissements. Bulla Regia et Sbeitla complètent ce tableau d’une Afrique romaine dense, urbanisée et christianisée, dont la Tunisie actuelle conserve la plus riche concentration de vestiges.
Entre Berbères, Vandales et Byzantins : un pays morcelé
La fin de l’Empire romain d’Occident ouvre une période de recompositions. Au Vᵉ siècle, les Vandales s’emparent de Carthage et fondent un royaume qui domine les routes maritimes occidentales. Leur domination, marquée par des tensions religieuses avec les chrétiens nicéens, ne dure qu’un siècle. Au VIᵉ siècle, le général byzantin Bélisaire reconquiert Carthage et rétablit l’autorité impériale d’Orient sur l’Afrique du Nord.
La reconquête byzantine en Afrique du Nord est principalement côtière. L’intérieur reste sous le contrôle de confédérations berbères autonomes, tandis que des royaumes ‘romano-maures’ coexistent avec Byzance tout en préservant leurs propres structures. Cette fragmentation politique et les rivalités confessionnelles affaiblissent durablement la région, la rendant vulnérable aux transformations futures.
Conquête arabe, naissance d’Ifriqiya et islamisation
Au milieu du VIIᵉ siècle, les premiers contingents arabes apparaissent en Afrique du Nord dans le sillage des grandes expansions islamiques. La conquête n’est ni rapide ni linéaire : elle s’étale sur plusieurs décennies, entre incursions, victoires, revers et résistances berbères. Des figures comme Kusaila, chef chrétien de tribus Awreba et Sanhadja, puis la célèbre Dihya, surnommée « al‑Kahina », incarnent cette opposition à la pénétration arabe et à la domination omeyyade.
La fondation de Kairouan par Uqba ibn Nafi en fait une base militaire, une capitale administrative et un centre d’islamisation. Après la destruction de Carthage, Tunis se développe comme port naval et urbain. La région se structure alors autour de deux pôles : un arrière-pays berbère en cours d’islamisation et d’arabisation, et un réseau de villes contrôlées par les élites arabo-musulmanes.
Le processus de conversion n’est pas seulement le fruit de la contrainte. Il s’explique aussi par l’attrait de l’égalité proclamée entre croyants, par la possibilité d’intégrer les armées de conquête et de participer aux butins, et par la convergence entre modes de vie pastoraux arabes et berbères. Certaines doctrines islamiques égalitaristes, comme le kharijisme, séduisent des tribus excédées par l’arrogance de certains gouverneurs arabes et par une fiscalité jugée injuste. Ce mélange de conversion, de résistance et de révoltes (dont la grande insurrection berbère du VIIIᵉ siècle) donne à l’Islam maghrébin un profil original, fortement marqué par ses racines amazighes.
Dynasties médiévales : de Kairouan aux Hafsides de Tunis
Avec le recul du califat omeyyade puis abbasside, Tunis et l’Ifriqiya gagnent en autonomie sous des dynasties locales. Les Aghlabides, à partir de 800, gouvernent au nom des Abbassides mais développent un pouvoir de fait indépendant. Ils embellissent Kairouan, construisent des mosquées, des bassins, des ribats, et lancent l’expansion vers la Sicile, donnant à l’Ifriqiya un rôle d’acteur central dans la Méditerranée centrale.
Siècle marquant l’émergence de la dynastie fatimide, qui renverse les Aghlabides en s’appuyant sur les Berbères Kutama.
Des Hilaliens aux Almohades : recomposition du territoire
Le choix ziride de rompre avec l’allégeance fatimide provoque une riposte dévastatrice : la poussée de grandes tribus arabes nomades, Banu Hilal et Banu Sulaym, depuis l’Égypte vers l’ouest. Leur installation au XIᵉ siècle bouleverse l’équilibre rural, accélère l’arabisation linguistique et affaiblit durablement le pouvoir ziride. Kairouan est saccagée, la campagne se désertifie partiellement, les circuits économiques se déplacent vers les côtes et vers de nouveaux centres.
Leur conquête de l’Ifriqiya, avec la reprise de Tunis et de Mahdia aux Normands de Sicile, prépare la montée en puissance d’une nouvelle dynastie : les Hafsides.
Les Almohades, mouvement religieux et politique
Fondée par un ancien gouverneur almohade de Tunis, la dynastie hafside fait de la ville la capitale durable de l’Ifriqiya à partir du XIIIᵉ siècle. Tunis devient un carrefour du commerce méditerranéen, intégrant les réseaux de marchands italiens, andalous et orientaux. Sous les Hafsides, la médina se densifie, la Zitouna devient un centre d’érudition malikite, et l’arrière‑pays se structure autour d’oasis, de ksour et de routes caravanières.
Ottomans, beys et pressions européennes
À partir du XVIᵉ siècle, l’Ifriqiya devient l’enjeu d’un nouveau duel impérial, entre Habsbourg et Ottomans. Les frères Barberousse, corsaires au service de la Sublime Porte, prennent Tunis, en sont chassés par Charles Quint, puis la reconquièrent définitivement en 1574. La région devient une province ottomane, mais l’éloignement du centre impérial laisse rapidement place à une large autonomie.
Un pacha, nommé par Istanbul, coexiste avec un dey issu des janissaires et un bey chargé des campagnes fiscales. Au fil du XVIIᵉ siècle, la fonction de bey se renforce, jusqu’à ce qu’une nouvelle dynastie, les Husaynides, fondée en 1705 par Al‑Husayn ibn Ali, impose son autorité. C’est le début du « beylik de Tunis », entité politique qui durera jusqu’à l’instauration du protectorat français.
Une période d’équilibre entre allégeance nominale à l’Empire ottoman, autonomie interne et intégration économique par la course en Méditerranée.
Fidélité formelle au sultan ottoman combinée à une gestion autonome des affaires intérieures par les beys.
Insertion dans l’économie méditerranéenne via les flottilles corsaires basées dans les ports de Bizerte, Porto Farina, Sousse et Sfax, qui attaquaient les navires européens.
Signature de traités commerciaux et de paix avec les grandes puissances européennes par les beys, assurant des relations internationales complexes.
Rapidement, toutefois, les rapports de force changent. La pression militaire et diplomatique européenne impose la fin progressive de la course au XIXᵉ siècle. Dans le même temps, les beys tentent de moderniser l’État : création d’une armée réformée, d’une école militaire au Bardo, d’un embryon de presse officielle, et même d’une constitution en 1861, l’une des premières du monde arabo‑musulman. Mais ces réformes, financées à crédit, précipitent l’endettement, les tutelles financières européennes et, finalement, la mainmise coloniale.
Les signes avant‑coureurs de la colonisation
Dès la seconde moitié du XIXᵉ siècle, la Tunisie est prise dans les rets d’un capitalisme européen expansionniste. Les beys contractent des emprunts lourds auprès de banquiers français et italiens, tandis que la dette explose, aggravée par les détournements opérés au sommet de l’État. En 1869, un commissionnement financier international franco‑italo‑britannique prend de fait le contrôle des finances tunisiennes.
Dans le même temps, des dizaines de milliers d’Européens, surtout Italiens et Maltais, s’installent, renforçant l’intérêt de Rome et de Paris pour ce territoire voisin de leurs rivages. Lors du Congrès de Berlin de 1878, les grandes puissances ferment les yeux sur les visées françaises en Tunisie, en échange de compensations ailleurs en Méditerranée. La route vers le protectorat est ouverte.
Le protectorat français : modernisation contrainte et naissance du nationalisme
En 1881, un incident frontalier impliquant la tribu des Khroumirs sert de prétexte à l’intervention militaire française depuis l’Algérie. Des colonnes progressent vers le Kef, Bizerte, puis encerclent le palais du Bardo. Le bey, sous la menace des canons, signe le traité qui institue le protectorat : la souveraineté formelle est maintenue, mais la grande majorité des prérogatives de l’État passe au résident général français.
Les années qui suivent voient le déploiement d’une administration parallèle. Des « contrôleurs civils » encadrent les caïds, une justice française s’applique aux Européens et aux affaires mixtes, de grands travaux (ports, chemins de fer, routes) structurent l’espace en fonction des intérêts coloniaux. La vallée de la Medjerda, les terres les plus fertiles du nord, ainsi que des zones du Cap Bon passent massivement entre les mains de colons.
Quelques chiffres donnent la mesure du basculement démographique et économique :
| Indicateur | Avant 1881 | Vers 1945 |
|---|---|---|
| Nombre approximatif de colons français | ~10 000 (début protectorat) | ~144 000 colons français |
| Poids des Italiens et Maltais | Communauté dominante parmi les Européens avant l’emprise française | En diminution relative, mais très présents dans les villes côtières |
| Rôle de l’agriculture | Production locale, fisc traditionnel | Agriculture d’exportation orientée vers la métropole, grands domaines coloniaux |
Sur le plan social, l’introduction d’écoles franco‑arabes, la modernisation sanitaire et l’essor des villes arabes et européennes s’accompagnent d’un double mouvement contradictoire. D’un côté, une minorité de Tunisiens accède à de nouvelles formes de mobilité sociale via les études, le commerce, la fonction publique. De l’autre, une masse rurale subit la dépossession foncière, la concurrence des produits industriels européens qui ruinent l’artisanat, et les inégalités croissantes entre colons et indigènes.
C’est dans ce contexte qu’émerge le mouvement national.
Les premières contestations : Young Tunisians et Destour
Au début du XXᵉ siècle, une élite tunisienne formée dans les écoles modernes et à l’étranger commence à contester le cadre du protectorat. Autour du journal Le Tunisien, des figures comme Ali Bach Hamba ou Abdelaziz Thâalbi articulent un discours de défense de l’identité arabo‑musulmane et de revendication de réformes. Inspirés par les Jeunes‑Turcs et par les réformes d’avant‑1881, ils posent les bases d’un nationalisme moderniste.
Après la Première Guerre mondiale, la création du parti Destour en 1920 marque une étape décisive. Il revendique une monarchie constitutionnelle et la fin de l’arbitraire du protectorat français. Malgré la répression, l’idée d’un État tunisien moderne avec des institutions représentatives s’enracine durablement.
Habib Bourguiba et le Neo‑Destour : vers l’indépendance
Au sein même du Destour, une nouvelle génération se forge, plus radicale et plus attentive aux réalités populaires. Habib Bourguiba, juriste formé à Paris, cofonde en 1932 le journal L’Action tunisienne avant de rompre avec l’aile traditionnelle. En 1934, il crée à Ksar Hellal, avec d’autres militants, le Neo‑Destour, qui se veut un outil de mobilisation nationale plus moderne, plus centralisé et plus proche des masses.
Les autorités coloniales y voient une menace sérieuse. Les grandes manifestations de 1938, violemment réprimées, entraînent l’arrestation de Bourguiba et l’interdiction du parti. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les Italiens et les Allemands cherchent à instrumentaliser la cause tunisienne, mais le leader nationaliste refuse l’alliance avec les puissances de l’Axe. Après la guerre, il reprend le combat depuis Le Caire, puis revient sur le terrain tunisien.
La crise des années 1950 et la marche vers l’indépendance
Les années 1952‑1954 sont décisives. Les négociations sur l’autonomie, engagées par un gouvernement tunisien modérément réformiste, se heurtent à la rigidité française. L’échec de ces pourparlers et la répression qui suit radicalisent la situation. Tandis que Bourguiba est emprisonné, des maquis nationalistes se forment, des syndicats comme l’UGTT durcissent le ton, et la question tunisienne s’invite à l’ONU.
En France, l’arrivée de Pierre Mendès France puis l’enlisement de la guerre d’Indochine amènent un réexamen des politiques coloniales. En 1954, Paris reconnaît le principe de l’autonomie interne tunisienne. Mais très vite, au sein du Neo‑Destour, une fracture apparaît entre partisans d’une étape progressive, centrée sur Bourguiba, et défenseurs d’une indépendance immédiate et d’un arrimage plus fort au monde arabe, autour de Salah Ben Youssef. Ce conflit, qui prend bientôt les allures d’une guerre civile larvée, se conclut en faveur de Bourguiba.
Le 20 mars 1956, les accords franco‑tunisiens entérinent l’indépendance du pays. La monarchie husaynide, maintenue un temps comme façade, est abolie en 1957, et la République proclamée. Habib Bourguiba devient le premier président de la Tunisie indépendante.
L’État bourguibien : modernisation, autoritarisme et société en mutation
Au lendemain de l’indépendance, le pays fait face à un immense chantier : construire des institutions, unifier un territoire socialement fragmenté, arbitrer entre influences occidentales et héritage arabo‑musulman. Bourguiba opte pour une stratégie volontariste de modernisation, souvent présentée comme « bourguibisme ».
Un des textes fondateurs est le Code du statut personnel, adopté quelques mois après l’indépendance. Il interdit la polygamie, fixe un âge minimum au mariage, encadre le divorce et reconnaît une série de droits civils aux femmes. Il s’agit d’une rupture profonde avec les normes traditionnelles, dans une perspective qu’il revendique comme réformiste mais fermement laïque. Dans le même esprit, les tribunaux charaïques sont abolis, la Zitouna transformée en université moderne, et la place de l’islam dans la sphère publique est clairement subordonnée à l’État.
Après l’indépendance, la promesse de pluralisme est abandonnée avec l’instauration du parti unique (Parti socialiste destourien). Les oppositions sont marginalisées ou réprimées. En 1975, Bourguiba est proclamé président à vie, scellant un régime autoritaire qui se distingue cependant par son attachement formel à la légalité et à une modernisation graduelle.
Sur le plan économique, la Tunisie indépendante tâtonne. Une première phase de socialisme d’État, impulsée dans les années 1960 sous l’égide d’Ahmed Ben Salah, tente d’organiser la production agricole et industrielle autour de coopératives et d’entreprises publiques. L’expérience se heurte à une opposition forte dans les campagnes, à des erreurs de gestion et au scepticisme des bailleurs internationaux. Elle est abandonnée à la fin de la décennie, et Ben Salah est écarté.
La politique économique libérale du Premier ministre Hédi Nouira dans les années 1970, marquée par l’ouverture aux capitaux étrangers, le développement industriel exportateur, l’exploitation pétrolière et la promotion du tourisme balnéaire, a généré une croissance réelle. Cependant, elle n’a pas résolu les déséquilibres régionaux ni le chômage des jeunes diplômés. Les tensions sociales ont culminé avec la grève générale de 1978 et les émeutes du pain de 1984, révélant un fossé croissant entre l’État et une société en mutation.
Au début des années 1980, la montée d’un mouvement islamiste structuré, qui donnera plus tard naissance à Ennahda, témoigne aussi du désenchantement d’une partie de la jeunesse vis‑à‑vis d’un modèle qu’elle juge occidentalisé et autoritaire. La réponse du pouvoir est principalement sécuritaire. C’est dans ce contexte de crise politique, économique et de santé du président que se prépare la transition suivante.
L’ère Ben Ali : libéralisation encadrée, autoritarisme et impasse
Le 7 novembre 1987, le Premier ministre Zine El Abidine Ben Ali destitue Habib Bourguiba en l’invoquant « inapte à gouverner ». Le « coup médical », présenté comme un acte de sauvegarde nationale, est accueilli par une partie de la société comme l’occasion d’un nouveau départ. Les premières années du nouveau régime conjuguent ouverture contrôlée, libéralisation économique et discours sur les droits de l’homme. Quelques opposants sont libérés, des partis légaux tolérés, la presse bénéficie d’un certain assouplissement.
La rhétorique officielle fait de la Tunisie un « miracle » de stabilité et de croissance, vanté par de nombreux partenaires occidentaux.
Rassemblement constitutionnel démocratique
Derrière la vitrine, un autre tableau se dessine : celui d’une centralisation extrême, d’un appareil sécuritaire tentaculaire, et d’une économie où la corruption et le népotisme deviennent systémiques. Autour du président et de la famille de son épouse, Leïla Trabelsi, se constitue un clan accusé, jusque dans des câbles diplomatiques américains, de se comporter en « quasi‑mafia » accaparant les secteurs les plus lucratifs (banque, télécoms, grandes surfaces, immobilier…).
Un modèle de « réussite » fragile
Dans les années 1990 et 2000, la Tunisie affiche des taux de croissance honorables, un taux de scolarisation élevé et des indicateurs sociaux souvent supérieurs à ceux de ses voisins. Les politiques de planning familial et de santé publique poursuivent, sous une forme plus technocratique, certaines orientations de l’ère bourguibienne. Mais plusieurs failles structurelles minent ce modèle.
Le taux de chômage chez les jeunes diplômés en Tunisie, selon les syndicats.
Le déclencheur de la crise à venir est aussi international. La crise financière mondiale de 2007‑2008 frappe indirectement la Tunisie via la baisse de la demande européenne, affectant les exportations et le tourisme. Pour une jeunesse nombreuse, urbaine, connectée, souvent diplômée mais sans perspectives, le tableau qui se dessine est celui d’un « pacte autoritaire » rompu : l’État ne garantit plus l’emploi ni une amélioration tangible du niveau de vie, alors même qu’il étouffe toute contestation.
La Révolution tunisienne : travail, liberté, dignité
Le 17 décembre 2010, à Sidi Bouzid, ville du centre tunisien tenue à l’écart du boom touristique côtier, un jeune vendeur ambulant, Mohamed Bouazizi, s’immole par le feu devant le siège du gouvernorat. Il vient de se voir confisquer sa marchandise par des agents municipaux, après des humiliations répétées. Empêché d’obtenir une entrevue pour se plaindre, il choisit ce geste désespéré qui, en quelques jours, devient le symbole d’une indignité quotidienne subie par des milliers de Tunisiens : l’arbitraire de la petite administration, la corruption omniprésente, l’absence de recours et de droits effectifs.
Très vite, la colère gagne la région. À Sidi Bouzid, puis dans les villes voisines de Menzel Bouzaïane, Regueb, Thala, Kasserine, les manifestations se multiplient, portées par les jeunes, souvent diplômés et au chômage. Les forces de sécurité répliquent par les gaz lacrymogènes, puis par les balles réelles. Des morts tombent, mais loin de briser le mouvement, la répression l’alimente. Des avocats se mettent en grève pour protester contre les violences policières. L’UGTT, puissante centrale syndicale, commence à relayer la contestation en organisant des rassemblements dans plusieurs villes.
Le rôle déterminant de l’information et des réseaux sociaux
L’un des traits les plus marquants de ce soulèvement est le rôle joué par les nouvelles technologies de l’information. Dans un pays où les médias officiels taisent les événements ou les réduisent à des « actes isolés », des vidéos filmées sur téléphones portables et diffusées sur Facebook et YouTube montrent au pays entier – et au monde – les scènes de répression à Sidi Bouzid et Kasserine. Des blogueurs, comme Slim Amamou, relaient en direct les informations, contournant la censure grâce à des réseaux chiffrés et à la solidarité de communautés d’activistes numériques.
Les plateformes comme Facebook et Twitter n’ont pas créé le mouvement révolutionnaire mais ont servi de catalyseurs. La libération de la parole en ligne a précédé et accompagné les manifestations, synchronisant les dénonciations numériques avec l’occupation physique de l’espace public.
En parallèle, un autre facteur informationnel joue un rôle : les révélations de WikiLeaks, qui publient en 2010 des télégrammes diplomatiques américains décrivant en détail la corruption du clan au pouvoir. Ces textes, largement relayés dans la population tunisienne connectée, confirment ce que beaucoup soupçonnaient : l’ampleur de l’accaparement des richesses par la famille Ben Ali‑Trabelsi. Certains commentateurs parleront à ce titre de « première révolution WikiLeaks ».
De la contestation locale au soulèvement national
Pendant que le pouvoir tente de minimiser les événements, de nouveaux drames d’auto‑sacrifice se produisent : un autre chômeur, Lahseen Naji, se donne la mort en escaladant un pylône électrique ; un troisième, accablé de dettes, met fin à ses jours. Chaque décès élargit le cercle de la colère. Dans la musique aussi, la contestation monte : le rappeur El Général diffuse un morceau accusant Ben Ali et son régime, qui devient un hymne officieux des manifestants. Il sera arrêté, puis libéré sous la pression populaire.
Fin décembre, les manifestations s’étendent à plusieurs grandes villes tunisiennes. Les avocats, l’UGTT et les étudiants se mobilisent. Le régime répond par des arrestations ciblées, la suspension des cours universitaires, le déploiement de l’armée et l’instauration de couvre-feux.
Face à cette marée, Ben Ali multiplie les discours télévisés. Le premier, menaçant, qualifie les protestataires « d’extrémistes mercenaires » manipulés par l’étranger. Le second, plus tardif, promet la création de centaines de milliers d’emplois, puis assure qu’il ne briguera pas un nouveau mandat. Mais il est déjà trop tard. Les slogans dans la rue ne réclament plus seulement du travail : ils exigent la chute du régime.
14 janvier 2011 : la chute d’un autocrate
Les jours qui précèdent le 14 janvier sont marqués par un face‑à‑face de plus en plus tendu à Tunis. Des dizaines de milliers de personnes convergent vers le centre‑ville, malgré les gaz, les charges de police et les balles. L’armée, déployée mais manifestement réticente à tirer sur la foule, apparaît comme un acteur clé. Son chef d’état‑major, le général Rachid Ammar, aurait refusé d’obtempérer à des ordres de répression maximale. Cette neutralité active de l’institution militaire, rare dans la région, contribue à isoler le président.
C’est la durée en années du règne de Ben Ali en Tunisie, qui a pris fin le 14 janvier 2011.
Les journées qui suivent sont chaotiques : fusillades autour du palais présidentiel entre unités de l’armée et éléments sécuritaires fidèles à l’ancien régime, rumeurs d’attaques de milices, pillages et incendies, dont celui de la gare de Tunis. Les quartiers s’organisent en comités de vigilance pour protéger les habitations, pendant que l’armée tente de reprendre le contrôle. Le chef de la sécurité présidentielle, Ali Seriati, est arrêté, accusé d’avoir contribué à la stratégie du chaos.
Selon les chiffres officiels, la révolution a coûté la vie à 338 personnes et fait plus de 2 100 blessés. Ces chiffres, déjà lourds, sont considérés par certains défenseurs des droits humains comme en‑deçà de la réalité.
La transition démocratique : entre espoirs, crises et compromis
La chute de Ben Ali ne suffit pas à refonder l’ordre politique. Un enjeu central se pose immédiatement : comment organiser la transition, dans un pays où l’ancien parti‑État, le RCD, est encore implanté partout, où l’appareil sécuritaire et administratif est largement issu du régime déchu, et où l’opposition, longtemps muselée, manque de relais institutionnels ?
Gouvernements provisoires, pression de la rue et démantèlement du RCD
Dans un premier temps, l’ancien Premier ministre, Mohamed Ghannouchi, se proclame président par intérim, avant que le Conseil constitutionnel ne confie cette fonction au président du Parlement, Fouad Mebazaa, conformément à la Constitution. Ghannouchi retourne à la primature et forme un gouvernement d’unité nationale, associant des figures de l’ancienne opposition légale et de la société civile – dont des blogueurs comme Slim Amamou – mais incluant encore de nombreux ministres du RCD.
Malgré les changements, la défiance persiste avec des sit-in exigeant la dissolution du RCD, une révision constitutionnelle, des élections libres et l’exclusion des anciennes figures. Sous pression, des ministres RCD démissionnent, Ghannouchi et Mebazaa quittent le parti, et le gouvernement s’engage à libérer les prisonniers politiques et légaliser les partis interdits.
Peu à peu, les institutions de l’ancien système sont démantelées : la police politique est officiellement dissoute, le RCD est suspendu puis dissous par la justice, des dizaines de hauts responsables sécuritaires sont relevés de leurs fonctions, et tous les gouverneurs régionaux nommés sous Ben Ali sont remplacés. Le pouvoir central tente d’associer l’UGTT et d’autres acteurs de la société civile aux décisions, tout en naviguant dans un climat de contestation continue.
Vers une Assemblée constituante : invention d’un nouveau contrat politique
Pour sortir de l’impasse, une idée s’impose : plutôt que de simples élections législatives dans le cadre de l’ancienne Constitution, il faut élire une Assemblée nationale constituante chargée de rédiger une nouvelle Loi fondamentale. Cette revendication, portée par une diversité d’acteurs – syndicats, partis, comités révolutionnaires – est finalement acceptée. La date du scrutin est fixée, d’abord pour juillet 2011, puis repoussée à octobre pour mieux préparer l’organisation.
Contrairement à d’autres soulèvements arabes, la transition tunisienne a évité un retour autoritaire ou une guerre civile grâce à un processus complexe mais inclusif, fondé sur la négociation et la légitimation par le vote d’une assemblée constituante.
Les élections d’octobre 2011, considérées comme libres et pluralistes, voient la victoire relative du mouvement Ennahda, islamiste modéré longtemps interdit, qui obtient la première place mais doit s’allier à deux partis laïcs pour former un gouvernement. À la présidence de la République, l’Assemblée désigne Moncef Marzouki, militant des droits humains et figure de la gauche laïque. Pour la première fois, le pays est dirigé par un attelage associant islamistes et séculiers dans un cadre institutionnel en cours de définition.
Crises, dialogue national et reconnaissance internationale
Les années qui suivent ne sont pas un long fleuve tranquille. La rédaction de la nouvelle Constitution s’étire sur plus de deux ans, alors que le contexte régional se durcit : guerre en Syrie, coup d’État en Égypte, violences en Libye. En Tunisie même, deux assassinats de figures de la gauche laïque, Chokri Belaïd et Mohamed Brahmi, en 2013, provoquent une onde de choc et une polarisation profonde. Une partie de l’opposition accuse Ennahda de complaisance envers les courants jihadistes, tandis que les partisans du gouvernement dénoncent des tentatives de déstabilisation.
Pour éviter la rupture politique en Tunisie, un Quartet du dialogue national, composé de l’UGTT, de l’UTICA, de l’Ordre des avocats et de la Ligue tunisienne des droits de l’homme, s’est formé. Par sa médiation, il a obtenu un compromis incluant un calendrier pour la Constitution, un gouvernement de technocrates neutres dirigé par Mehdi Jomaa et la tenue d’élections générales. Ce rôle a été mondialement salué et a valu au Quartet le prix Nobel de la paix en 2015.
La Constitution adoptée en 2014 consacre un régime semi‑parlementaire, reconnaît un large éventail de droits et libertés, affirme l’égalité entre les citoyens et garantit des avancées notables en matière de droits des femmes, dans la continuité du Code du statut personnel. Elle confirme l’islam comme religion du pays, mais ne fait pas référence à la charia comme source de droit, opérant un compromis original entre identité arabo‑musulmane et choix démocratiques.
Une exception relative dans le paysage des « printemps arabes »
L’histoire du pays en Tunisie ne se résume pas à sa révolution récente, mais celle‑ci éclaire la manière dont un pays pétri d’héritages multiples a pu tracer une voie singulière dans un contexte régional instable. L’étincelle partie de Sidi Bouzid inspire rapidement d’autres soulèvements : en Égypte, en Libye, au Yémen, en Syrie, à Bahreïn, des populations se lèvent contre des autoritarismes enracinés. Les trajectoires divergent : transition chaotique suivie d’un coup d’État militaire en Égypte, guerre ouverte en Libye et en Syrie, répression renforcée à Bahreïn, compromis fragile au Yémen avant la reprise du conflit.
La Tunisie est souvent présentée comme le seul pays de la région ayant engagé une transition démocratique durable, marquée par des élections pluralistes, une alternance pacifique et une société civile active. Cependant, elle doit encore relever des défis majeurs, notamment un chômage endémique, des déséquilibres régionaux, des tensions autour des libertés individuelles, des crispations identitaires et des tentations autoritaires qui réapparaissent périodiquement.
Mais si l’on prend un peu de recul, on voit se dessiner une continuité profonde. De la résistance des rois numides à l’emprise carthaginoise ou romaine, des révoltes berbères contre certains gouverneurs omeyyades, des soulèvements contre les corsaires ottomans ou les créanciers européens, jusqu’aux mobilisations anticoloniales et à la révolution de 2010‑2011, l’histoire du pays en Tunisie est traversée par un fil rouge : la volonté, souvent réprimée mais jamais totalement étouffée, de peser sur son propre destin.
Cette histoire explique en partie pourquoi, au tournant du XXIᵉ siècle, un peuple longtemps présenté comme « apolitique » et « docile » a surpris le monde en forçant la porte de l’avenir. La Tunisie, carrefour de civilisations depuis la fondation de Carthage, continue ainsi d’être un observatoire privilégié des tensions et des promesses qui traversent le monde arabe, entre aspirations démocratiques, poids des héritages et contraintes géopolitiques.
Un retraité de 62 ans, avec un patrimoine financier supérieur à un million d’euros bien structuré en Europe, souhaitait changer de résidence fiscale pour optimiser sa charge imposable et diversifier ses investissements, tout en conservant un lien avec la France. Budget alloué : 10 000 euros pour l’accompagnement complet (conseil fiscal, formalités administratives, délocalisation et structuration patrimoniale), sans vente forcée d’actifs.
Après analyse de plusieurs destinations attractives (Tunisie, Grèce, Chypre, Maurice), la stratégie retenue a consisté à cibler la Tunisie, profitant d’un cadre fiscal avantageux pour les retraités étrangers (exonération partielle des pensions rapatriées, fiscalité locale modérée), d’un coût de vie nettement inférieur à la France et d’une proximité culturelle et linguistique (francophonie). La mission a inclus : audit fiscal pré‑expatriation (exit tax ou non, report d’imposition), obtention de la résidence avec location ou achat de résidence principale, coordination CNAS/CPAM, transfert de résidence bancaire, plan de rupture des liens fiscaux français (183 jours/an hors France, centre d’intérêts économiques…), mise en relation avec un réseau local (avocat, spécialiste immigration, notaire francophone) et intégration patrimoniale (analyse et restructuration si nécessaire).
Vous souhaitez vous expatrier à l'étranger : contactez-nous pour des offres sur mesure.
Décharge de responsabilité : Les informations fournies sur ce site web sont présentées à titre informatif uniquement et ne constituent en aucun cas des conseils financiers, juridiques ou professionnels. Nous vous encourageons à consulter des experts qualifiés avant de prendre des décisions d'investissement, immobilières ou d'expatriation. Bien que nous nous efforcions de maintenir des informations à jour et précises, nous ne garantissons pas l'exhaustivité, l'exactitude ou l'actualité des contenus proposés. L'investissement et l'expatriation comportant des risques, nous déclinons toute responsabilité pour les pertes ou dommages éventuels découlant de l'utilisation de ce site. Votre utilisation de ce site confirme votre acceptation de ces conditions et votre compréhension des risques associés.
Découvrez mes dernières interventions dans la presse écrite, où j'aborde divers sujets.